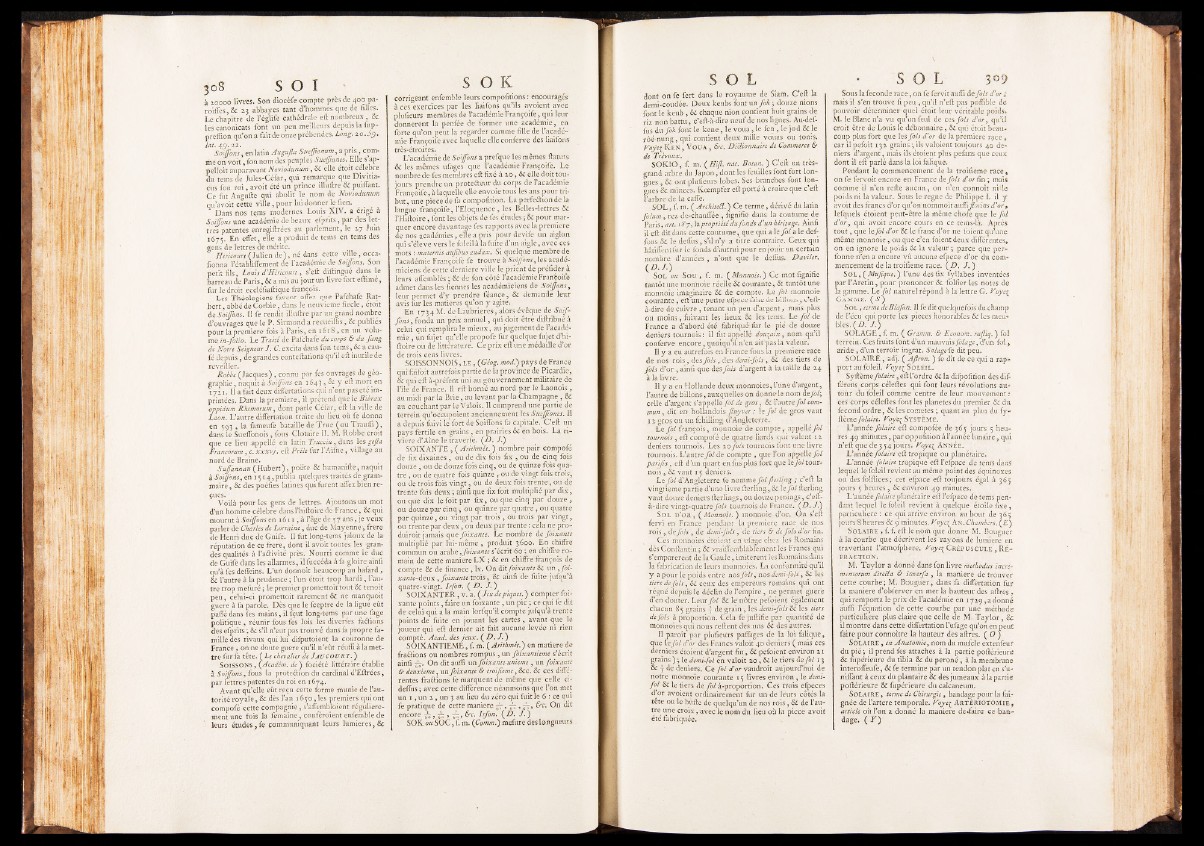
308 S O I
à ipobo livrës. Son diocèfe compte près de 4.00 pa-
roifles, 6c 23 abbayes tant d’hommes que de filles.
Le chapitre de l’églife cathédrale eft nombreux, 6c
les canonicats font un peu meilleurs depuis la fup-
preffion qu’on a fait de onze prébendes. Long. zo.Sc).
lat. 4.9-22.
Soiffons, en latin Augufia Sucfiionum, a pris, comme
on v o it, fon nom des peuples Suefiîones. Elle s ap-
peiloit auparavant Noviodunum, 6c elle etoit célébré
du tems de Jules-Céfar, qui remarque que Divitia-
cus fon ro i, avoit été un prince illuftre 6c puiffant.
Ce fut Augufte qui abolit le nom de Noviodunum
qu’avoit cette v ille , pour lui donner le fien.
Dans nos tçms modernes Louis XIV. a érigé à
Solfions une académie de beaux efprits, par des lettres
patentes enregiftrées au parlement, le 17 Juin
1675. En effet> elle a Produit de tems en tems des
gens de lettres de mérite.
Héricourt (Julien d e ) , ne dans cette ville , occa-
fiohna l’établiffement de l’académie de Solfions. Son
petit fils, Louis d'Héricourt, s’eft diftingué dans le
barreau de Paris, & a mis au jour un livre fort eftimé,
fur le droit eceléfiaftique françois.
Les Théologiens favent affez que Pafchafe Rat-
bert, abbé de Corbie, dans le neuvième fiecle, étoit
de Soifibns. Il fe rendit illuftre par un grand nombre
d’ouvrages que le P. Sirmond a recueillis, 6c publiés
pour la première fois à Paris, en 1618, en un volume
in-folio. Le Traité de Pafchafe du corps & du fang
de Notre Seigneur J. C. excita dans fon tems, 6c a cau-
fé depuis, de grandes conteftations qu’il eft inutile de
reveiller. ,
Robbe (Jacques) , connu par fes ouvrages de geo-
graphie , naquit à Soifibns en 1643 , 6c y eft mort en
1721. Il a fait deux differtations qui n’ont pas été imprimées.
Dans la première, il prétend que le Bibrax
oppidum Rkemorum, dont parle Céfar, eft la ville de
Laon. L’autre differtation traite du lieu oii fe donna
en 593 , la fameufe bataille de True (ou Traufli),
dans le Sueffonois, fous Clotaire II. M. Robbe croit
que ce liett appellé en latin Trucciu, dans les gefia
Francorum, c. xxxvj. eft Prêle fur l’Aifne, village au
nord de Braine.
Sufidnnau (Hubert), poëte & humanifte, naquit
à Soifibns, en 15 14 , publia quelques traités de grammaire
, 6c des poéfies latines qui furent allez bien reçues.
'
Voilà pour les gens de lettres. Ajoutons un mot
d’un homme célébré dansl’hiftoire de France, 6c qui
mourut à Soifibns en 16 1 1 , à l’âge de 57 ans, je veux
parler de Charles de Lorraine, duc de Mayenne j frere
de Henri duc de Guife. Il fut long-tems jaloux de la
réputation de ce frere, dont il avoit toutes les grandes
qualités à l’attivité près. Nourri comme le duc
de Guife dans les allarmes, il fuccéda à fa gloire ainli
qu’à fes deffeins. L ’un donnoit beaucoup au hafard,
6c l’autre à la prudence ; l’un étoit trop hardi, l’autre
trop mefuré ; le premier promettoit tout 6c tenoit
peu, celui-ci promettoit rarement 6c ne manquoit
guere à fa parole. Dès que le feeptre de la ligue eût
paffé dans fes mains, il fçut long-tems par une fage
politique , réunir fous fes lois les diverfes faâions
des efprits ; & s’il n’eut pas trouvé dans fa propre famille
des rivaux qui lui difputoient la couronne de
France , on ne doute guere qu’il n’eût réufli à la mettre
fur fa tête. ( Le chevalier de J AV COURT.")
Soissons, (Académ. de) fociété littéraire établie
à Soifibns, fous la prote&ion du cardinal d’Eftrées,
par lettres patentes du roi en 1674.
Avant qu’elle eût reçu cette forme munie de l’autorité
royale, 6c dès l’an 1650, les premiers qui ont
compofé cette compagnie, s’affembloient régulièrement
une fois la femaine, conféroient enfemble de
leurs études,fe communiquant leurs lumières, &
S O K
corrigeant enfemble leurs compofitions : encouragés
à ces exercices par les liaifons qu’ils avoient avec
plufieurs membres de l’académie Françoife, qui leur
donnèrent la per.fée de former une académie, en
forte qu’on peut la regarder comme fille de l’académie
Françoife avec laquelle elle conferve des liaifons
très-étroites.
L’académie de Soifibns a prefque les mêmes ftatuts
6c les mêmes ufages que l’académie Françoife. Le
nombre de fes membres eft fixé à 20, & elle doit toujours
prendre un proteéleur du corps de l’academie
Françoife, à laquelle elle envoie tous les ans pour tribut,
une piece de fa compofîtion. La perfeftion de la
langue françoife, l’Eloquence, les Belles-lettres 6c
l'Hiftoire, font les objets de fes études ; 6c pour marquer
encore davantage fes rapports avec la première
de nos académies, elle a pris pour devife un aiglon
qui s’élève vers le foleilà la fuite d’un aigle, avec ces
mots : maternis aujîbus audax. Si quelque membre de
l’académie Françoife fe trouve à Soifibns, les académiciens
de cette derniere ville le prient de préfider à
leurs affemblés ; 6c de ion côté l’académie Françoife
admet dans les fiennes les académiciens de Soiffons,
leur permet d’y prendre féance, 6c demande leur
avis fur les matières qu’on y agite.
En 1734 M. de Laubrieres, alors évêque de Soifi-
fions, fonda un prix annuel, qui doit être diftribué à
celui qui remplira le mieux, au jugement de l’académie
, un fujet qu’elle propofe fur quelque fujet d’hi-
ftoire ou de littérature. Ce prix eft une médaille d’or
de trois cens livres.
SOISSONNOIS, le , (Gtog. mod.) pays dé France
qui faifoit autrefois partie de la province de Picardie,
& qui eft à-préfent uni .au gouvernement militaire de
l’île de France. Il eft borné au nord par le Laonois ,
au midi par la Brie, au levant par la Champagne , 6c
au couchant par le Valois. Il comprend une partie de
terrein qu’oc'cupoient anciennement les Suefiîones. Il
a depuis fuivi le fort de Soiffons fa capitale. C’eft un
pays fertile en grains, en prairies 6c en bois. La rivière
d’Aîne le traverfe. (JD. J.)
SOIXANTE , ( Arithmèt. ) nombre pair compofé
de fix dixaines , ou de dix fois fix , ou de cinq fois
douze , ou de douze fois cinq, ou de quinze fois quatre
, ou de quatre fois quinze ou de vingt fois trois,
ou de trois fois v ingt, ou de deux fois trente, ou de
trente fois deux ; ainli que fix foit multiplie par dix,
ou que dix le foit par fix, ou que cinq par douze ,
ou douze par cinq-, ou quinze par quatre, ou quatre
par quinze, ou vingt par, trois , o\i trois par vingt,
ou trente par deux, ou deux par trente : cela ne pro-
duiroit jamais que foixante. Le nombre de fixan te
multiplié par lui-même , produit 3600. En chiffre
commun ou arabe, fioixante s’écrit 60 ; en chiffre romain
de cette maniéré LX ; 6c en chiffre françois de
compte 6c de finance , lx. On dit fioixante 6c u n , foi:-
xante-faux, fioixante-Xvois, 6c ainli de fuite jufqu’à
quatre-vingt. Irfon. ( D . J. )
SOIX ANTER, v. a. ( Jeu de piquet. ) compter foi-
xante points, faire un foixante , un pic ; ce qui fe dit
de celui qui a la main lorfqu’il compte jufqu’à trente
points de fuite en jouant les cartes , avant que le
joueur qui eft dernier ait fait aucune levée ni rien
compté. Acad, des jeux. ( D . J. )
SOIXANTIEME, f. m. ( Arithmèt.') en matière de
fra&ions ou nombres rompus , un foixanùeme s’écrit
ainli j^. On dit aufli un foixante-unieme , un foixante
& deuxieme, un fioixante & troifieme, & c . 6c ces différentes
fraftions fe marquent de même que celle ci-
deffus ; avec cette différence néanmoins que l’on met
un 1 , un 2 , un 3 au lieu du zéro qui fuit le 6 : ce qui
fe pratique de cette maniéré 07, j z , j j > &c. On dit
encore ^5, ^ » j z , &c. Irfon. (D . J. )
SOK. ou SO C, f. m. ( Çomm.) mefure des longueurs
S O L
dont on fe fert dans le royaume de Siam. C’eft la
demi-coudée. Deux keubs font un fiok ; douze nions
font le k eub , 6c chaque nion contient huit grains de
riz non battu, c’ eft-à-dire neuf de nos lignes. Au-def-
fus du fiok font le kene, le voua, le fen , le jod & le
rôé-nung, qui contient deux mille vouas ou ton:s.
Voÿefik.EN, VOUA, & c. Dictionnaire de Commerce &
de Trévoux. ■
SOKIO, f. m. ( Hifi. nat. Botan. ) C’eft un très-
grand arbre du Japon, dont les feuilles font fort longues
, 6c ont plufieurs lobes. Ses branches font longues
6c minces. Koempfer eft porté à croire que c’eft
l ’arbre de la caffe.
SOL, f. m. ( Architect.) Ce terme, dérivé du latin
fiolum, rez de-ehauffée , lignifie dans la coutume de
Paris, art. 187, la propriété du fonds d'un héritage. Ainli
il eft dit dans cette coutume, que qui a le fol a le def-
fous 6c le defliis, s’il n’y a titre contraire. Ceux qui .
bâtiffentfur le fonds d’autrui pour en jouir un certain
nombre d’années , n’ont que le deffus. Daviler.
(D .J . )
Sol ou Sou , f. m. ( Monnoie. ) Ce mot lignifie
tantôt une monnoie réelle 6c courante, & tantôt une
monnoie imaginaire 6c de compte. Le fol monnoie
courante, eft une petite efpece faite de bilions, c’eft-
à-dire de cuivre , tenant un peu d’argent, mais plus
ou moins , fuivant les lieux 6c les tems. Le fo l de
France a d’abord été fabriqué fur le pié de douze
deniers tournois : il fut appellé doutain, nom qu’il
conferve encore, quoiqu’il n’en ait'pas la valeur.
Il y a eu autrefois en France fous, la première race
de nos rois, des fo ls , des demi-fols, & des tiers de
fols d’or , ainli que des fols d’argent à la taille de 24
à la livré.
Il y a en Hollande deux: monnoies, l’uné d’argent,
l’autre de bilions,.auxquelles-on donne le nom de/ô/;
celle d’argent s’appelle fo l de gros, 6c i’autre fo l commun
, dit en hollandois (luyver : le fiel de gros vaut
12 gros ou un fchilling d’Angleterre.
Le fo l françois, monnoie' de compte, appellé fo l
tournois, eft compofé de quatre liards qui valent 12
deniers tournois. Les 1.0 fols tournois font une livre
tournois. L’autre fol de compte , que l’on appelle fol
parifis, eft d’un quart en fus plus fort que le fo l tournois
, & vaut 15 deniers.
h t fo l d’Angleterre fe nomme fo l fierliug ; c’eft la
vingtième partie d'une livre fterling-,.& le fol fterling
vaut douze deniers fterlings , ou douze penings, c’eft-
à-dire vingt-quatre fols tournois de France. (JD. J.)
Sol d’or , ( Monnoie. ) monnoie d’or. On s’eft
fervi en France pendant la première raGe de nos
rois y. de fo ls , de demi-fols," de tiers & de fols d'or fin.
Ces monnoies étoient en ufage chez les Romains
dès Conftantin ; 6c vraiffemblàblement les Francs qui
s’emparèrent de la Gaule, imitèrent lesRomains dans
la fabrication de leurs monnoies. La conformité qu’il
y a pour le poids entre nos fols y nos demi-ƒois, 6c les
tiers de fo ls , 6c ceux des empereurs romains qui ont
régné depuis le déclin de l’empire , ne permet guere
d’en douter. Leur fo l 6c le' nôtre pefoient également
chacun 8 5 grains f de grain , les demi-fols 6c les tiers
de fols à proportion. Cela fe juftifie par quantité de
monnoies qui nous reftent des,uns 6c des autres.
Il paroît par plufieurs pafiages de la loi falique,
que le fo l d'or des Francs valoit 40 deniers ( mais ces
derniers étoient d’argent fin, 6c pefoient environ 21
grains ) ; le demi-fol en valoit 2 0 ,6c le tiers de fol 13
& j de deniers. Ce fol d'or vaudroit aujourd’hui de
notre monnoie courante 15 livres environ, le demi-
fo l 6c le tiers de fo l à-proportion. Ces trois efpeces
d’or avoient ordinairement fur un de leurs côtés la
tete ou le bufte de quelqu’un de nos rois, 6c de l’autre
une croix, avec le nom du lieu où la piece avoit
été fabriquée.
S O L 3 °9
Sous la fécondé race, on fe fervit aufli de fols d'or }
mais il s’en trouve fi peu , qu’il n’eft pas poflible de
pouvoir déterminer quel étoit leur véritable poids»
M. le Blanc n’a vu qu’un feul de ces fols d’or, qu’il
croit être de Louis le débonnaire, 6c qui étoit beaucoup
plus fort que les fols d'or de la première race ,
car il pefoit 132 grains ; ils valoient toujours 40 de»
niers d’argent, mais ils étoient plus pefans que ceux
dont il eft parlé dans la loi falique.
Pendant le commencement de la troifieme race ,
on fe fervoit encore en France de fols d'or fin ; mais
comme il n’en refte aucun, on n’en connoît niUe
poids ni la valeur. Sous le régné de Philippe I. il y
avoit des francs d’or qu’on nommoit auffi florins d'or ,
lefquels étoient peut-être la même choie que le fol
d'or, qui avoit encore cours en ce tems-là. Après
tout, que le fol d’or 6c le franc d’or ne foient qu’une
même monnoie, ou que c’en foient deux différentes,
on en ignore le poids 6c la valeur ; parce que per*
fonne n’en a encore'vû aucune efpece d’or du commencement
de la troifieme race. (D . J . )
Sol , ( Mujîque. ) l’une des fix fyllabes inventées
par l’Aretin, pour prononcer 6c folfier les notes de
la gamme. Le fo l naturel répond à la lettre G. Voye£
Gam m e. ( 5 )
So l , terme deBlafon. Il fe dit quelquefois du champ
de l’écu qui porte les pièces honorables 6c les meubles.
( D. J .)
SOLAGE, f. m. ( Gramm. & Econom. rufiiq. ) fol
terrein. Ces fruits font d’un mauvais folage, d’un fo l,
aride , d’un terroir ingrat. Solage fe dit peu.
SOLAIRE, adj. ( AJtron. ) fe dit de ce qui a rapport
au foleil. Voye{ Soleil.
Sÿftèrne folaire, eft l’ordre 6c la difpofition des difi
férehs. corps céleftes qui font leurs révolutions autour
du foleil comme centre de leur mouvement :
ces corps céleftes font les planètes du premier 6c du
fécond ordre, 6c les cometes ; quant au plan du fy-
ftème folairt. Voye^ Sy stème.
L’arînée folaire eft eompofée de 3 65 jours 5 heu-*
res 49 minutes, par oppofition à l’année lunaire, qui
n’eft que de 3 54 joürs. Voÿe^ A nN’Ée.
L’année folaire eft tropique ou planétaire.
L’année folaire tropique eft l’elpace de tems dans
lequel lé foleil revient au même point des équinoxes
ou desfolftiçes; cet efpace eft toujours égal à 365
jours 5 heures, & environ 49 minutes.
L ’année folaire planétaire eft l’efpace de feriis pen-
1 dant lequel le foleil revient à quelque étoile fixe ,
particulière : ce qui arrive environ au bout de 36$
jours 8 heures 6c 9 minutes. Voyc^ An. Charnbers. (£ )
Solaire , f. f. eft le nô'iîi que donne M. Bouguer
à' la couïbë que décrivent les rayons de lumière en
traverfant l’atmofphere, P'oye^ C répuscule , Réfr
a ct ion .
M. Taylor a donné dans fon Ywrtmethodus incre-
mentorüm âirecla & inverfa, la maniéré de trouver
cette courbe; M. Bouguer, dans fa differtation fur
la maniéré d’obferver en mer la hauteur des aftres ,
qui remporta le prix de l’académie en 1729, a donné
auffi l’équation de cette courbe par une méthode
particulière plus claire que celle de M. T a y lo r , 6c
il montre dans cette differtation l’ufage qu’on en peut
faire pour connoître la hauteur des aftres. ( O )
Solaire , en Analômie, nom du mufcle extenfeuf
du pié ; il prend fes attaches à la partie poftérieure
6c fupérieurê du tibia 6c du péroné, à la membrane
interoffeufe, & fe termine par un tendon plat en s’u-
niffant à ceux du plantaire 6c des jumeaux à la partie
poftérieüre 6c fupérieure du calcanéum.
Solaire , terme de Chirurgie, bandage pour la fai-
gnée de l’artere temporale. Voye^ A r t ér io tom ie ,
article où l’on a donné la maniéré de «faire ce ban-
dage, ( Y ')