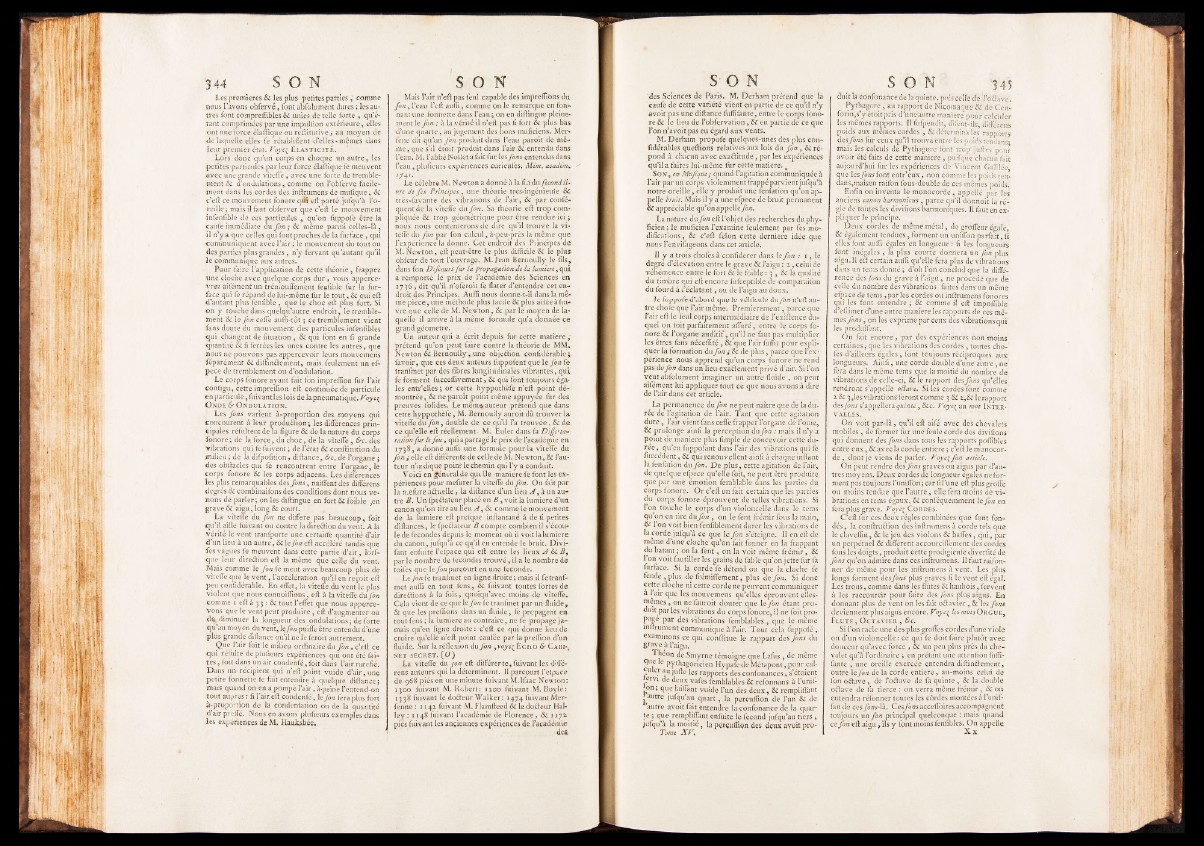
Les premières & les plus petites parties ^ comme
nous l ’avons obfervé, font abfolument dures ; les autres
font compreffibles & unies de telle forte , qu’étant
comprimées par une impulfion extérieure, elles
ont une force ëlaftique ou reftitutive, au moyen de
«le laquelle elles fe rétabliffent d’elles - mêmes dans
leur premier état. Voyt{ Él a s t ic it é .
Lors donc qu’un corps en choque un autre, les
petites particules par leur force élaftiquefe meuvent
•avec une grande vîteffe, avec une forte de tremblement
& d’ondulations, comme on l’obferve facilement
dans les cordes des inftrumens de mufique, &
c’eft ce mouvement fonore qiîi eft porté jufqu’à l’oreille
; mais il faut obferver que c’eft le mouvement
infenfible de ces particules , qu’on fuppofe être la
caufeimmédiate du fon ; &c meme parmi celles-là,
il n’y a que celles qui font proches de la furface, qui
communiquent avec l ’air ; le mouvement du tout ou
des parties plus grandes , n’y fervant qu’autant qu’il
le communique aux autres.
Pour faire l ’application de cette théorie , frappez
line cloche avec quelque cprps dur, vous apperce-
vrez aifément un trémouffement feufible fur la fur-
face qui fe répand de lui-même fur le tout, & qui eft
d’autant plus fenfible , que le choc eft plus fort. Si
on y touche dans quelqu’autre endroit, le tremblement
& le fon ceffe aum-tôt ; ce tremblement vient
fans doute du mouvement des particules infenfibles
qui changent de fituation , & qui font en ft grande
quantité & fi ferrées les unes contre les autres, que
nous ne pouvons pas appercevoir leurs mouvemens
féparément & diftinttement, mais feulement un ef-
pece de tremblement ou d’ondulation.
Le corps fonore ayant fait fon impreflion fur l’air
contigu, cette imprelfion cft continuée de particule
en particule, fuivantles lois de la pneumatique. Voyeç
O nde & O ndulation.
Les fons varient à-proportion des moyens qui
Concourent à leur production ; les différences principales
réfultent de la figure & de la nature du corps
fonore ; de la force, du choc, de la vîteffe, &c. des
vibrations qui fe fuivent ; de l’état & conftitution du
milieu ; de la difpofition, diftance, &c. de l’organe ;
des obftacles qui fe rencontrent entre l’organe, le
corps fonore & les corps adjacens. Les différences
les plus remarquables des fon s , naiffent des différens
degrés & combinaifons des conditions dont nous venons
de parler; on les diftingue en fort & foible .en
grave & aigu, long & court.
La vîteffe du fon ne différé pas beaucoup, foit
qu’il aille fuivant ou contre la direction du vent. A la
vérité le vent tranfporte une certairfe quantité d’air
d’un lieu à un autre, & le fon eft accéléré tandis que
fes vagues fe meuvent dans cette partie d’a ir , lorf-
que leur direction eft la même que celle du vent.
Mais comme le fon fe meut avec beaucoup plus de
Vîteffe que le v ent, l’accélération qu’il en reçoit eft
peu confidérable. En effet, la vîteffe du vent le plus
violent que nous connoiffions, eft à la vîteffe du fon
comme i eft à 33 : & tout l’effet que'nous apperce-
vons que le vent peut produire, eft d’augmenter'ou
d$> diminuer la longueur des ondulations ; de forte
qu’au moyen du vent, lefon puiffe être entendu d’une
plus grande diftance qu’il ne le feroit autrement.
Que Pair foit le milieu ordinaire du fo n , c’eft ce
qui refulte de plufieurs expériences qui ont été faites
, foit dans uil air condenfé, foit dans l’air raréfié.
Dans un récipient qui n’eft point vuide d’air, une
petite fonnette lé fait entendre à quelque diftance;
mais quand on en a pompé l’air, àpeine l’entend-on
tout auprès : fi l’air, eft condenfé, le fon fera plus fort
à-proportion de la condenfation ou de la quantité
d’air preffé. Nous en avons' plufieurs exemples dans
les expériences de M. Hauksbée,
Mais l’air n’eft pas feul capable des impreffibns dit
fo n , l’eau l’ eft auffi, comme on le remarque en fon*
nant une fonnette dans l’eau ; on en diftingue pleinement
le fon : à la vérité il n’ eft pas fi fort & plus bas
d’une quarte, au jugement des bons muficiens. Mer-
fene dit qu’un fon produit dans l ’eau paroît de même
, que s’il étoit produit dans l’air- & entendu dans
l’eau. M. l’abbé Nollet a fait fur les fons entendus dans
l’eau, plufieurs expériences curiepfes. Mém. acadèm*
H S fi
Le célébré M, Newton a donné à la fin in fécond livre
de fes Principes, une théorie très-ingénieule &
très-favante des vibrations de l’air, & par confé-
quent de la vîteffe du fon. Sa théorie eft trop compliquée
& trop géométrique pour être rendue ici ;
nous nous cohtenterons de dire qu’il trouve la vîteffe
du fon par fon calcul, à-peu-près la même que
l’expérience la donne. Cet endroit des Principes de
M. Newton, eft peut-être le plus difficile Sc le plus
obfcur de tout l’ouvrage. M. Jean Bernoully le fils*
dans fon Difcours fur la propagation de la lumière, qui
a remporté le prix de l’académie des Sciences en
1736 , dit qu’il n’oferoit fe flater d’entendre cet endroit
des Principes. Auffi nous donnevt-il dans la même
piece, une méthode plus facile & plus aifée à fui-
vre que celle de M. Newton, & par le moyen de laquelle
il arrive à la même formule qu’a donnée ce
grand géomètre.
Un auteur qui a écrit depuis fur cette matière ^
prétend qu’on peut faire contre la théorie de MM.
Newton & Bernoully, une objettion confidérable;
favoir, que ces deux auteurs fuppofent que le fon fe
tranfmet par des fibres longitudinales vibrantes, qui
fe forment fucceflivement, & qui font toujours égales
entr’elles; or cette hyppothèfe n’eft point démontrée
, & ne paroît point même appuyee fur des
preuves folides. Le même auteur prétend que dans
cette hyppothèfe, M. Bernoully auroit dû trouver la
vîteffe du fo n y double de ce qu’il l’a trouvée, & de.
ce qu’elle eft réellement. M. Euler dans fa Differta-
tation fur le feu , qui a partagé le prix de l’académie en
1738, a donné auffi une formule pour la vîteffe du
fon } elle eft différente de celle de M. Newton, & fauteur
n’indique point le chemin qui l’y a conduit.
Voici en général de qut lie -maniéré fe font les expériences
pour mefurer la vîteffe du fon. On fait par
la rr,efure aftnelle, la diftance d’un lieu A , à un autre
B. Un fpettateur placé en B , voit la lumière d’un
canon qu’on tire au lieu A , & comme le mouvement
de la lumière eft prefque inftantané à de fi petites
diftances, le fpettateur B compte combien il s’écoule
de fécondés depuis le moment où il voit la lumière
du canon, jufqu’à ce qu’il en entende le bruit. Divi-
fant enfuite l’efpace qui eft entre les lieux A & B ,
parle nombre de fécondés trouvé, il a le nombre de
toifes que le fon parcourt en une fécondé.
Le Jon fe tranfmet en ligne droite ; mais,il fe tranfmet
auffi en tout fens, & fuivant toutes fortes de
directions à la fois, quoiqu’avec moins de vîteffe.
Cela vient de ce que le fon fe tranfmet par un fluide,
& que les preffions dans un fluide, fe propagent en
tout fens ; la lumière au contraire, ne fe propage jamais
qu’en ligne droite : c’eft ce qui donne lieu de
croire qu’elle n’eft point caufée par la preffion d’un
fluide. Sur la réflexion du fon 7voye.[É c a o & C a b i -,
NET SECRET. ( O )
La vîteffe du jon eft différente, fuivant les différens
auteurs qui la déterminent. Il parcourt l’eipace
de 968 piés en une minute fuivant M.Ifaac Newton:
1300 fuivant M. Robert: 1200 fuivant M. Boyle:
1338 fuivant le dotteur Walker : 1474 fuivant Mer-
fenne : 1 14a fuivant M. Flamfteed & le dotteur Hal-
ley : 1148 fuivant l’académie de Florence, & 117 1
piés fuivant les anciennes expériences de l’académie
des
des Sciences de Paris. M. Dërham prétend que la
caufe de cette variété vient'en partie de ce qu’il n’y
avoit pas une diftance fuffifantë, entre le corps fonore
& le lieu de l’obfervation, & en partie de ce que
l’on n’avoit pas eu égard aux vents.
M. Derham propofé quelques-unes des plus con-
fidérables qüeftions relatives aux lois du fo n , & répond
à chacun avec exattitude, par les expériences
qu’il a faites lui-même fur cette matière.
So n , en Müjîquè; quand l’àgifation communiquée à
l’air par un corps violemment frappé parvient jufqu’à
notre oreille,.elle y produit une fenfation qu’on appelle
bruit. Mais il y a une efpece de bruit permanent
& appréciable qu’on appelle fon.
La nature du fon eft l’objet des recherches du phy-
licien ; lé muficien l’examine feulement par fes modifications,
& c’eft félon cette derniere idée que
nous l’envifageons dans cet article.
Il y a trois chofes à confiderer dans le fon : ï , le
degre d’élévation entre le grave & l’aigu : 2 , celui de
véhémence entre le fort & le foible 1 3 , & la qualité
du timbre qui eft encore fufceptible de comparaifon
du fourd à l’éclatant, qu de l’aigu au doux.
Je fuppofe d’abord que le véhicule du fon n’eft autre
choie que Fair même. Premièrement, parce que
Pair eft le feul corps intermédiaire de l’exiftence duquel
on foit parfaitement aflùré, entre le corps fonore
& l’organe auditif, qu’ il ne faut pas multiplier
les êtres fans néceffité , & que l’air fuffit pour expliquer
la formation du fo n ; & de plus, parce que l’expérience
nous apprend qu’un corps fonore ne rend
pas de fon dans un lieu exattement privé d’air. Si l’on
veut abfolument imaginer un autre fluide , on peut
aifément lui appliquer tout ce que nous avons .à dire
de l’air dans cet article.
La permanence du fon ne peut naître que de la durée
de l’agitation de l’air. Tant que cette1 agitation
dure, l’air vient fans ceffe frapper l’organe de l’ouïe,
'& prolonge ainfi la perception du fon : mais il n’y a
point de maniéré plus fimple de concevoir cette durée
, qu’en fuppofant dans l’air des vibrations qui fe
fuccédent, & qui renouvellent ainfi à chaque inftant
la fenfation du fon. De plus, cette agitation de l’air,
de quelque efpece qu’elle foit, ne peut être produite
que par une émotion femblable dans les parties du
corps fonore. Or c’eft un fait certain que les parties
du corps fonore éprouvent de telles vibrations. Si
l’on touche le corps d’un violoncelle dans le tems
qu’on en tire du fon , on le fent frémir fous la main, ;
& l’on voit bien fenfiblement durer les vibrations de
la corde jufqu’à ce que le fon s’éteigne. Il en eft de '
même d’une cloche qu’on fait fonner en la frappant |
du batant ; on la fent, on la voit même frémir, &
l’on voit fautiller les grains de fable qu’on jette fur fa
furface. Si la corde fe détend ou que la cloche fe
fende , plus- de frémiffement, plus de fon. Si donc
cette cloche ni cette corde ne peuvent communiquer
à l’air que les mouvemens qu’elles éprouvent elles-
memes, on ne fauroit douter que le fon étant produit
par les vibrations du corps fonore, il ne foit pro-
page par des vibrations femblables, que le même
mftrument communique à l’air. Tout cela fuppofé,
examinons ce qui conftitue le rapport des fons du
grave à l’aigu.
Théon de Sinyrne témoigne que Lafus , de même
que le pythagoricien Hypale de Métapont, pour calculer
au jufte les rapports des confonances, s’étoient
ervi de deux vafes femblables & refonnans à l’unif-
jon; que laifîant vuide l’un.des deux, & rempliffant
^autre jufqu’au quart, la pereuffion de l’un & de
’autre avoit fait entendre la confonance de la quarte
; que rempliffant enfuite le fécond jufqu’au tiers ,
jufqu’à la moitié, la pçrçuffion des deux avoit pro-
Tome XK%
duit la confonance delà quinte, puis celle de i’ôttave.
Pythagore , au rapport de Nicomaquè & de C'en-
forin,s’y étôifpris d’uneautre maniéré pour calculer
les mêmes rapports. Il fufpendit, difent-ils, différens
poids aux mêmes cordes , & détermina les rapports
des fons fur ceux qu’il trouva entre les poids te ne! an s ■
mais les calculs de Pythagore font trop* juftes pour
avoir été faits de cette maniéré, puifque chacun fait
aujourd’hui fur les expériences de Vincent Galilée,
que les fons font entr’eu x, non comme les poids ten*
dans,maisen raifon foüs-dOuble de cès mêmes poids»
Enfin on inventa le monocorde , appellé par les
anciens cà/zo/z karmonicüs, parce qu’il donnoit la régie
de toutes les divifions harmoniques. Il faut en ex»
pliquer le principe.
Deux cordes de même métal, de groffeur égale,
& également tendues, forment un uniffon parfait, fi
elles font auffi égales en longueur : fi les longueurs
font inégales , la plus courte donnera un fon plus
aigu. Il eft certain auffi qu’elle Fera plus de vibrations
dans un tems donné ; d’où l’on conclud que la différence
des fons du grave à l’aigu, ne procède que de
celle du nombre des vibrations faites dans un même
efpace de tems, par les cordes ou iriftrumehs fonores
qui les font entendre ; & comme il eft impoffible
d’eftimer d’une autre maniéré les rapports de ces mêmes
fons, pii les exprime par ceux des vibrations qui
les produifent.
On fait encore, par des expériences non moins
certaines, que les vibrations des cordes , toutes chofes
d’ailleurs égales , font toujours réciproques aux
longueurs. Ainfi, une cordé double d’une autre-, ne
fera dans le même tems que la moitié du nombre de
vibrations.de celle-ci, & le rapport des fons qu’elles
rendront s’appelle oiïave. Si les cordes font comme
x & 3,les vibrations'feront comme 3 & 2 ,&lerapport
des fons s’appellera quinte, &c. Voye^ au mot Interv
a l l e s . -
On'voit par-là, qu’il eft aifé avec des chevalets
mobiles , de Former fur une feule corde des divifions
qui donnent des fons dans tous les rapports poffibles
entre eux, & avec la corde entière ; c’eft le monocorde
, dont je viens de parler. Poye^fon article.
On peut rendre des fons graves ou aigus par d’autres
moyens. Deux Gordes de longueur égales né forment
pas toujours l’uniffon; car fi l’une eft plus groffe
ou moins tendue que l’autre, elle fera moins dé v ibrations
en tems égaux, & conféquemment le fon en
fera plus grave. Voye[ C orde si
. C ’eft fur ces deux régies combinées que font fondés
, la conftruttion des inftrumens à corde tels que
le claveffin, & le jeu des violons & baffes, qui, par
un perpétuel & différent accourciffement des cordes
fous les doigts, produit cette prodigieufe diverfité de
fons qu’on admire dans ces inftrumens. Il faut raifon-
ner de même pour les inftrumens à vent. Les plus
longs forment des fons plus graves fi le vent eft égal.
Les trous, comme dans les fuites & haubois /fervent
à lès raccourcir pour faire des fons plus aigus. En
donnant plus de vent on les fait ottavier, & les fons
deviennent plus aigus encore. Voye1 les motsORGVE,
Flû t e , O ctavier , &c.
Si l’on racle une des plus groffes cordes d’une viole
ou d’un violoncelle : ce qui fe doit faire plutôt avec
douceur qu’avec force , & un peu plus près du chevalet
qu’à l’ordinaire ; en prêtant une attention fuffi-
fante , une oreille exercée entendra diftinttement,
outre le fon de la corde entière, au-moins celui de
fon ottave , de l’ottave de fa quinte , & la. double
ottave de fa tierce : on verra même frémir , & on
entendra réfonner toutes les côrdes montées à l’unif-
fande ces J'ons-là. Cesyô/zi aceeflbires accompagnent
toujours un fon principal quelconque : mais quand
ce fon eft aigu, ils y font moins fenfibles. On appelle
A