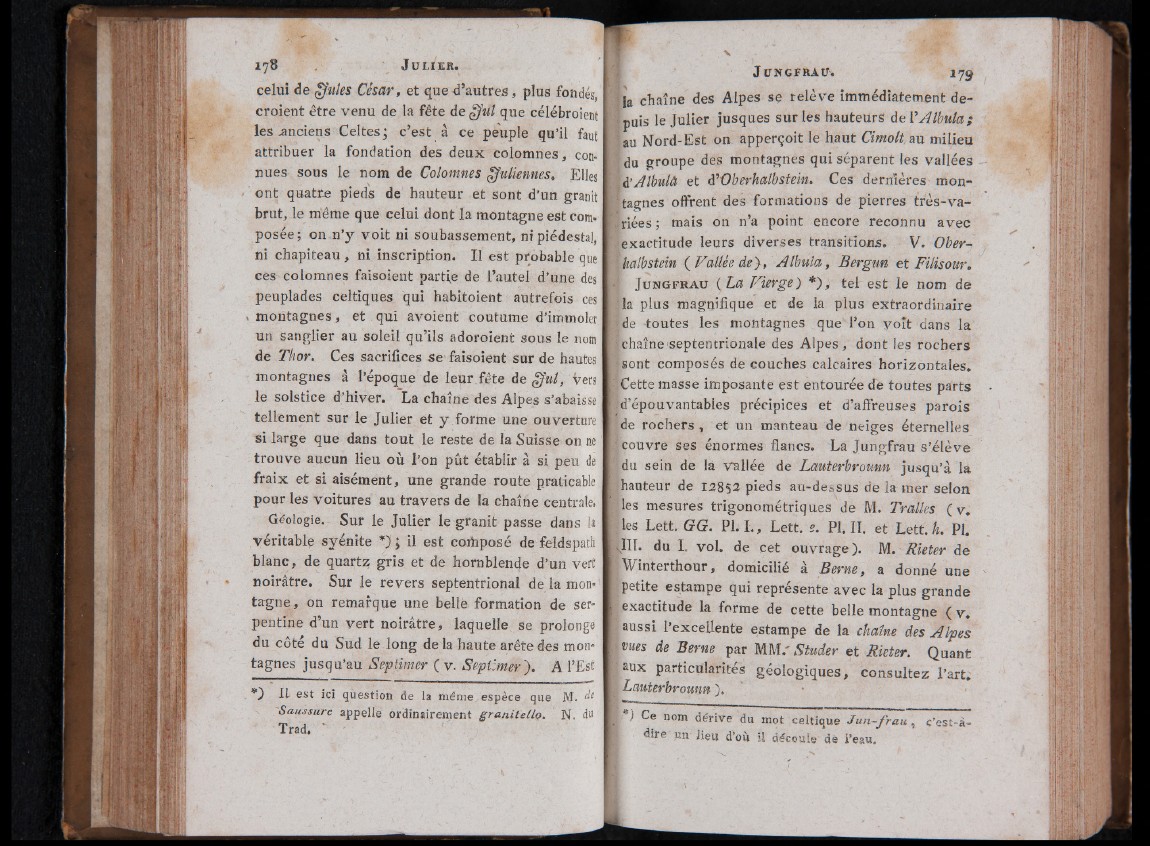
celui de 0Mtes César, et que-d’autres, plus fondés,
croient être venu de la fête de 0 $ que célébroient
les anciens Celtes; c’est à ce peuple qu’il faut
attribuer la fondation des deux colomnes, con*
nues sous le nom de Colomnes juliennes. Elles
ont quatre pieds de hauteur et sont d’un granit
brut, le même que celui dont la montagne est composée;
on n’y voit ni soubassement, ni piédestal,
ni chapiteau, ni inscription. Il est probable que
ces colomnes faisoient partie de l’autel d’une des
peuplades celtiques qui habitoient autrefois ces
% montagnes, et qui avoient coutume d’immoler
un sanglier au soleil qu’ils adoroient sous le nom
de Thor. Ces sacrifices se faisoient sur de hautes
montagnes à l’époque de leur fête de 0 ul, Vers
le solstice d’hiver. La chaîne des Alpes s’abaisse
tellement sur le Julier et y forme une ouverture
si large que dans tout le reste de la Suisse on ne
trouve aucun lieu où l’on pût établir à si peu de
fraix et si aisément, une grande route praticable
pour les voitures au travers de te chaîne centrale,
Géologie. Sur le Julier le granit passe dans la
véritablq syénite *); il est cortiposé de feldspath
blanc, de quartz gris et de hornblende d’un vert
noirâtre. Sur le revers septentrional de la montagne,
on remarque une belle formation de serpentine
d’un vert noirâtre, laquelle se prolonge
du cote du Sud le long de la haute arête des montagnes
jusqu’au Septimer ( v. Septimer'). A l’Est
* ) I f est ici question de la même espèce que M. dt
Saussure appelle ordinairement granitsllo. N. du
Trad.
la chaîne des Alpes se relève immédiatement de-
ipuis le Julier jusques sur les hauteurs del'Albula;
au Nord-Est on apperçoit le haut Cimolt au milieu
Idu groupe des montagnes qui séparent les vallées
jd'Albuld et d’Oberhalbstein. Ces dernières montagnes
offrent des formations de pierres très-varié
es ; mais on n’a point encore reconnu avec
exactitude leurs diverses transitions. V. Ober-
f halbstein (Vallée de), Albula, Bergun et Filisour.
J u n g f r a u (La Vierge) * ) j tel est le nom de
;la plus magnifique et de la plus extraordinaire
Ide toutes les montagnes que l’on yoît dans la
|chaîne septentrionale des Alpes, dont les rochers
*sont composés de couches calcaires horizontales.
; Cette masse imposante est entourée de toutes parts
v d’épouvantables précipices et d’affreüses parois
de rochers, et un manteau de neiges éternelles
|couvre ses énormes flancs. La Jungfrau s’élève
idu sein de la vallée de Lauterbrounn jusqu’à la
¡hauteur de 12852 pieds au-dessus de la mer selon
les mesures trigonométriques de M. Traites ( v .
¡ les Lett. GG. Pl. I., Lett. e. Pl. II. et Lett. h. Pl.
IÏIL du I. vol. de cet ouvrage). M.Rieter de
|Winterthour, domicilie à Berne, a donné une
I petite estampe qui représente avec te plus grande
■exactitude la forme de cette belle montagne ( v*
¡ aussi l’excellente estampe de la chaîne des Alpes
j vues de Berne par MM/ Studer et Rieter. Quant
faux particularités géologiques, consultez l’art.
I Lauterbrounn ).
i } Ce nom dérive du mot celtique Ju r i - f r a u , c’est-à-
dire un lieu d’où il découle de l’eau.