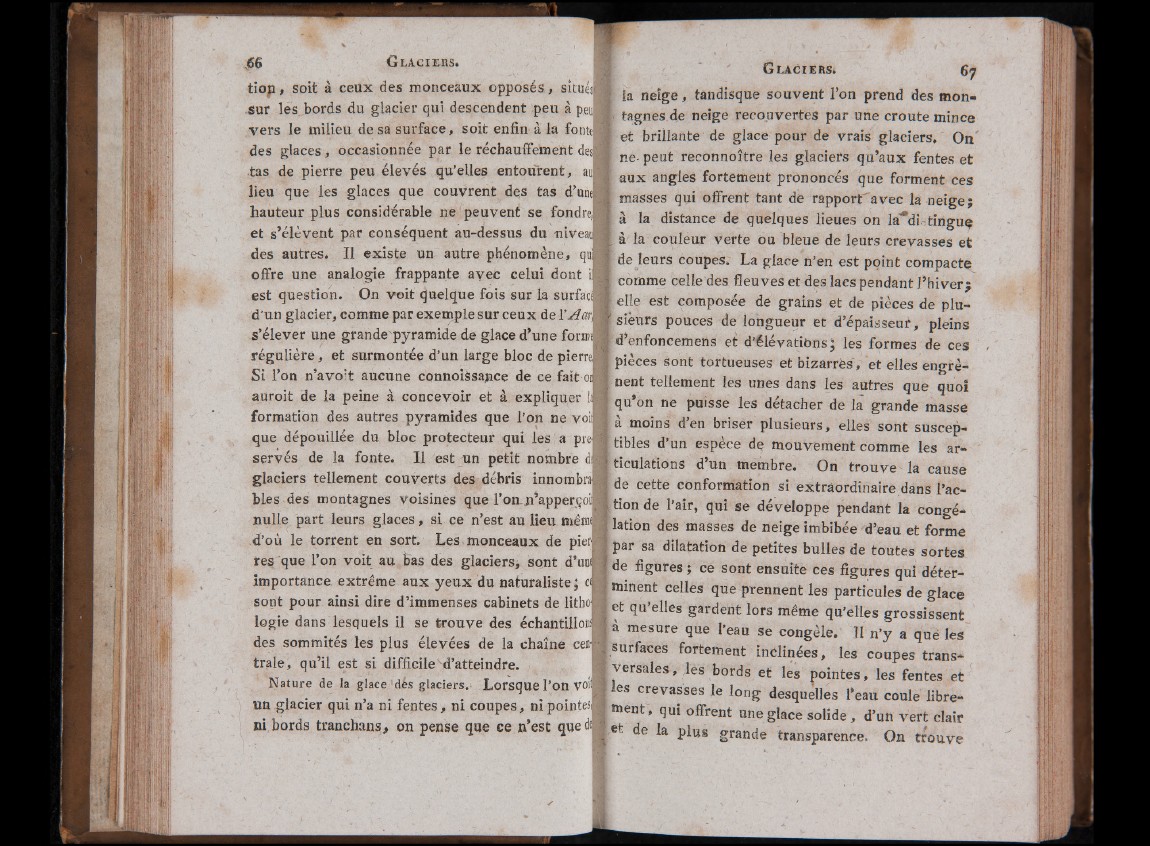
tion, soit à ceux des monceaux opposés, situés!
sur les bords du glacier qui descendent peu à peu|
vers le milieu de sa surface, soit enfin à la fo n J
des glaces , occasionnée par le réchauffement des!
tas de pierre peu élevés qu’elles entourent, a j
lieu que les glaces que couvrent des tas d’unel
hauteur plus considérable ne peuvent se fondrel
et s’élèvent par conséquent au-dessus du niveau!
des autres* II existe un autre phénomène, qui
offre une analogie frappante ayec celui dont ill
est question. On voit quelque fois sur la surfacl
d’un glacier, comme par exemple sur ceux de r^ a rl
s’élever une grande'pyramide de glace d’une fornJ
régulière, et surmontée d’un large bloc de pierre,!
Si l’on n’avoit aucune connoiàsajnce de ce fait oi
auroit de la peine à concevoir et à expliquer il
formation des autres pyramides que l’on ne voil
que dépouillée du bloc protecteur qui les a pre|
servés de la fonte. Il est Ain petit nombre dl
glaciers tellement couverts des débris innombn|
bles des montagnes voisines que l’on ji’apperçoil
nulle part leurs glaces, si ce n’est au lieu mêmJ
d’où le torrent en sort. Les monceaux de pierl
tes que l’on voit au Î>as des glaciers; sqnt d’uol
importance extrême aux yeux du naturaliste ; cil
sont pour ainsi dire d’immenses cabinets de litbo|
logie dans lesquels il se trouve des échantillon!
des sommités les plus élevées de la chaîne ce«
traie, qu’il est si difficile\d’atteindre.
j la neige > tandisque souvent l’on prend des mon-
I tagnes de neige recouvertes par une croûte mince
I et brillante de glace pour de vrais glaciers. On
1 ne- peut reconnoître les glaciefs qu’aux fentes et
I aux angles fortement prononcés que forment ces
I masses qui offrent tant de rapport'avec la neige;
l à la distance de quelques lieues on la"*di-tinguq
I à la copieur verte ou bleue de leurs crevasses et
K de leurs coupes, La glace n’en est point compacte
K comme celle des fleuves et des lacs pendant J’hiver;
K elle est composée de grains et de pièces de plu-
I sieurs pouces de longueur et d’épaisseur, pleins
idWoncemens et d’élévatiops; les formes de ces ,
¡ pièces sont tortueuses et bizarrèsV et elles engrè-
! nent tellement les unes dans les autres que quoi
I qu*on ne puisse les détacher dé là grande masse
l à moins d’en briser plusieurs, elles sont suscep-
I tibles d’un espèce dq mouvement comme les ar-
I ticulationS d’un membre. On trouve la cause
Ide cette conformation si extraordinaire dans l’ac-
I tion de l’air, qui se développe pendant la congé-
T lation des masses de neige imbibée d’eau et forme
J par sa dilatation de petites bulles de toutes sortes
de figures ; ce sont ensuite ces figures qui déterminent
Nature de la glace dés glaciers.> Lorsque l’on Vûitl
un glac■' i• er qu•i n’a ni fentes, ni coupes, nipv ointesIJ
ni bords tranchans, on pense que ce n’est que^l
- v ■ ¡r ■ • k
mWÆM1 Pu Mê$ -1 v SI pm $ êÊ S- "•r # S; ; v>v ® •tïwi ': ■ H ✓
celles que prennent les particules de glace
et qu’elles gardent lors même qu’elles grossissent
J à mesure que l’eau se congèle. II n’y a que les
.surfaces fortement inclinées, les coupes transv
e r sa le s , les bords et les pointes, les fentes et
les crevasses le long desquelles l’eau coule librement,
qui offrent une glace solide, d’un vert clair
et de la plus grande transparence. On trouve