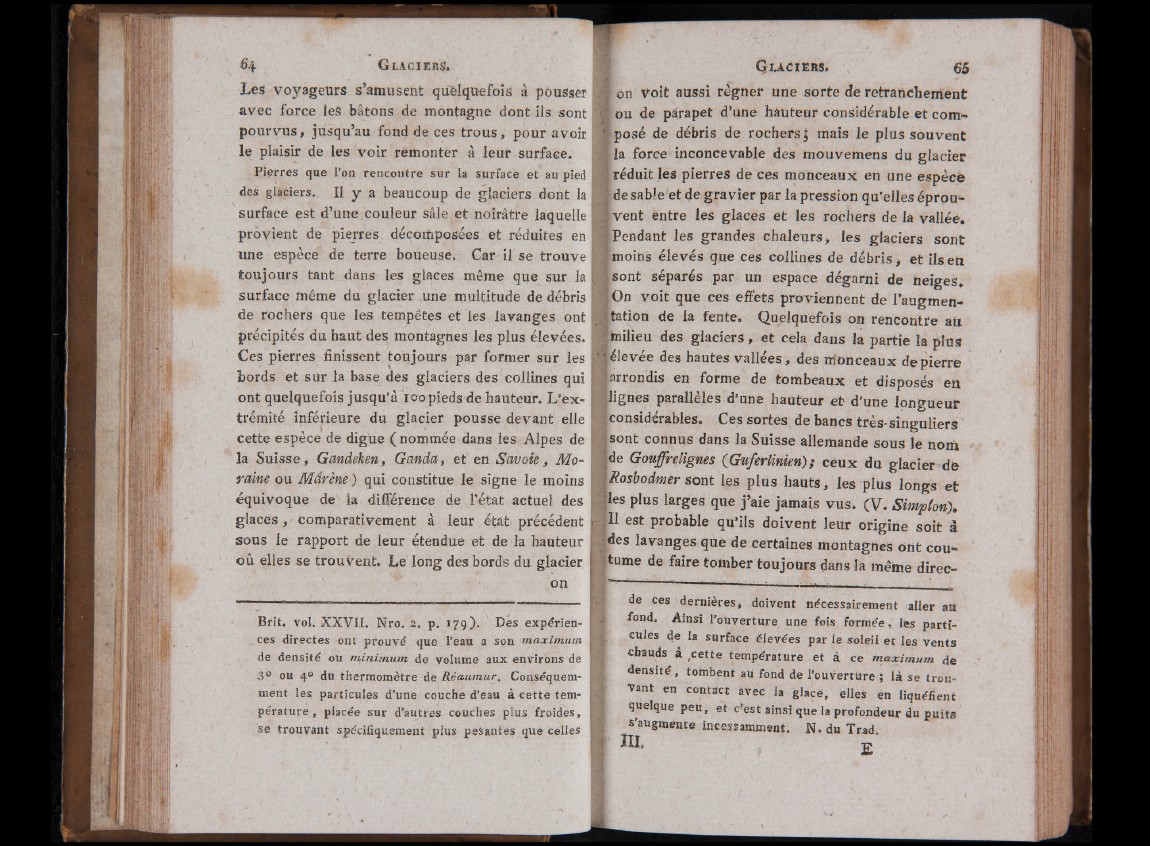
Les voyageurs s’amusent quelquefois à pousser
avec force les bâtons de montagne dont ils sont
pourvus, jusqu’au fond de ces trous, pour avoir
le plaisir de les voir remonter à leur surface.
Pierres que l’on rencontre sur la surface et au pied
des glaciers. Il y a beaucoup de glaciers dont la
surface est d’une couleur sâle et noirâtre laquelle
provient de pierres, décomposées et réduites en
une espèce de terre boueuse. Car il se trouve
toujours tant dans les glaces même que sur la
surface même du glacier une multitude de débris
de rochers que les tempêtes et les la van ges ont
précipités du haut des montagnes les plus élevées.
Ces pierres finissent toujours par former sur les
bords et sur la base des glaciers des collines qui
ont quelquefois jusqu’à 100 pieds de hauteur. L ’extrémité
inférieure du glacier pousse devant elle
cette espèce de digue (nommée dans les Alpes de
la Suisse, Gandeken, Ganda, et en Savoie, Moraine
ou Marène ) qui constitue le signe le moins
équivoque de la différence de l’état actuel des
glacés, comparativement à leur état précédent
sous le rapport de Jeur étendue et de la hauteur
où elles se trouvent. Le long des bords du glacier
on
Brit. .vol. X X V II. Nro. 2. p. 17 9 ) . Dés expériences
directes ont prouvé que l’eau a son maximum
de densité ou minimum de volume aux environs de
30 ou 40 du thermomètre de Réaumur. Conséqijem-
ment les particules d’unë couche d’eau à cette température,
placée sur d’autres, couèhes plus froides,
se trouvant spécifiquement plus pesantes que celles
I on voit aussi régner une sorte de retranchement
■ ou de parapet d’une hâuteur considérable et corn-
■posé de débris de rochers ; mais le plus souvent
I la force inconcevable des mouvemens du glacier
■ réduit les pierres de ces monceaux en une espèce
■de sable et de gravier par la pression qu’elles éprom*
■vent entre les glaces et les rochers de la vallée.
■Pendant les grandes chaleurs, les glaciers sont
■moins élevés que ces collines de débris, et ils eh
■ sont séparés par un espace dégarni de neiges.
■On voit que ces effets proviennent de l’augmentation
de la fente. Quelquefois on rencontre au
■taiilieu des glaciers, et cela, dans la partie la plus
■élevée des hautes vallées, des nibnceaux de pierre
■arrondis en forme de tombeaux et disposés eh
■lignes parallèles d’une hauteur et d’une longueur
■considérables* Ces sortes de bancs très-singuliers
■sont connus dans la Suisse allemande sous le nom
■de Gonfrelignes (Guferlinien)/ ceux du glacier de
ËKosbodmer sont les plus hauts, les plus longs et
■es plus larges que j ’aie jamais vus. (V. Simpton
II est probable qu’ils doivent leur origine soit à
■des lavanges que de certaines montagnes ont cou-
■tume de faire tomber toujours dans la même direcde
ces dernières, doivent nécessairement aller au
fond. Ainsi l’ouverture une fois formée, les particules
la surface élevées par le soleil et les vents
chauds à fcette température et à ce maximum de
densité, totnbent aü fohd de l’ouverture ; là se trouvant
en contact avec la glace, elles en liquéfient
quelque peu, et c’est ainsi que la profondeur du puits
s’augmente incessamment. N . du Trad.
III. g