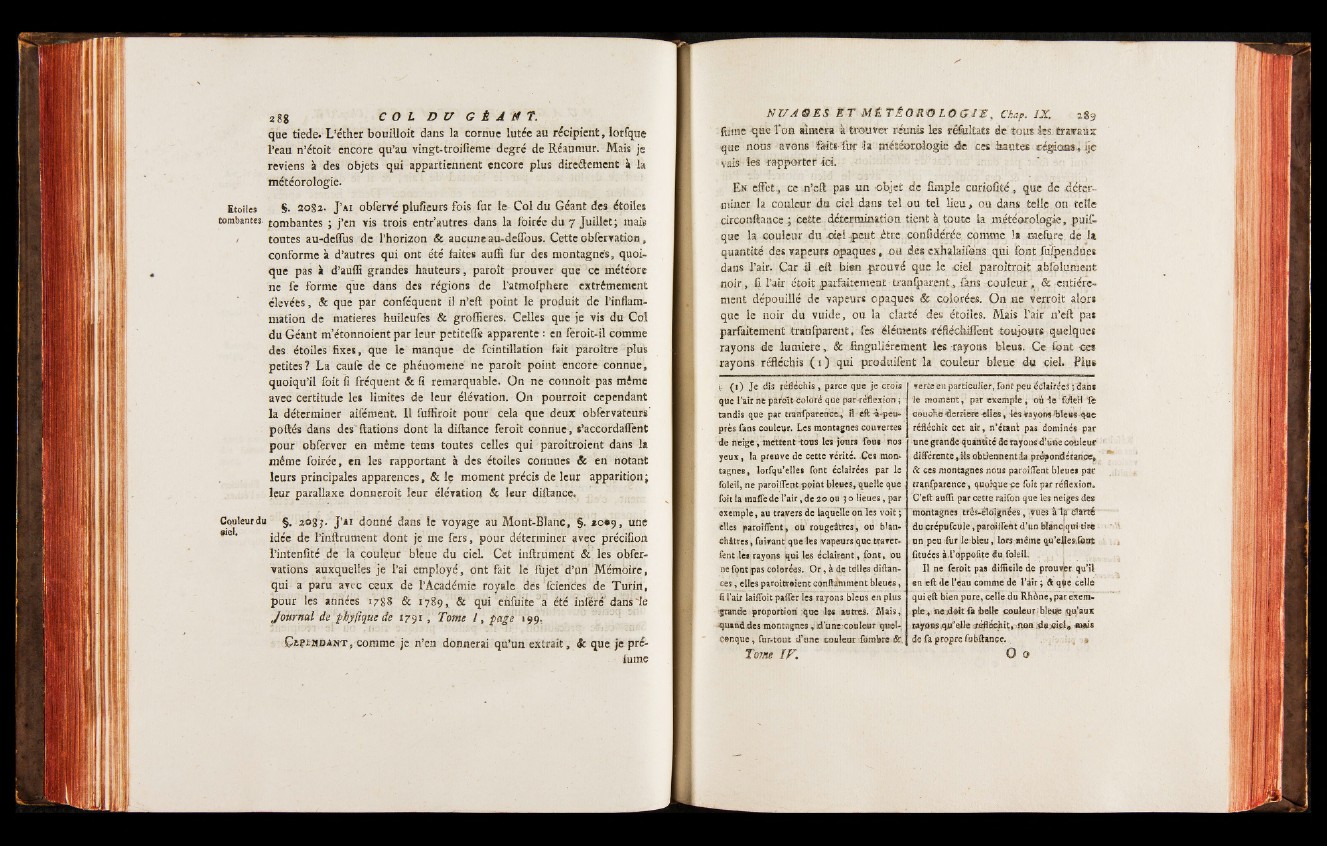
288 C O L D U G É A N T .
que tiede. L’éther bouilloit dans la cornue lutée au récipient, lorfque
l’eau n’étoit encore qu’au vingt-troifieme degré de Réaumur. Mais je
reviens à des objets qui appartiennent encore plus direélement à la
météorologie.
Etoiles S- 2082. J’ai obfervé plufieurs fois fur le Col du Géant des étoiles
tombantes, tombantes ; j’en vis trois entr’autres dans la foirée du 7 Juillet; mais
/ toutes au-deifus de l’horizon & aucune au-deffous. Cette obfervation,
conforme à d’autres qui ont été faites aufli fur des montagnes, quoique
pas à d’auffi grandes hauteurs , parait prouver que ce météore
ne fe forme que dans des régions de l’atmofpherc extrêmement
élevées, & que par conféquent il n’eft point le produit de l'inflammation
de matières huileufes & groffieres. Celles que je vis du Col
du Géant m etonnoient par leur petiteife apparente : en feroit-il comme
des étoiles fixes, que le manque de fcintillation fait paroitre plus
petites? La caufe de ce phénomène ne paroit point encore connue,
quoiqu’il foit fi fréquent & fi remarquable. On ne connoit pas même
avec certitude les limites de leur élévation. On pourrait cependant
la déterminer aifément. 11 fuffiroit pour cela que deux obfervateurs
portés dans des" dations dont la diftance feroit connue, s'accordaient
pour obferver eh même tems toutes celles qui paroitroient dans la
même foirée, en les rapportant à des étoiles connues & en notant
leurs principales apparences,& le moment précis de Jeur apparition;
leur parallaxe donnerait leur élévation & Jeur diftance.
Couleur du §. 2081- J’a i donné dans le voyage au Mont-Blanc, §. *0*9, une
idée de l’inftrument dont je me fers, pour déterminer avec précifion
l’intenfité de la couleur bleue du cieL Cet inftrument & les obfer-
vations auxquelles je l’ai employé, ont fait le fùjet d’un Mémoire,
qui a paru avec ceux de l’Académie royale des'fciences de Turirt,
pour les années 1788 & 1789, & qui enfuite a été inféré dans "le
Journal de phyftque de 1791, Tome l , pagè iyg.
ÇiftNDAN'r, comme je n’en donnerai qu’un extrait, & que je prélume
N U A G E S E T M É T É O R O L O G I E , Ckap. IX . 289
fëme que l’on aimera à trouver réunis les résultats de tous les, travaux
que nous avons faits-fur ¡1 à météorologie de ces hautes régions, ije
vais les rapporter id .
En effet, ce n’eft pas un -objet de fimple curiofité, que de déterminer
la couleur du ciel dans tel ou tel lieu, ou dans telle ou telle
circonftance ; cette détermination tient à toute la météorologie, puif-
que la couleur du ciel ¡peut être confidérée comme la ¡mefure de la
quantité des vapeurs opaques, ou des exhalaifans qui font fujpendu.es
dans l’air. Car il eft bisn prouvé que le -ciel paraîtrait abfolumeut
noir, fi l’air étoit parfaitement ti'anlpar.ent, fans-couleur, & entièrement
dépouillé de vapeurs opaques & colorées. On ne verrait alors
que le noir du vuide, ou la clarté des étoiles. Mais fair n’eft pas
parfaitement traniparent, fes éléments réfléchiflènt -toujours quelques
rayons de lum iè r e& finguüérement les rayons bleus. Ce font ces
rayons réfléchis ( 1 ) qui produifent la couleur bleue du ciel. Elus
i;. (1) Je dis réfléchis , parce que je crois
que l’air ne paroîteotoré qüe par réflexion ;
tandis que par tratrfpârence, il eft -à-peu-
près fans coulent. Les montagnes couvertes
de neige, metttnt-toos les jours fous nos
jeux, la preuve de cette vérité. Ces montagnes,
lorfqu’elles font éclairées par le
foleil, ne paroi (Tent point bleues, quelle que
foit la înaffe de l’air, de 20 ou 5 o lieues, par
exemple, au travers de laquelle on les volt ;
elles paroiflent, ou rougeâtres, ou blanchâtres,
fuiront que les -vapeurs que traver.
lent les rayons qui les éclairent , font, ou
ne font ¡pas colorées. Or, à de tdlles disantes
, elles paroitreient canftamment bleues,
fi l’air laiifoit palier les rayons bleus en plus
-grande proportion que les antres. Mais,
quand des montagnes, dune-couleur quelconque
, fur-tout d’une couleur {ombre Sc.
Tome IF .
verte en particulier, font peu éclairées ; dan*
le moment, par exemple, ou ïe Fotar! 'fe
couche 'derrière -elles, les «ayons %le«s que
réfléchit cet air, n'étant pas dominés par
une grande quantité de rayons d’ut»e couleur
différente,ils obtiennentia prépondérance^
Sc ces montagnes nous paroiifent bleues par
transparence, quoique ce foit par réflexion.
C’eft aufti par cette raifon que les neiges des
montagnes trés-élolgn'ées, .vues àla datté
du crépufcule, paroiifent d’un biane qui dre
un peu fer le bleu, Lors même qu’eUlesTont
fituces à-l’oppofite du foleil.
Il ne feroit pas difficile de prouvjer. qu’il
en eft de l’eau comme de i’àir ; Sc que celle
qui eft bien pure, celle du Rhône, par exemple.,
ne idolt fa belle couleur . bleuie qu’aux
rayons qu’elle réfléchit, non du ciel, ««us
de fa propre fubftance. . . .; s»