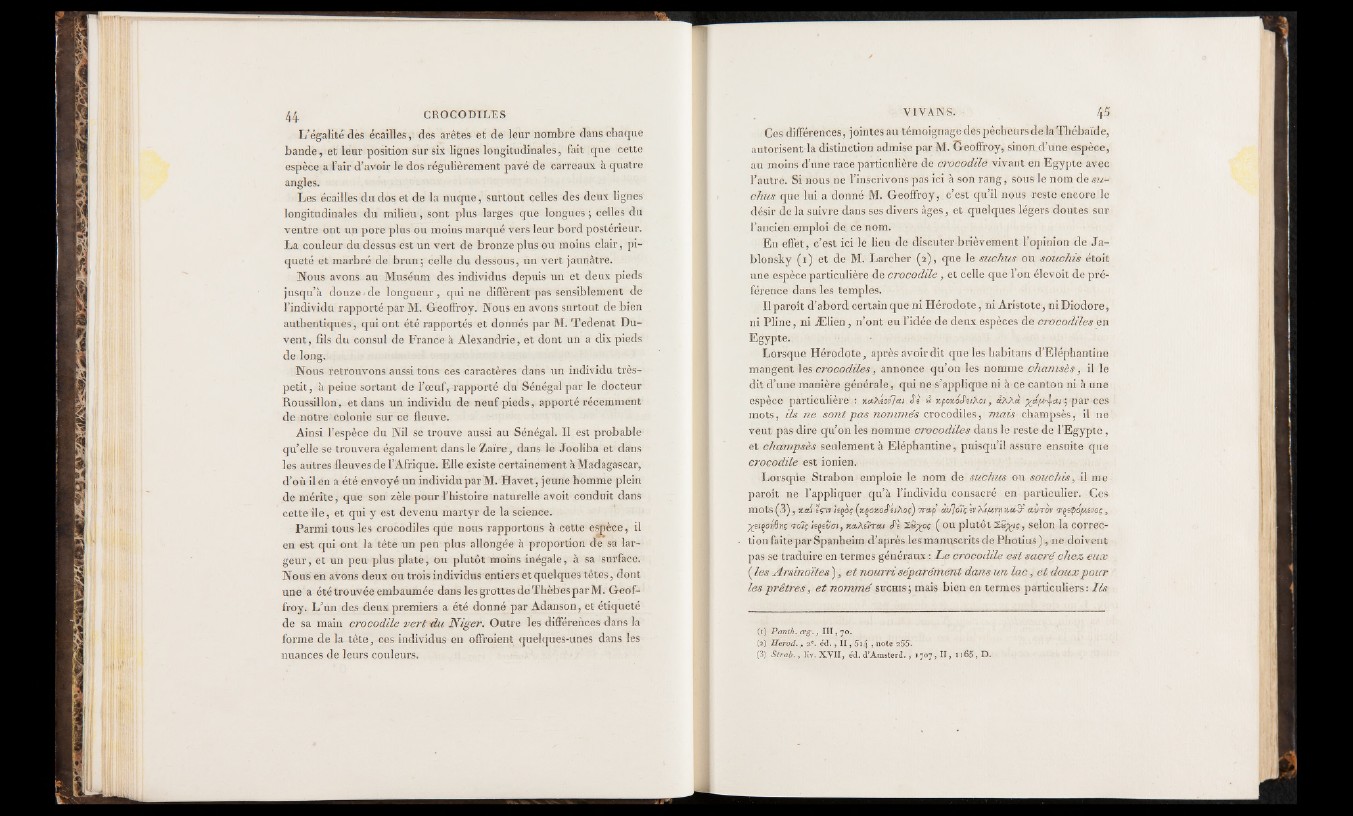
L ’égalité dès écailles, des arêtes et de leur nombre dans chaque
bande, et leur position sur six lignes longitudinales, fait que cette
espèce a l’air d’avoir le dos régulièrement pavé de carreaux à quatre
angles.
Les écailles du dos et de la nuque, surtout celles des deux lignes
longitudinales du milieu, sont plus larges que longues ; celles du
ventre ont un pore plus ou moins marqué vers leur bord postérieur.
La couleur du dessus est un vert de bronze plus ou moins clair, piqueté
et marbré de brun; celle du dessous, un vert jaunâtre.
Nous avons au Muséum des individus depuis un et deux pieds
jusqu’à douze'de longueur, qui ne diffèrent pas sensiblement de
l ’individu rapporté par M. Geoffroy. Nous en avons surtout de bien
authentiques , qui ont été rapportés et donnés par M. Tedenat Du-
vent, fils du consul de France à Alexandrie, et dont un a dix pieds
de long.
Nous retrouvons aussi tous ces caractères dans un individu très-
petit, à peine sortant de l’oeuf, rapporté du Sénégal par le docteur
Roussillon, et dans un individu de neuf pieds, apporté récemment
de notre Colonie sur ce fleuve.
Ainsi l’espèce du Nil se trouve aussi au Sénégal. Il-est probable
qu’elle se trouvera également dans le Zaïre, dans le Jooliba et dans
les autres fleuves de l’Afrique. Elle existe certainement à Madagascar,
d’où il en a été envoyé un individu par M. Havet, jeune homme plein
de mérite, que son zèle pour l’histoire naturelle avoit conduit dans
cette île, et qui y est devenu martyr de la science.
Parmi tous les crocodiles que nous rapportons à cette espèce, il
en est qui ont la tête un peu plus allongée à proportion de sa largeur,
et un peu plus plate, ou plutôt moins inégale, à sa surface.
Nous en avons deux ou trois individus entiers et quelques têtes, dont
une a été trouvée embaumée dans les grottes de Thèbes par M. Geoffroy.
L ’un des deux premiers a été donné par Adanson, et étiqueté
de sa maiu crocodile vert -du Niger. Outre les différences dans la
forme de la tête, ces individus en offroient quelques-unes dans les
nuances de leurs couleurs.
Ces différences, jointes au témoignage des pêcheurs de la Thébaïde,
autorisent la distinction admise par M. Geoffroy, sinon d’une espèce,
au moins d’une race particulière de crocodile vivant en Egypte avec
l’autre. Si nous ne l’inscrivons pas ici à son rang, sous le nom de su-
chus que lui a donné M. Geoffroy,.c’est qu’il nous reste encore le
désir de la suivre dans ses divers âges, et quelques légers doutes sur
l’ancien emploi de. ce nom.
En effet, c’est ici le lieu de discuter brièvement l’opinion de Ja-
blonsky (1) et de M. Larcher (2), que le suchus ou souchis était
une espèce particulière de crocodile, et celle que l’on élevoit de préférence
dans les temples.
Il paroît d’abord certain que ni Hérodote, ni Aristote, niDiodore,
ni Pline, ni Ælien, n’ont eu l’idée de deux espèces de crocodiles en
Egypte.
Lorsque Hérodote, après avoir dit que les habitans d’Eléphantine
mangent les crocodiles, annonce qu’on les nomme chamsès, il le
dit d’une manière générale, qui ne s’applique ni à ce canton ni à une
espèce particulière : xatâovjai i l ê -Ætoy.6Sn/ct, à/./.ri ; par ces
mots, ils ne sont pas nommés crocodiles, mais champsès, il ne
veut pas dire qu’on les nomme crocodiles dans le reste de l ’Egypte,
et champsès seulement à Eléphantine, puisqu’il assure ensuite que
crocodile est ionien.
Lorsqde Strabon emploie le nom de suchus ou souchis, il me
paroît ne l’appliquer qu’à l’individu consacré en particulier. Ces
mots (3), y, ait êçw bfjàç (ypcxûSiiXoç) vrap lujoïç h'/su-vp yctir av-rcv Tçitpo/amç,
XeiçoitQtiç ’totçieçevcn, julM‘ï-rai àl (ou p l u t ô t s e l o n la correction
faite par Spanheim d’après les manuscrits de Photius), ne doivent
pas se traduire en termes généraux : L e crocodile est sacré chez eux
| les Arsinoïtes ) , et nourri séparément dans un lac } etd ou xp ou r
les p rêtres, e t nommé strcms; mais bien en termes particuliers: I ls 1 2 3
(1) Panth. ceg., III, 70.
(2) Herod., 2e. éd., I I , 5i 4 > note 255.
(3) Strab., liv. X Y I I , e'd. d’A m s t e r d . 1.707, I I , i i6 5 , D.