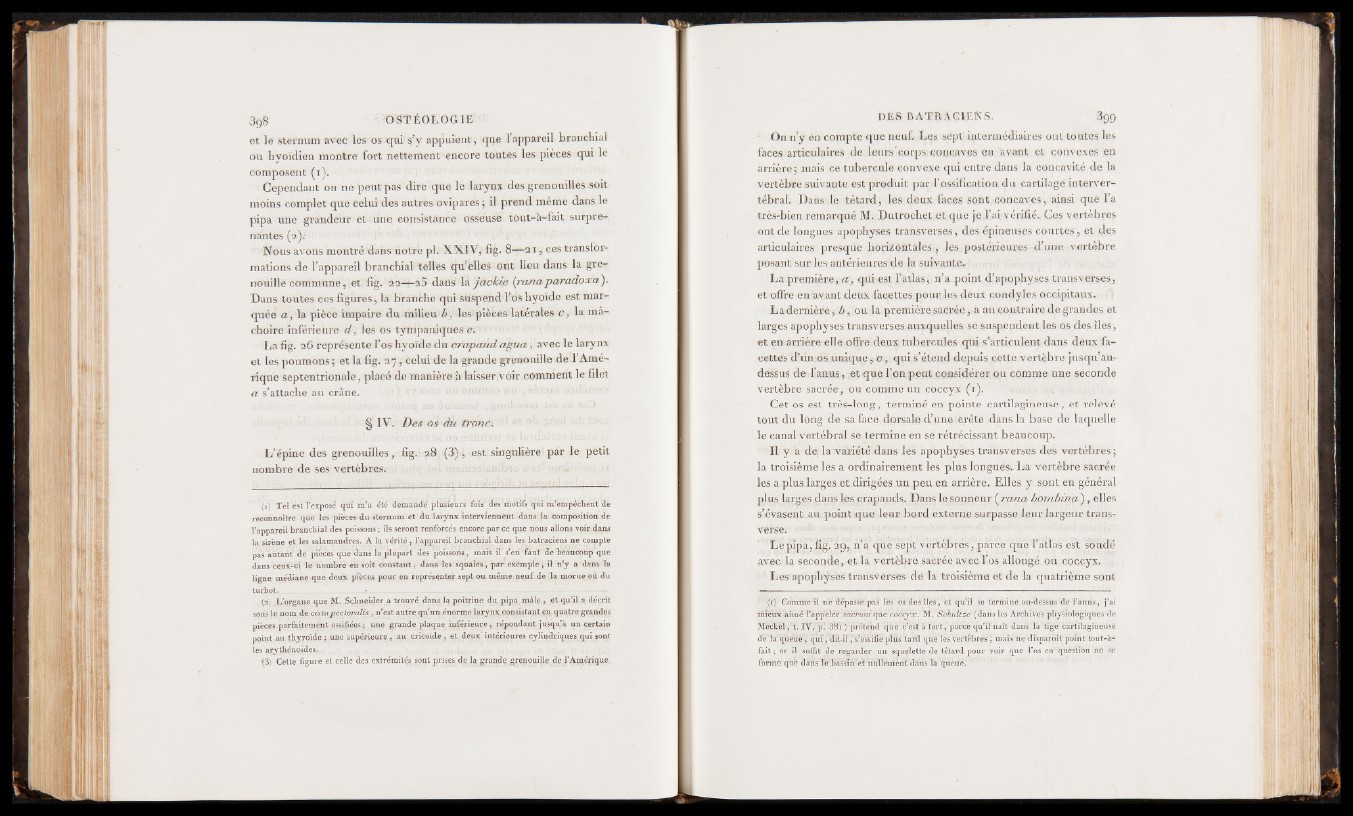
et le stermim avec les os qui s’y appuient, que l’appareil branchial
ou hyoïdien montre fort nettement encore toutes les pièces qui le
composent (i).! s 1
Cependant on ne peut pas dire que le larynx des grenouilles soit
moins complet que celui des autres ovipares ; il prend même dans le
pipa une grandeur et une consistance osseuse tout-a-fait surprenantes
(2).-
Nous avons montré dans notre pl. XXIV/'fig. 8— 21, ces transformations
de l’appareil branchial telles qu’elles ont lieu dans la grenouille
commune, et fig. 22—25 dans la jachie (ranaparadoxa).
Dans toutes ces ligures, la branche qui suspend l’os hyoïde est marquée
a , la pièce impaire du milieu b| les pièces latérales c , la mâchoire
inférieure d , les os tympaniques e.Bf
La fig. 26 représente l’os hyoïde du crapaud agua , avec le larynx
et les poumons ; et la fig. 27, celui de la grande grenouille de l’Amérique
septentrionale, placé de manière à laisser voir comment le filet
a s’attache au crâne.
§ IV. Des os du tronc:
L ’épine des grenouilles, fig.-28 (3)*j est singulière par le petit
nombre de ses vertèbres; *2
' (i) Tel est l’exposé c|uï m’a été demandé plirsieürS''fdis aes motits qai m’empêchent de
reeonnoître que les pièces'du sternum et du larynx interviennent dans la; composition de
l’appareil branchial des poissons ; ils seront renforcés encore par ce que nous allons voir.dans
la sirène et les salamandres. A la vérité, l’appareil branchial dans les batraciens ne compte
pas autant de pièces que dans la plupart dès poissons , mais il s’en faut de beaucoup que
dans ceux*ci le nombre en soit constant; dans les squales, par exemple’, il n’y a dans la
ligne médiane que deux pièces pour en représenter sept ou même neuf de la morue où du
turboL_________ __•_______
(2) .L’qrgane que M. Schneider a trouvé dans la poitrine dp pipa, miale, et qu’il a décrit
sous le nom de cistapectoralesn’est autre qu’un énorme larynxfçpnsis.tant, en quatre grandes
pièces parfaitement ossifiées.; une grande plaque, inférieure y répondant jusqu’à un certain
point au thyroïde ; une supérieure , au criçoïde , -et deu* inférieures cylindriques,qui sont
les arythénoïdes.,
^3) Cette figure et celle des extrémités sont pris^Sjd,e.la grande g^pppille de l’Amérique.
■ On n’y en compte que neuf. Les Sjépt intermédiaires ont toutes les
faces articulaires de leurs corps-concaves en ayant et convexes en
arrière ; mais ce tubercule convexe qui entre dans la concavité de la
vertèbre suivante est produit par l’ossification du cartilage intervertébral.
Dans le têtard, les deux faces sont concaves, ainsi que l’a
très-bien remarqué M. Dutrochet et que je Lai vérifié. Ces vertèbres
ont de longues apophyses transverses, des épineuses courtes, et des
articulaires presque horizontales,, les postérieures d’une vertèbre
posant sur les antérieures de la suivante.
La première, a, qui est l’atlas,,n’appoint d’apophyses transverses,
et offre en avant deux facettes pour les deux condyles occipitaux. |
La dernière, b, ou la première sacrée, a au contraire de grandes, et
larges apophyses transverses auxquelles se suspendent les os des îles,
et en arrière elle,offre deux tubercules qui s’articulent dans deux facettes
d’un osuniquer e , quis’étend depuis cette vertèbre jusqu’au-
dessus de l’anus, et que l’on peut considérer ou comme une seconde
vertèbre sacrée, ou comme un coccyx (i).
Cet os est très-long, terminé en pointe cartilagineuse, et relevé
tout du long de sa face dorsale d’une.ë.rêtè dans la base dé laquelle
le canal vertébral se termine en se rétrécissant beaucoup.
Il y à de la variété dans les apophyses transverses des vertèbres;
la troisième les a ordinairement les plus longues. La vertèbre sacrée
les a plus larges et dirigées un peu en arrière. Elles y sont en général
plus larges dans les crapauds. Dans le sonneur ( rana bombina) , elles
s’évasent au point que leur bord externe surpasse leur largeur trans-
verve. - 1
Le pipa, fig, 29, n’a que sept vertébrés, parce que l’atlas est soudé
avec la seconde , et la vertèbre sacrée avec Vos allongé ou coccyx.
Les apophyses transvêrses de la troisième et de la quatrième sont
‘ “(’1') Gomme îl aa^'-fi^àsseipas les 6s des lies , et qu’il s'e terminé au-dessus de l’anus, j’ai
mieuxiaimë i ’àppelërsacrinn que "cobcyx: M. Schultze (dans les Archives physiologiques de
Meckel, t. IV , p. ;fi8r) prétend que c’est à tort, parce qu’il naît dans la tige cartilagineuse
de la queue ^ qui, dit-ils’ossifié pl iis tard que les vertèbres) mais nedïsparoîtpoint tout-à-
fait ; or il suffit de regarder un squelette de têtard pour voir que l’os en question ne se
forme' que dans Te Bassïn^et nullement dans la qUeuè.