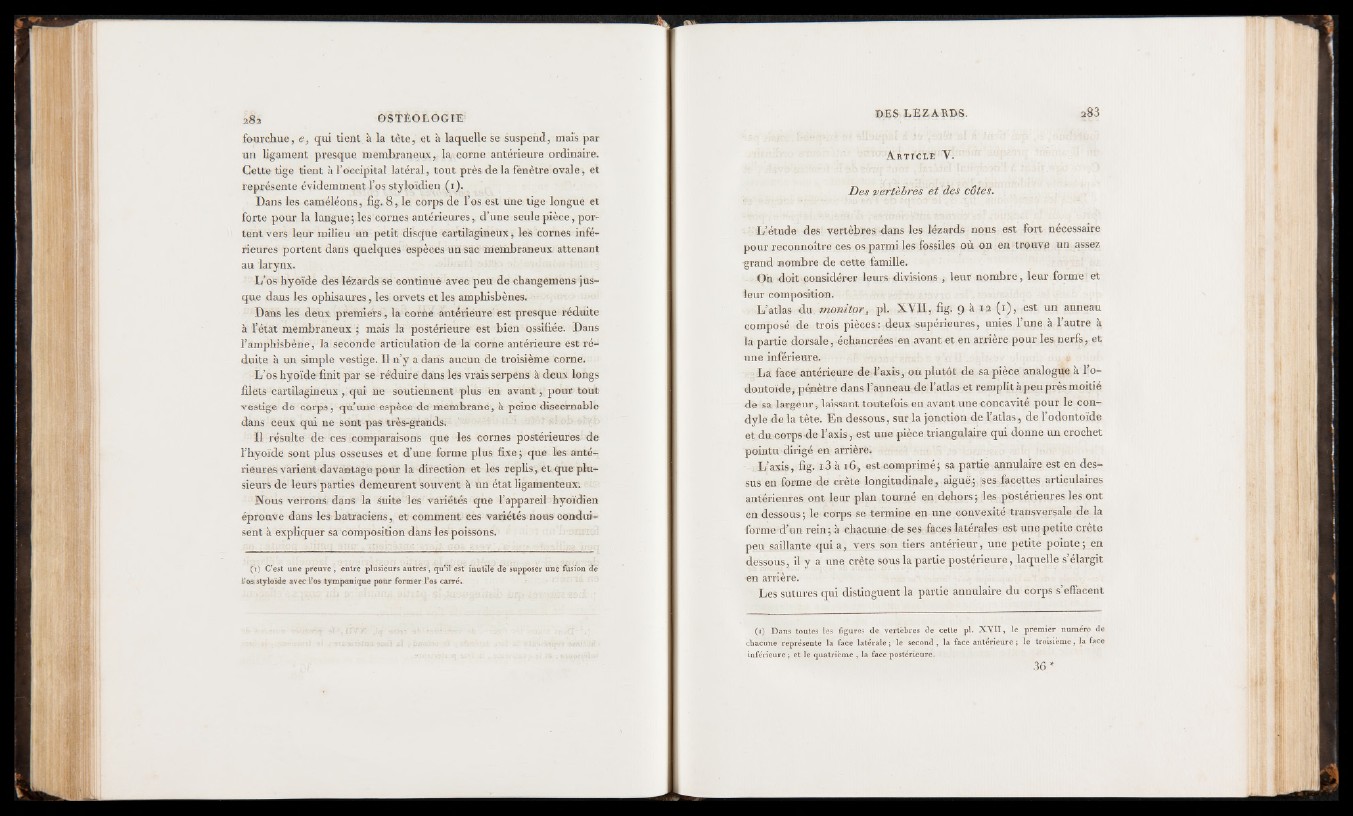
fourchue, e , qui tient à la tête, et à laquelle se suspend, mais par
un ligament presque membraneux, la.,corne antérieure ordinaire.
Cette tige tient à l’oiceipital latéral, tout près de la fènêtre ovale, et
représente évidemment l’os styloïdien (1).
Dans les caméléons, fig. 8, le corps de l’os est une tige longue et
forte pour la langue ; les cornes antérieures, d’une seule pièce, portent
vers leur milieu un petit disque cartilagineux ■, les cornes inférieures
portent dans quelques espèces un sac membraneux attenant
au larynx.
L ’os hyoïde des lézards se continue avec peu de changemens jusque
dans les ophisaures, les orvets et les amphisbènes.
Dans les deux premiers, la corne antérieure, est presque réduite
à l’état membraneux ; mais la postérieure est bien ossifiée. Dans
l’amphisbène, la seconde articulation de la corne antérieure est réduite
à un simple vestige. Il n’y a dans aucun de troisième corne.
L ’os hyoïde finit par se réduire dans les vrais serpens à: deux longs
filets cartilagineux , qui ne soutiennent plus en avant, pour tout
vestige de corps, quune espèce de membrane, à peine discernable
dans ceux qui ne sont pas très-grands.
Il résulte de ces comparaisons que les cornes postérieures dé
l’hyoïde sont plus osseuses et d’une forme plus fixe ; que lies antérieures
varient davantage pour la direction et les replis , et que plusieurs
de leurs parties demeurent souvent à un état ligamenteux.
Nous verrons; dans la suite les variétés que l'appareil hyoïdien
éprouve dans les batraciens, et comment ces variétés nous conduisent
à expliquer sa composition dans les poissons.
fi) C’ est une preuve , entre plusièurs autrés, qu’i î est inutile de supposer une fusion de
Vos styloïde avec l’os tympanique pour former l’os carré;
A r t i c l e Y.
Des vertébrés et des côtés.
L ’étude des vertèbres-dans les lézards nous est fort nécessaire
pour reconnoître ces os parmi les fossiles où on en trouve un assez
grand nombre de cette famille.
Oh -doit considérer leurs divisions , leur nombre, leur forme et
leur composition.
L’atlas du monitor, pl. X V II , fig; 9 à 12 (1), est un anneau
composé de trois pièces; deux supérieures, unies l’une à l’autre à
la partie dorsale, échancrées en avant et en arrière pour les nerfs, et
une inférieure.
La feoe antérieure de l’axis, ou plutôt de sa pièce analogue à l’odontoïde,
pépètre dans l’anneau de l’atlas et remplit à peu près moitié
de sa largeur, laissant toutefois en avant une concavité pour le con-
dyle de la tête. En dessous, sur la jonction de l’atlas, de l’odontoïde
et du corps de l’axis, est une pièce triangulaire qui donne un crochet
pointu dirigé en arrière.
L ’axis, fig. 1-3 à 16, est comprimé; sa partie annulaire est en dessus
en forme de crête longitudinale, aiguë; ^es facettes articulaires
antérieures ont leur plan tourné en dehors; les postérieures les ont
en dessous; le corps se termine en une convexité transversale de la
forme d’un rein; à chacune-de ses faces latérales est une petite crete
peu saillante qui a , vers son tiers antérieur, une petite pointe ; en
dessous, il y a une crête sous la partie postérieure, laquelle s’élargit
en arrière.
Les sutures qui distinguent la partie annulaire du corps s’effacent
. ( ÿ Dans toutes les figures de vertèbres de cette pl. X V I I , le premier numéro de
chacune représente la face latérale ; le second , la face antérieure ; le troisième , la face
inférieure ; et le quatrième , la face postérieure.