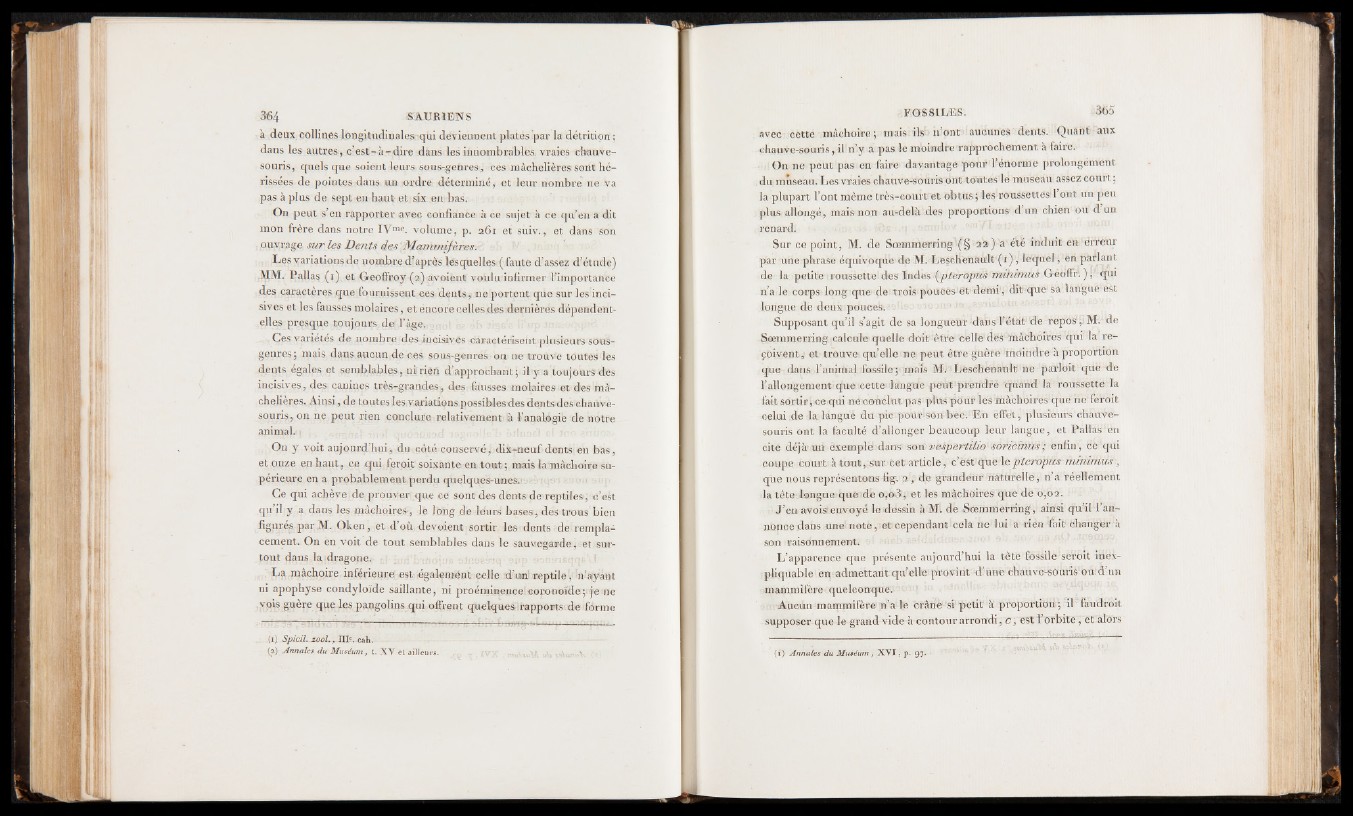
à deux collines longitudinales qui deviennent plates'par la détrition ;
dans Les autres, c’est-à-dire dans les innombrables, vraies chauve-
souris, quels que soient leurs sous-genres, ces mâchelières sont hérissées
de pointes; dans un ordre déterminé, et leur nombre ne va
pas à plus de sept en haut et six en bas,
On peut s’en rapporter avec confiance à ce sujet à ce qu’en a dit
mon frere dans notre IVmc. volume, p. 261 et suiv., et dans son
ouvrage sur les Dents des Mammifères.
Les variations de nombre d’après lesquelles«^'faute d’assez d’étude)
MM. Pallas (1) et Geoffroy (a) avoient voulu infirmer l’importance
des caractères que fournissent ces dents, ne portent que sur les incisives
et les fausses molaires, et encore celles des dernières dépendent-
elles presque toujours de l’âge. - .
. . Ces variétés de nombre des incisives-caractérisent plusieurs sous-
genres ; mais dans.aucun de ces sous-genres on ne trouve toutes les
dents égales et semblables, ni rien d’approchant; il y a toujourSdes
incisives, des canines très-grandes, des fausses molaires et des mâchelières.
Ainsi, de toutes lesva-riations possibles des dentsdes chauve-
souris, on ne peut rien conclure relativement & l’analogie de notre
animal, j
On y voit aujourd’hui, du côté conservé,: dixeneuf dents-en bas,
et onze en haut, ce qui fproit soixante en tout ; mais la mâchoire supérieure
en a probablement perdu quelques-unes.
Ce qui achève de prouver que ce sont des dènts de reptiles>,-C’est
qu’il y a dans les mâchoires-, le long de léurs bases-, des trous bien
figurés par M. Oken, et d’où devaient sortir les dents de remplacement.
On en voit de tout semblables dans le sauvegarde, et surtout
dans la dragone. -
La mâchoire, inferieure est; légalement celle d’un reptile. n’ayant
ni apophyse condyloïde saillante, ni proéminenceîeoronoïdepjeme
vois guère que Les pangolins qui offrent quelquesirapports de forme
_(i) Spicil. t&ool., IIIe, cah.
(a) Annales du Muséum, t. XV et ailleurs.
avec cette mâchoire; mais ibl h’ont iaucunes dents. Quant aux
chauve-souris, il n’y a pas le mbindre rapprochement à -faire.
On ne peut pas en faire davantage pour l’énorme prolongement
du museau. Les vraies chauve-souris onttontes lu museau assez court;
la plupart l’ont même très-court1 et obtus ; les EOussettëS‘1 ont un peu
plus allongé, mais non au-delà des proportions d’un chien ’ou d un
renard.
Sur ce point, M. de Soemmerriüg''f§: 22 ) a'éW; induit en'érrèur
par une phrase équivoque de M. Lesctienaitlt ( t ) , lequel, en parlant
de la petite roussette des Indesi^pteroptis rniiiimuè G-édffr1. )} qui
n’a le corps long que (le troisytouees-'et-derni. dit ques.t langue esl
longue de deux poueek*
Supposant qu’il s’agit de sa longueur dansLëfât 'de -repodJ.'M. de
Soemmerring.calcule* quelle doit'être'celle'dës'-mâtthoires quir la reçoivent,*
et trouve-qu’elle ne peut être guère moindre à proportion
que dans l’animal fossile p mais M. Léschenault ne pal’loit que de
l’allongement quetîcette idngde peut prendre quand la roussette la
fait sortir , ce qui ne conclut pas pins pour lés mâchoires que ne ferait
celui .de la langue du pic pour son bec. F.n effet, plusieurs chàuve-
souris ont la faculté d’allonger beaucoup leur langue, et Pallas'en
cite déjà? un exemple* dans1 TtoT£»eipèrtilw'*6nô&ti>!i$ enfin, ce qui
coupe court; à tout, sur Cet article, c’est que le pteropùs rhimimisk,
que nous représentons fig. 2, de grandeur naturelle, n’a réellement
la tète longue;que de o.o t, et les mâchoires que de 0,02.
J’en avoistenvoyé le dessin à M. dè SeemmerringV ainsi qu’il l’an-
nonoedans une noté, ercependant cela ne lui-a rien fait changer à
son raisonnement.
L ’apparence que présente aujourd’hui la tête fossile serait inéx-
pliqùable en admettant (pi’elle provint d:une chauve-souris ou d'un
mammifère quelconque. 4
Aucun mammifère n’a le crâne si petit à proportion; il faudrait
supposer que le grand-vide à contour arrondi, c , est l’orbite, et alors
(f) Annales du Muséum, XVI, p. 97.