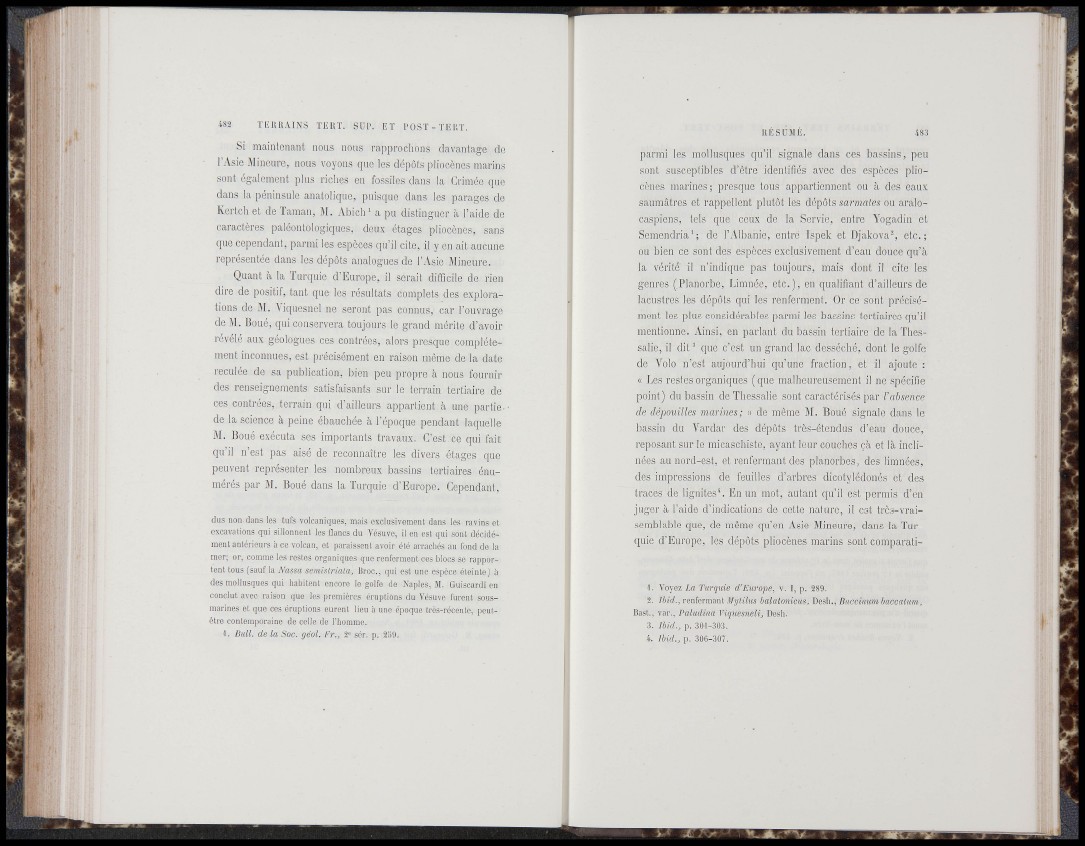
482 TIÍUKAINS TKUT. SUI'. ET l'OST-TEKT.
RÉSUMÉ. 4S3
Si maintenant nous nous rapprochons davantage de
l'Asie Mineure, nous voyons que les dépôts pliocenes marins
sont également plus riches en fossiles dans la Ciimée que
dans la peninsule anatolicjne, puisque dans les pai'ages de
Kertch et de Taman, M. Abich ' a pu distinguer à l'aide de
caractères paléontologiques, deux étages piiocènes, sans
que cependant, parmi les espèces qu'il cite, il y en ait aucune
représentée dans les dépôts analogues de l'Asie Mineure.
Quant à la Turquie d'Europe, il serait difficile de rien
dire de positif, tant que les résultats complets des exploi-ations
de JI. Yiquesnel ne seront pas connus, car l'ouvrage
de M. Boué, qui conservera toujours le grand mérite d'avoir
révélé aux géologues ces contrées, alors presque complètement
inconnues, est précisément en raison même de la date
reculée de sa publication, bien peu propre à nous fournir
des renseignements satisfaisants sur le teiTain tertiaire de
ces contrées, terrain qui d'ailleurs appartient à une partie--
de la science à peine ébauchée à l'époque pendant laquelle
M. Boué exécuta ses importants travaux. C'est ce qui fait
qu'il n'est pas aisé de reconnaître les divers étages que
peuvent représenter les nombreux bassins tertiaires énumérés
par ^L Boué dans la Turquie d'Europe. Cependant,
dus non dans les tufs volcaniques, mais exclusivement dans les ravins et
excavations qui sillonnent les flancs du Vésuve, il en est qui soni décidément
antérieurs à ce volcan, et paraissent avoir été arrachés au fond de la
mer; or, comme les restes organiques que renferment ces blocs se rapportent
tous (sauf la Nassa semislriala. Broc., qui est une espèce éteinte) à
des mollusques qui habitent encore le golfe de Naples, M. Guiscardi en
conclut avec raison que les premières éruptions du Vésuve furent sousmarines
et que ces éruptions eurent lieu à une époque très-récente, peutêtre
contemporaine de celle de l'homme.
•I. Bull, de la Soc. géol. Fr., sér. p. 239,
parmi les mollusques qu'il signale dans ces bassins, peu
sont susceptibles d'être idenlifiés avec des espèces piiocènes
marines; presque tous appartiennent ou à des eaux
saumâtres et rappellent plutôt les dépôts sarmale.s ou aralocaspiens,
tels que ceux de la Servie, entre Yogadin et
Semendria'; de l'Albanie, entré Ispek et Djakova^ etc.;
ou bien ce sont des espèces exclusivement d'eau douce qu'à
la vérité il n'indique pas toujours, mais dont il cite les
genres (Planorbe, Limnée, etc.), en qualifiant d'ailleurs de
lacustres les dépôts qui les renferment. Or ce sont précisément
les plus considérables parmi les bassins tertiaires qu'il
mentionne. Ainsi, en parlant du bassin tertiaire de la Thessalie,
il dit^ que c'est un grand lac desséché, dont le golfe
de Volo n'est aujourd'hui qu'une fraction , et il ajoute :
« Les restes organiques (cj;ue inalheureusement il ne spécifie
point) du bassin de Thessalie sont caractérisés i)ar l'absence,
de dépouilles marines; » de même M. Boué signale dans le
bassin du Vardar des dépôts très-étendus d'eau douce,
reposant sur le micaschiste, ayant leur couches çà et là inclinées
au nord-est, et renfermant des planorbes, des limnées,
des iinpressions de feuilles d'arbres chcotylédonés et des
traces de lignites^ En un naot, autant qu'il est permis d'en
jtjger à l'aide d'indications de cette nature, il est très-vraisemblable
que, de même qu'en Asie Mineure, dans la Turquie
d'Europe, les dépôts pliocenes marins sont comparati-
1. Voyez La Turquie d'Europe, v. I, p. 289.
2. Ibid., renfermant Mylilus balatonicus, Desh., Biiccinum baccalitm,
Bast., var., Paludina Yiquesneli, Desh.
3. Ibid., p. 301-303.
4. Ibid., p. 306-307.