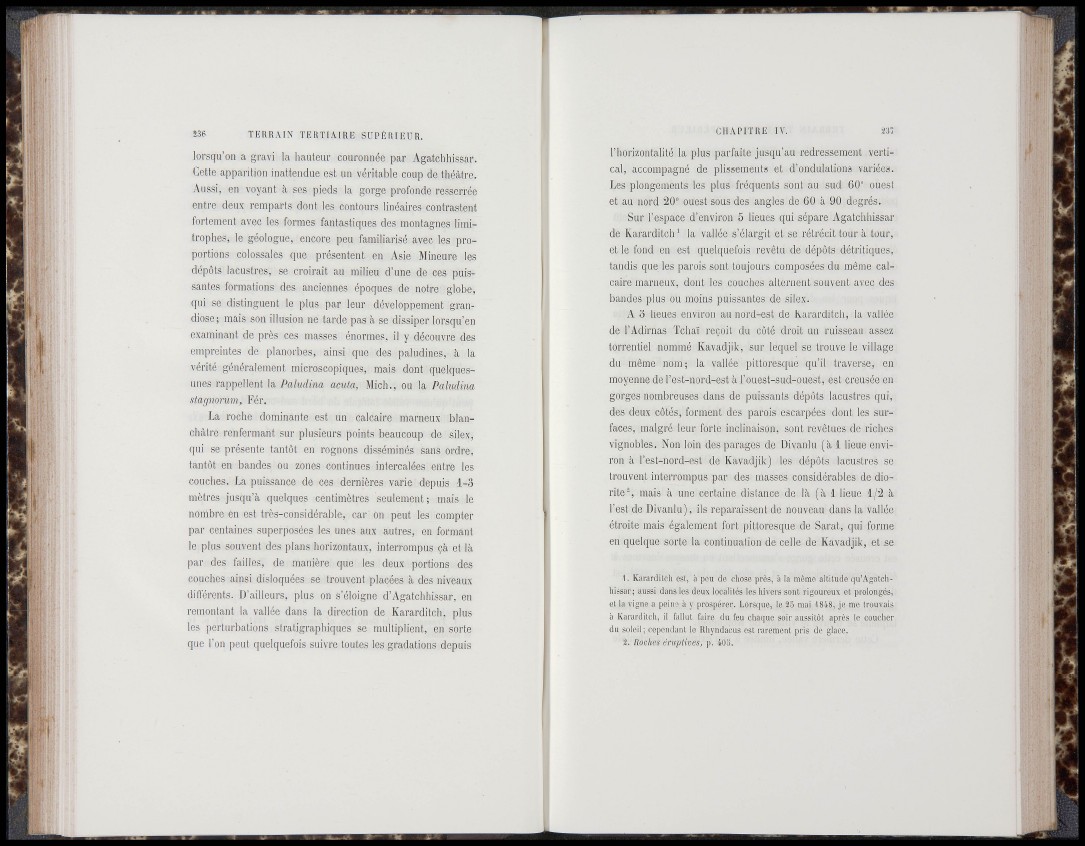
236 T E R R A I N TERTÍAIRE SUPÉRIEUR.
lorsqu'on a gravi la hauteur couronnée par Agatchhissar.
Cette apparition inattendue est un véritable coup de théâtre.
Aussi, en voyant cà ses pieds la gorge profonde resserrée
entre deux remparts dont les contours linéaires contrastent
fortement avec les formes fantastiques des montagnes limitrophes,
le géologue, encore peu familiarisé avec les proportions
colossales que présentent en Asie Mineure les
dépôts lacustres, se croirait au milieu d'une de ces puissantes
formations des anciennes époques de notre globe,
qui se distinguent le plus par leur développement grandiose;
mais son illusion ne tarde pas à se dissiper lorsqu'on
examinant de près ces masses énormes, il y découvre des
empreintes de planorbes, ainsi que des paludines, à la
vérité généralement microscopiques, mais dont quelquesunes
rappellent la Paluclina acula, Mich., ou la Paludina
stagnorum, Fér.
La roche dominante est un calcaire marneux blanchâtre
renfermant sur plusieurs points beaucoup de silex,
qui se présente tantôt en rognons disséminés sans ordre,
tantôt en bandes ou zones continues intercalées entre les
couches. La puissance de ces dernières varie depuis 1-3
mètres jusqu'à quelques centimètres seulement ; mais le
nombre en est très-considérable, car on peut les compter
par centaines superposées les unes aux autres, en formant
le plus souvent des plans horizontaux, interrompus çà et là
par des failles, de manière que les deux portions des
couches ainsi disloquées se trouvent placées à des niveaux
différents. D'ailleurs, plus on s'éloigne d'Agatchhissar, en
remontant la vallée dans la direction de Kararditch, plus
les perturbations stratigraphiques se multiplient, en sorte
que l'on peut quelquefois suivre toutes les gradations depuis
ij, i>
I t'
C H A P I T R E IV. iTi
l'horizontalité la plus parfaite jusqu'au redressement vertical,
accompagné de plissements et d'ondulations variées.
Les plongements les plus fréquents sont au sud 60° ouest
et au nord 20° ouest sous des angles de 60 à 90 degrés.
Sur l'espace d'environ 5 lieues qui sépare Agatchhissar
de Kararditch^ la vallée s'élargit et se rétrécit tour à tour,
et le fond en est quelquefois revêtu de dépôts détritiques,
tandis que les parois sont toujours composées du même calcaire
marneux, dont les couches alternent souvent avec des
bandes plus ou moins puissantes de silex.
A 3 lieues environ au nord-est de Kararditch, la vallée
de l'Adirnas Tchaï reçoit du côté droit un ruisseau assez
torrentiel nommé Kavadjik, sur lequel se trouve le village
du même nom; la vallée pittoresque qu'il traverse, en
moyenne de l'est-nord-est à l 'ouest-sud-ouest , est creusée en
gorges nombreuses dans de puissants dépôts lacustres qui,
des deux côtés, forment des parois escarpées dont les surfaces,
malgré leur forte inclinaison, sont revêtues de riches
vignobles. Non loin des parages de Divanlu (à i lieue environ
à l'est-nord-est de Kavadjik) les dépôts lacustres se
trouvent interrompus par des masses considérables de diorite%
mais à une certaine distance de là (à 1 lieue 1/2 à
l'est de Divanlu), ils reparaissent de nouveau dans la vallée
étroite mais également fort pittoresque de Sarat, qui forme
en quelque sorte la continuation de celle de Kavadjik, et se
\ . Karardilcli est, à peu de chose près, à la même allilude qu'Agatclihlssar;
aussi dans les deux localités les hivers sont rigoureux et prolongés,
et la vigne a peino à y prospérer. Lorsque, le 23 mai 1848, je me trouvais
à Kararditch, il fallut faire du feu chaque soir aussitôt après le coucher
du soleil; cependant le Rhyndacus est rarement pris de glace.
2. Roches éruptives, p. 405.