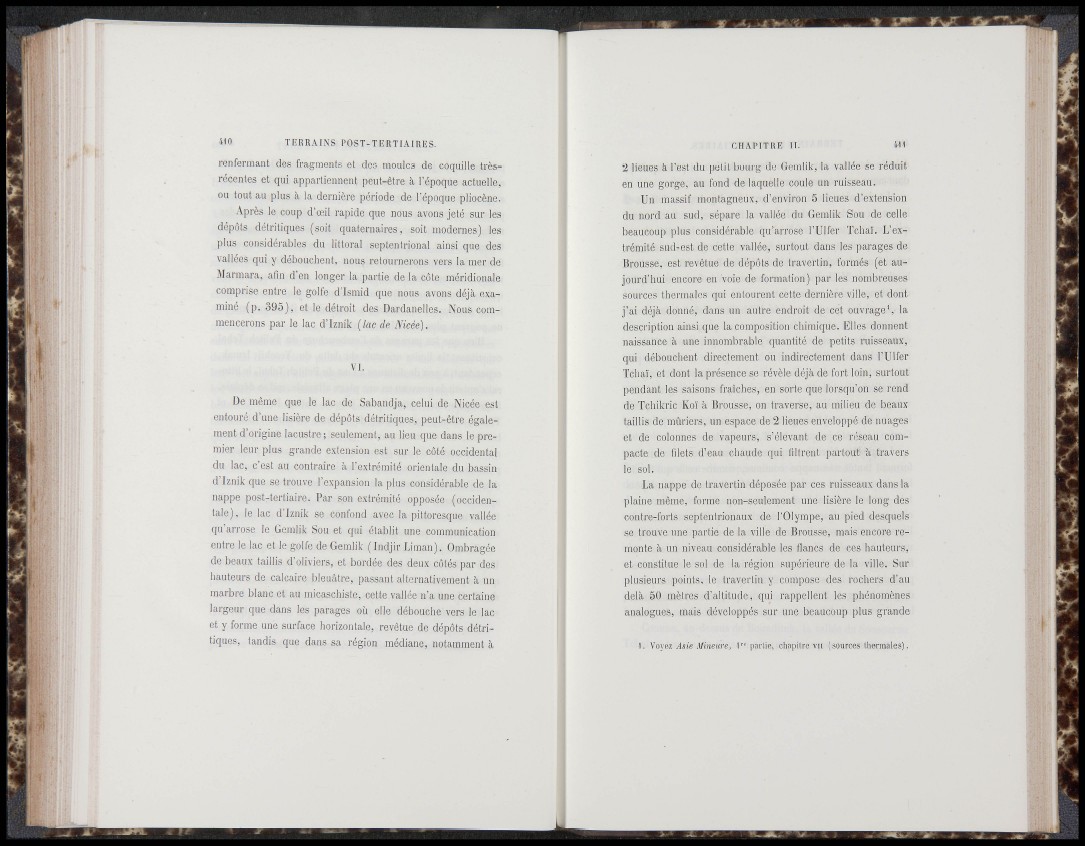
i:
i
I
410 TERRAINS POST-TERTIAIRES.
renfermant des fragments et des moules de coquille trèsrécentes
et qui appartiennent peut-être à l'époque actuelle,
ou tout au plus à la dernière période de l'époque pliocène.
Après le coup d'oeil rapide que nous avons jeté sur les
dépôts détritiques (soit quaternaires, soit modernes) les
plus considérables du littoral septentrional ainsi que des
vallées qui y débouchent, nous retournerons vers la mer de
Marmara, afin d'en longer la partie de la côte méridionale
comprise entre le golfe d'Ismid que nous avons déjà examiné
(p. 395), et le détroit des Dardanelles. Nous commencerons
par le lac d'iznik (lac de Nicée).
VI.
De même que le lac de Sabandja, celui de Nicée est
ejitouré d'une lisière de dépôts détritiques, peut-être également
d'origine lacustre; seulement, au lieu que dans le premier
leur plus grande extension est sur le côté occidental
du lac, c'est au contraire à l'extrémité orientale du bassin
d'Iznik que se trouve l'expansion la plus considérable de la
nappe post-tertiaire. Par son extrémité opposée (occident
a l e ) , le lac d'Iznik se confond avec la pittoresque vallée
qu'arrose le Gemlik Sou et qui établit une communication
entre le lac et le golfe de Gemlik (Indjir Liman). Ombragée
de beaux taillis d'oliviers, et bordée des deux côtés par des
hauteurs de calcaire bleuâtre, passant alternativement à un
marbre blanc et au micaschiste, cette vallée n'a une certaine
largeur que dans les parages où elle débouche vers le lac
et y forme une surface horizontale, revêtue de dépôts détritiques,
tandis que dans sa région médiane, notamment à
CHAPITRE II. 411
'i lieues à l'est du petit bourg de Gemlik, la vallée se réduit
en une gorge, au fond de laquelle coule un ruisseau.
Un massif montagneux, d'environ 5 lieues d'extension
du nord au sud, sépare la vallée du Gemlik Sou de celle
beaucoup plus considérable qu'arrose l'Ulfer Tchaï. L'extrémité
sud-est de cette vallée, surtout dans les parages de
Brousse, est revêtue de dépôts de travertin, formés (et aujourd'hui
encore en voie de formation) par les nombreuses
sources thermales qui entourent cette dernière ville, et dont
j'ai déjà donné, dans un autre endroit de cet ouvrage', la
description ainsi que la composition chimique. Elles donnent
naissance à une innombrable quantité de petits ruisseaux,
qui débouchent directement ou indirectement dans l'Ulfer
Tchaï, et dont la présence se révèle déjà de fort loin, surtout
pendant les saisons fraîches, en sorte que lorsqu'on se rend
de Tchikric Koï à Brousse, on traverse, au milieu de beaux
taillis de mûriers, un espace de 2 lieues enveloppé de nuages
et de colonnes de vapeurs, s'élevant de ce réseau compacte
de filets d'eau chaude qui tiltrent partout à travers
le sol.
La nappe de travertin déposée par ces ruisseaux dans la
plaine même, forme non-seulement une lisière le long des
contre-forts septentrionaux de l'Olympe, au pied desquels
se trouve une partie de la ville de Brousse, mais encore remonte
à un niveau considérable les flancs de ces hauteurs,
et constitue le sol de la région supérieure de la ville. Sur
plusieurs points, le travertin y compose des rochers d'au
delà 50 mètres d'altitude, qui rappellent les phénomènes
analogues, mais développés sur une beaucoup plus grande
1. Voyez Asie Mineure, I" partie, cliapitre vu (sources thermales).