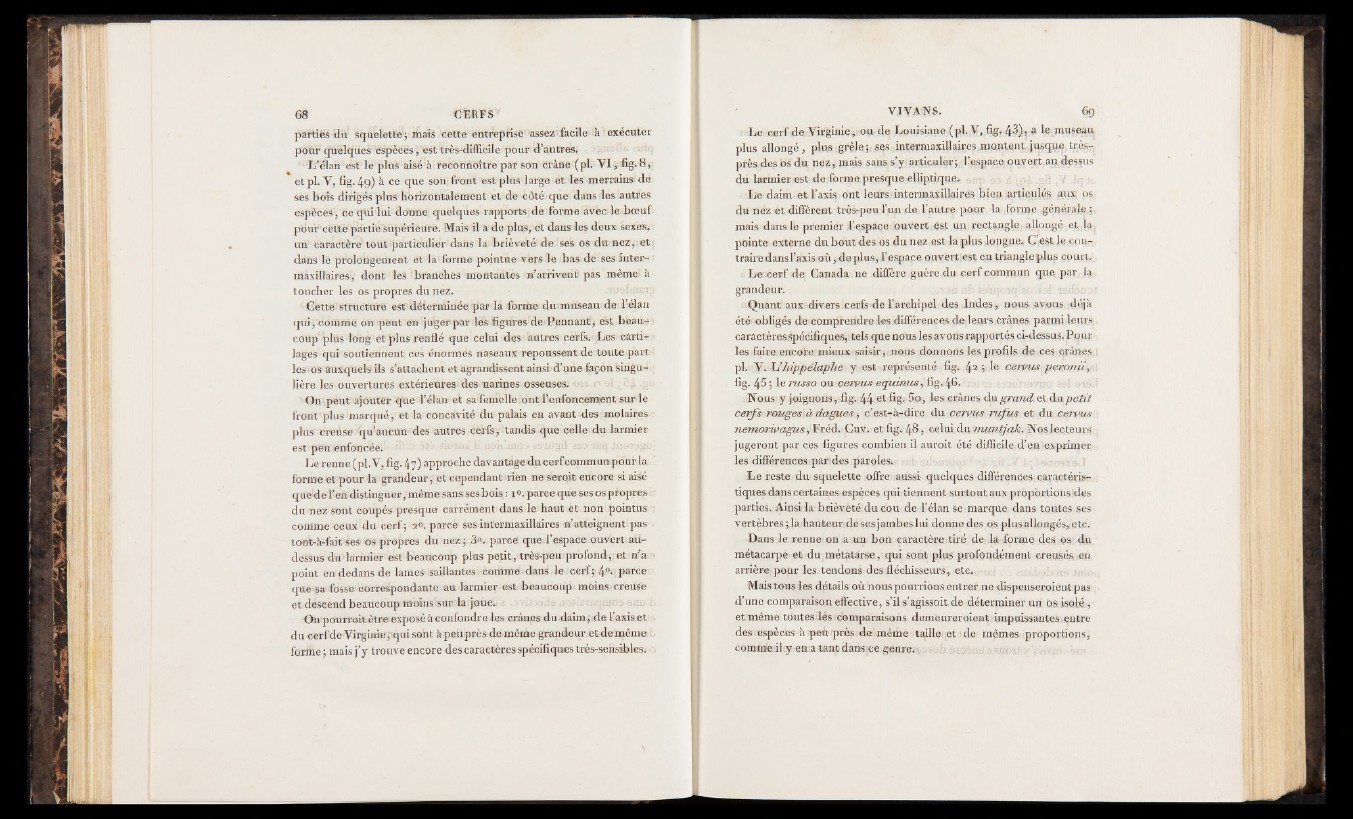
parties dû Squelette ; mais 'cette entreprise''assez facile à executer
pour quelques espèces, est très-difficile pour d’autres.
L ’ élan est le plus aise à reconnoître par son crâne (pl. V I , fig. 8,
etpl. V , fig. 49) â ce que son front est plus large et les merraîns de
ses bois dirigés plus horizontalement et de Côté que dans les autres
espèces*, ee qui lui doOne quelques rapports de forme avec le.boeuf
ptiur cette partie supérieure. Mais il a de plus, et dans les deux sexes,
un' caractère1 tout particulier dans la brièveté de ses os du nez, et
dans le prolongement et la forme pointue vers le bas de ses Snter-
màxillairesi, dont les'branches montantes n’arrivent pas même à
toucher les os propres du nez.
Gette structure est déterminée par la forme du museau de l’élan
qui, comme on peut en juger par lés figures de Pennant, est beaucoup
plus long"ét plus renflé que celui dqs • autres cerfsriLes' cartilages
qui soutiennent ces énormes naseaux repoussent de toute part
les os auxquels*ils s’attachent et agrandissent ainsi d’une façôn singulière
les ouvertures extérieures des narines; osseusesj ot
On peut ajouter que l’élan et .sa feniclle ont l’enfoncement sur le
front plus (marqué ,* et la concavité du palais en avant desgmolaires
plus creuse qu’aucun des autres cerfs ,^tandis que celle du larmier
est peu enfoncée.
Le renne (pl. Y , fig. 47) approche davantagedu cerfoommun pour-la
forme et pour la grandeur,' et cependant rien ne seroit encore si aise
que de l’en distinguer, même sans ses bois: i°. parce que sesos propres
du nez sont coupés presque carrément dans le haut vêt .non pointus
comme ceux du cerf ; 2°; parce ses intermaxillaires n’atteignent pas
tont-^faiOsés-os propres du nez,; fimparoeî queJ’espaoe.ouvert au-
dessus du larmier est beaucoup plus petit, très-peu profond;, et m?a
point en dedans de lames* saillantes : comme dans le J c ed f^ o parce
que’ sa fosse 'correspondante au larmier est beaucoup moins creuse
et descend beaucoup moins sur la joue.,
OaptfUrroitêtre'exposé àaronfondre les crànps dualaim pde l’axis et
du cerf de Virginie gqui sont à peu près, de même grandeur et de même f
forme ; mais j’y trouve encore des caractères spécifiques très-sensibles.
Le cerf de Virginie; ou de Louisiane (pl. Y, fig. 43), a le museau
plus allongé, plus grêle; ses intermaxillaires.montent jusque u;ès-
près des os du nez, mais san$:s’,y*articuler; l’espace ouvert au dessus
du larmier est de forme presque elliptique.
Le daim et l’axis ont leurs " intermaxillaires bien articulés aux os
du nez et diffèrent trèSj-peu l’un de l’autre, pour la Ifprme )générgje
mais dans le premier l’espace ouvert est un rectangle allongé et la.
pointe externe du bout des os du nez est la plus longue. C’cstleponr-.i
traire dans l’axis où, de plus, l’espace ouvertiest en triangle plus court.
Le cerf de Canada ne diffère guère du cerf commun ([un par la,
grandeur.
Quant aux divers cerls de l'archipel des Indes, nous, avons "déjjk
été, obligés de comprendre les différences de leurs crânes parmi leurs,
caractères Spécifiques, tels que nous les,avons rapportés ci-dessus. Pou#:
les faire encore mieux-saisir,,nous donnons les profils do,ces crânes,
pl. \v\Jfiippélaphc y est représenté fig. 42 ; le cetvus peronii,
fig. 45; le russo ou cervus e quinus >, fig. 46 • :
"Nous y joignons,.fig-., 44 et fig. 5a, les,crânes du grand et du,pâtit
cerfs rougesXà dagues, c’est-à-dire du çervus> n tfu s et du cerx’us
nemorwagus., Frédi Guy. et fig. 48, celui du mu.ntjah. .Noslecteurs
jugeront par ces figures combien il auroit été difficile:d’en‘exprimer
les différences parde.s paroles.
Le reste du squelette offre aussi quelques différences! caractéristiques
dans certaines espèces qui tiennent surtout aux proportions (des
parties. Ainsi la brièveté du cou de l’élan se marque dans toutes ses
vertèbres; la hauteur de ses jambes lui donne des os plus allongés,'etc.
Dans Je renne on a un bon caractère tiré de la forme des os du
métacarpe et du métatarse ,*qui sont plus profondément crensésoen
arrière pour lqs tendons des fléchisseurs, ,eto<*.,. ü
Mais tous les détails où nous pourrions entrer ne dispenseroient pas*
d’une comparaison effective, s’il s’agissoit. de déterminer un osiisolé,,'
et même toutes lés ‘Comparaisons demeureroientrimpuissantes,entre
des espèces h peu [)rès de même taille.set de mêmes,‘proportions,
comme il y en a tant dansiee geure.