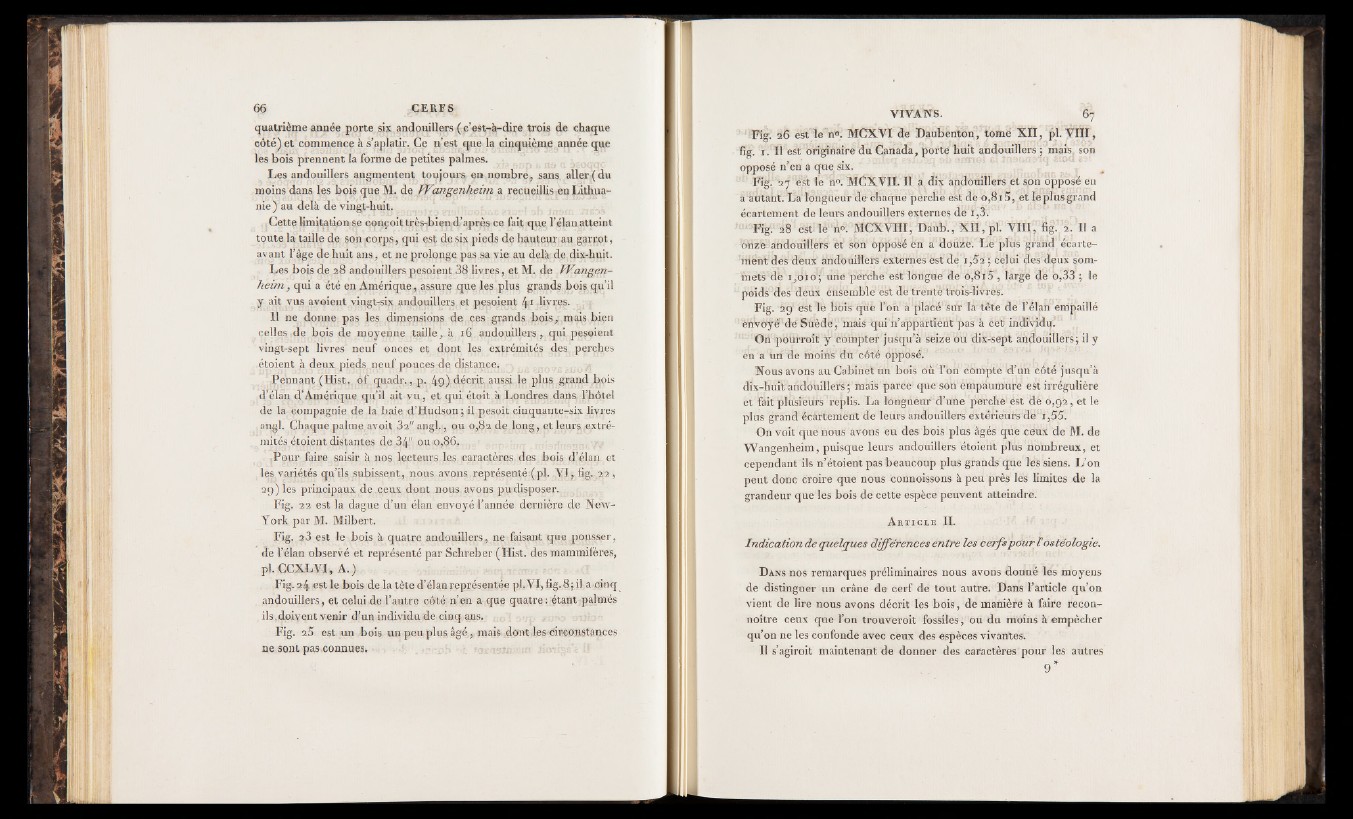
quatrième année porte six,andouillers ( e’est-à-dire trois de chaque
côté) et commence à s’aplatir. Ce n’est que la cinquième année que
les bois prennent la forme de petites palmes.
Les andouillers augmentent toujours, en nombre, sans aller (du
moins dans les bois que M. de PVmgenheim a recueillis en Lithuanie
)au delà de vingt-huit.
Cette limitation se conçoittrès-*bien d’après ce fait que l’élan atteint
toute la taille de son corps, qui est de sis pieds de hauteur au garrot,
avant l’âge de huit ans, et ne prolonge pas sa vie au delà de dix-huit.
Les bois de 28 andouillers pesoient38 livres, et M. de IVangen-
h eù n , qui a été en Amérique, assure que les plus grands bois qu’il
y ait vus avoient vingt-rshç andouillers. et pesoient 4;i livres.
11 ne donne pas les dimensions de ces grands bois, mais bien
(jelles.de bois de moyenne taille).à 16 andouillers, qui pesoient
vingt-sept livres neuf onces et dont les extrémités d,es) perches
étoient à deux pieds neuf pouces de distance. -,
Pénnant (fiist.^pf quadr. , p, 4q).décrit aussi le plus grand hois
d’élan d’Amérique qu’il ait vu ,’ et qui étoit à Londres dans l’hôtel
de la compagnie de la baie d’Hudson; il pesoifcinquante^six livres
.angl. Chaque palme,avoit 32" angl., ou 0,82 de long, et leurSjextré-
mités étoient distantes de 34“ ou 0,86, ,
-Pour faire saisir à nos lecteurs les caractères, des bois d’élan et
les,variétés qu’ils subissent, nous avons représenté;(pi. Y I , fig- ,23 ,
29) les principaux de .ceux dont nous, avons pu disposer.
Fig. 22 est la dague d’un élan envoyé l’année dernière de New-
York par Al. Milbert.
Fig..23 est le bois à quatre andouillers,, ne faisant que pousser,
de l’élan observé et représenté par Schreber (Hist. des mammifères,
pl. CCX.LVI, A. )
Fig. 24 est le bois de la tête d’élan représentée pl,VI, fig. 8 ; il a cinq
andouillers, et celuide l’autre côté n’en a que quatre: étant palmés
ils.doiyent venir d’un individu de cinq ans,
Fig. 25 est. un bois un peu plus âgé, mais dont les circonstances
ne sont pas connues.
Fig. 26 est le n°. MCXVI de Daubenton, tomé X U , pl. V IH ,
fig. i . Il eSt origiùâire du Canada, porté huit andouillers ; mais son
opposé n’eu a que., six.
Fig: '27 'est le n°. MCXVJI. Il a dix andouillers et son opposé en
a ùùtaht. La longüedr de chaque pèrche est de 0,81 f>, et le plus grand
écartement de leurs andouillers externes d ë 'ï,3.
■ Figé 28 est le n». M C X V llï. Daub., X I I , pl. V l l l , fig. 2. Il a
-Wrize andouillers et sbri opposé ètt a dôüiè. Le plus grand écarte-
ment des deux andouillers externes ëst de ï;S2i; telui des deux sommets
dh i.o io ; une perche est longue de 0,8 i 5 , large «Je oJ33 ; le
poids des deux ensemble est dé trente trois-îivres.
Fig. jjH est le bois que Foïf ü placë’ku'r ’lâ' tête de l’elah empaillé
ènvoyê’de Suède,‘ mais qui n’appartient pas à cet individu.
On pourroit y* compter jusqu’à seize ou dix-sept àndouillers; il y
en a un de moins dft côté opposé. ’
Nous avons au Cabinet un bois où l’on cômpte d’un côté jusqu’à
dix-huit andouiller'à; mais parce que son empâumure est irrégulière
et fait plusieurs replis. La longueur d’uùe porche ëst de 0,92) et le
plus grand écartement de leurs andouillers extérieurs de i ,55.
On voit que nous avons eu des bois plus âgés que ceux de M. de
Wangenheim, puisque leurs andouillers étoient plus nombreux, et
cependant ils n’étoient pas beaucoup plus grands que les siens. L ’on
peut donc croire que nous connoissons à peu près lès limites de la
grandeur que les bois de cette espèce peuvent atteindre.
A rticle H.
Indication de quelques différences entre les cerfs pour F ostéologie.
Dans nos remarques préliminaires nous avons donné les moyens
de distinguer un crâne de cerf de tout autre. Dans l’article qu’on
vient de lire nous avons déorit les bois, de manière à faire recon-
noître ceux que l’on trouveroit fossiles; ou du moins à empêcher
qu’on ne les confonde avec ceux des espèces vivantes.
Il s’agiroit maintenant de donner des caractères pour les autres
9 *