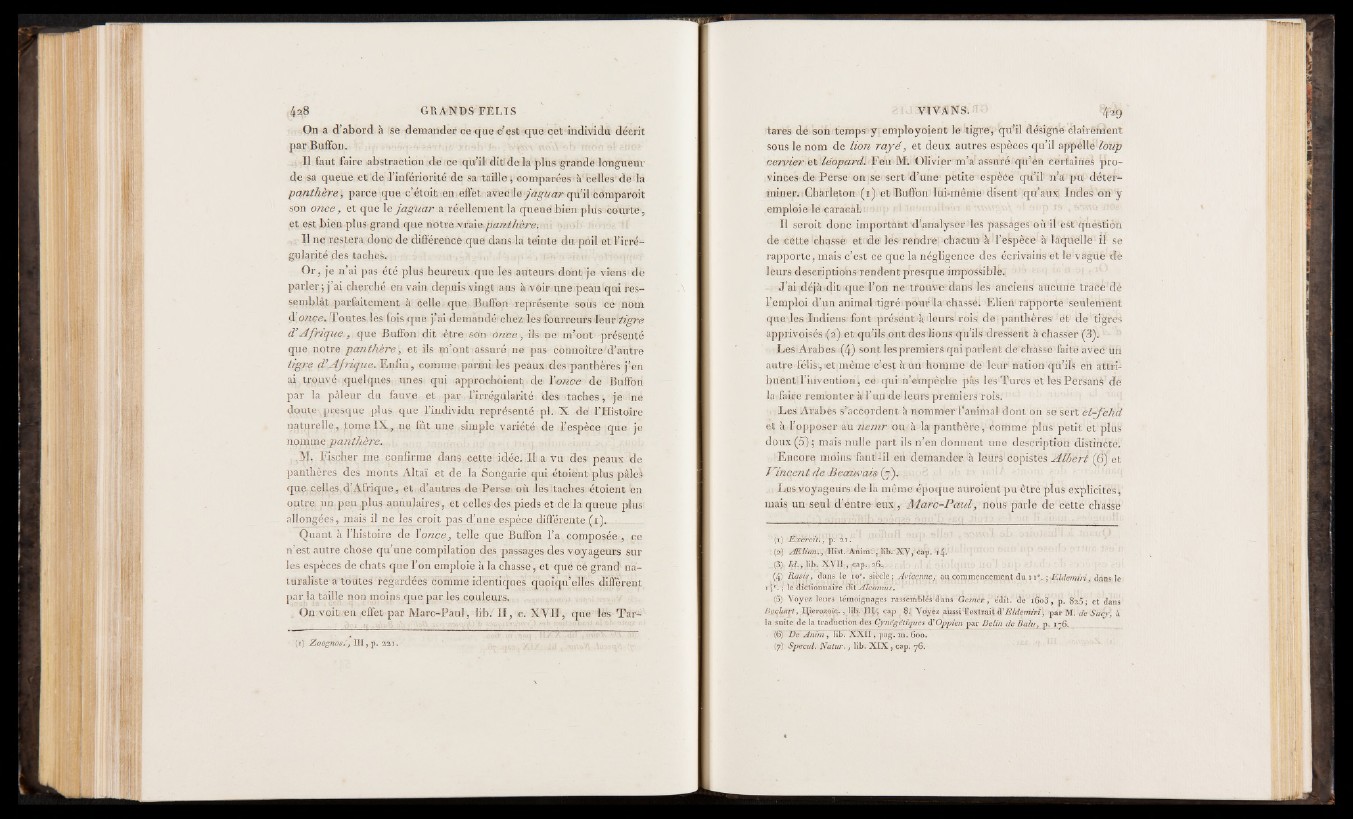
On a d’abord à se demander ce que c’est que cet individu décrit
par Buffon.
. Il faut faire abstraction de ce qu’il dit'de la plus 'grande longueur
de sa queue et de l’infériorité de sa taille ;■ comparées à'celles de la
panthère, parce que cétoit en effet ■ a.veC'leyrtcgmz/' qü’il comparoit
son once, et que le jaguar a: réellement la queue bien plus 'courte,
et est bien plus grand que notre-vraie-panthère,nu
Il 11e restera, donc de différence que dans la teinte dit poil et l’irrégularité
des tacffes. I,
Or, je n’ai pas été plus heureux,que les auteurs dont je viens de
parler; j’ai cherché en vain depuis vingttans à',vêir 1 uneipeàiu'qui ressemblât
parfaitement ai celle-que, Buffon représente sous *ce nom
(Yonce. Toutes les fois que j’ai demandé; chez les fourreurs Ifeur tigre
d’A frique , que Buffon dit .être son énve ., ils1 ne! m’ont présenté
que notre panthère , et ils m’ont iassuré (ne pas-connoître'd’autre
tigpe d’A friq u e. Enfin, comme parmi,.Les peaux des panthères j’en
ai trguvé quelques unes; qui approehoient de Yonee de Buffon
par la pâleur du fauve et par l’irrégularité de»-.taches ; je ne
doute presque plus que l’individu représenté pi. X de l’Histoire
naturelle., jtpmeIX, ne fut une simple variété de l’espèce que je
nomme panthère.. ,
,M. Fischer me confirme dans cette; idée. Il a vu des peaux de
panthères des monts Altaï et de la Songarie qui étoiént plus pâles
quç, .celles, d’Afrique, et d’autres de Perseï où lés taches, étoient !en
outrej un peu plus annulaires, et celles des;pieds et de la queue plus
allongées, mais il ne les croit pas d’une espèce différente.(1)... .
Quant à l’histoire de fo n ce, telle que Buffon l’a composée,, çe
n’est autre chose qu’une compilation des passages des voyageurs sur
les espèces de chats que l’on emploie à la chasse, et quë cé grand naturaliste'a
toutes regardées comme identiques quoiqu’elles diffèrent
par la taille non moins que par les couleurs.
On voituen effet par Marc-Paul, lib. II, c. X V II , que lès Tar-
• (1) Zoognos;', I II, p. 221.
tares de son temps-yiemployoient lé-tigre,'qu’il désigné cîaîrêment
sous le nom de lion rayé, et deux autres espèces qu’il appel le/o«p
cervier et léopard^ Feu Ml1 lOlivier m’a'assuré qu’ën êërfainés provinces
de. Perse on se'sert d’une petite 'espèce qu’il n’a' pu déter1-
miner.iCharleton (Qret Buffon lui-mêuie disent qu’aux Indes'on y
emploie lé caracàl: I
Il serait donc important d'analyser 'les passàgës où il êSt qiëStiôïi
de eette chassé' et de1 les-rendre! chacun1'h!'l'espèce1 h M’quéllë1 il se
rapporte, mais c’est ce que la négligence des écrivainslét lë'vâ'guè d%
leurs, deseriptions-rendent presque limpo'Sâible.,
J’ai-déjà.dit queel’on 11e trouy'o'dmis les anciens1 aucune trâëe'dè
l’emploi d’un animal tigré ■ pour la'chasséi Elien rapporté ^seulement
que\les Indiens; font présenté''leurs' rois de i panthères- ëtJ de ' tigres
apprivoisés 1(2).et qu’ils,.ont des lions .qu’ils1 dressent à' chasser (3). '
Les!Arabes;r(4) sont lespremierSqniparlent de'chasse faite avec un
autre.félis, et même'o’«s^ à ùüihomme de leur1 nation qu’ils eh attribuent;
l’invention ; cë qui n’empêche pals les Turcsét les Persans de
la faire remonter» l’un de1 leurs premiers rois/! 1
Les Arabès s’accordent à npmmér l’animal dont on se sert èl-feh d
et h l’opposer au nenir ou- à la; panthère, homme plus petit et plus
doux (5); mais nulle part ils n’en donnent une description distincte'.
Encore moins fautilil ed demander :à leurs'copistes A lb ert (6) et
JAinqent de Beaitvui® ( f j ,;m
Les voyageurs de la même époque auraient pu être plus explicités;
mais un seul d’entre eux, M a rc-P a u l, nous parle de celte chasse
- (i ) È x W c i t i , p . 2 1 .
(>) ffEîitih., 'Mi s t n i 0,;.;lîbï.-XY, -g aip'.
| | /#.,,li|>. X V II;) .Gap.;26Sî. , f
(4) daps le 10e. siècle : Aviçenne; au commencement du n®. ; Eldemiri, dans; le
1 4e. ; lè dictionnaire rat Aïcamus. -
(Ô) Voyez leurs' témoignages rass'ébibles'dians te e è f tè * ; ' ëdit/ laev'ioo3<, ’p. 8a5; et dans
IJïeroftQÏq., 1|1| l i t , cap. YpJjfëz ?aussi ^extrait d’Eldemiri, par M. de Sacy , à
la suite de la traduction des Cynégétiques d’Oppien par Belin de B alu, p. 176.
• (6) 2)e Ânim, lîb. X X I I , pag. m. 600.
. (7) Specul, Natur., lib. X IX , cap. 76.