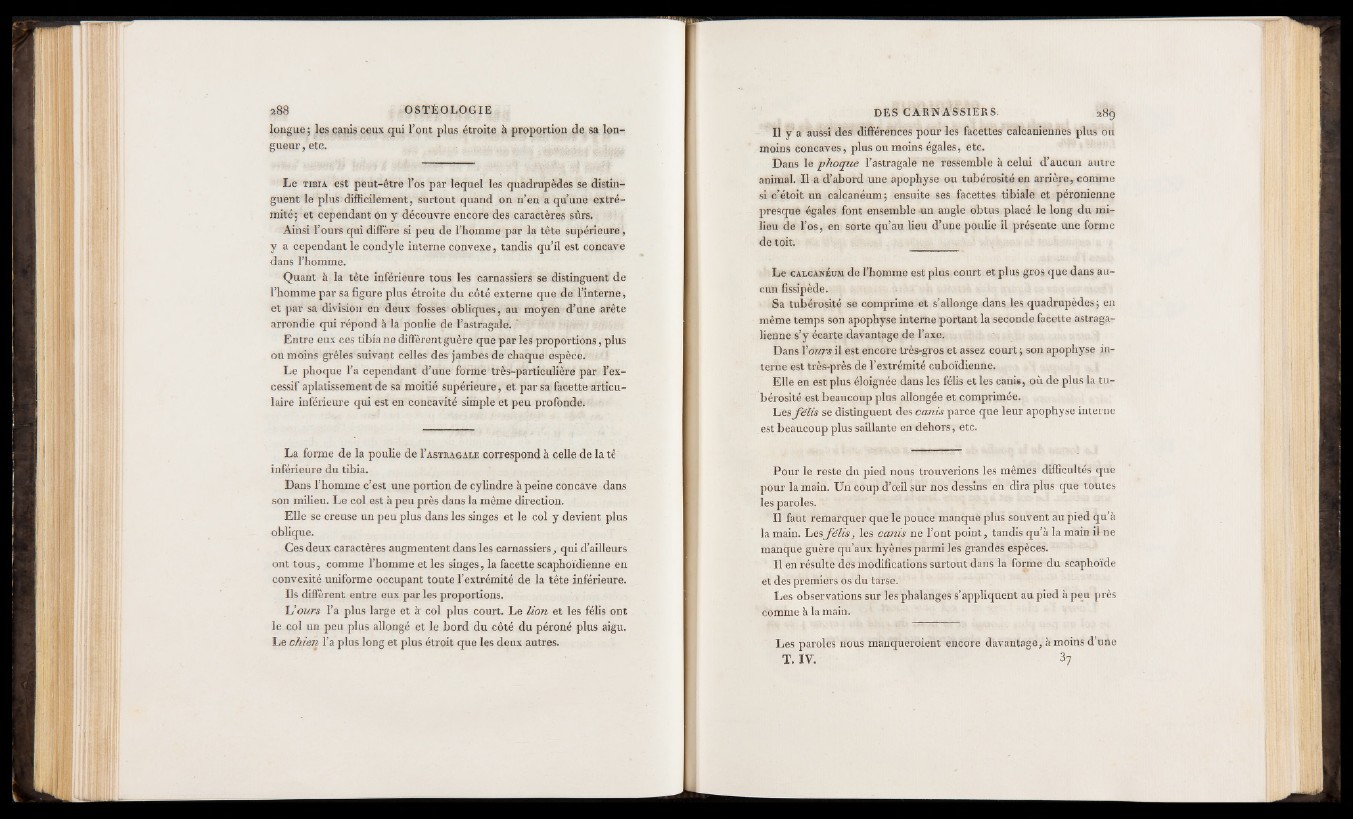
longue; les canis ceux qui l’ont plus étroite à proportion de sa longueur
, etc.
Le tibia, est peut-être l’os par lequel les quadrupèdes se distinguent
le plus difficilement, surtout quand on n’en a qu’une extrémité;
et cependant on y découvre encore des caractères sûrs.
Ainsi l’ours qui diffère si peu de l’homme par la tête supérieure,
y a cependant le condyle interne convexe, tandis qu’il est concave
dans l’homme.
Quant à la tête inférieure tous les carnassiers se distinguent de
l’homme par sa figure plus étroite du côté externe que de l’interne,
et par sa division en deux fosses obliques, au moyen d’une arête
arrondie qui répond à la poulie de l’astragale.
Entre eux ces tibia ne diffèrent guère que par les proportions, plus
ou moins grêles suivant celles des jambes de chaque espèce.
Le phoque l’a cependant d’une forme très-particulière par l’excessif
aplatissement de sa moitié supérieure, et par sa facette articulaire
inférieure qui est en concavité simple et peu profonde.
La forme de la poulie de 1’astragale correspond à celle de la tê'
inférieure du tibia.
Dans l’homme c’est une portion de cylindre à peine concave dans
son milieu. Le col est à peu près dans la même direction.
Elle se creuse un peu plus dans les singes et le col y devient plus
oblique.
Ces deux caractères augmentent dans les carnassiers, qui d’ailleurs
ont tous, comme l’homme et les singes, la facette scaphoïdienne en
convexité uniforme occupant toute l’extrémité de la tête inférieure.
Ils diffèrent entre eux par les proportions.
Uours l’a plus large et à col plus court. Le lion et les félis ont
le col un peu plus allongé et le bord du côté du péroné plus aigu.
Le chien l’a plus long et plus étroit que les deux autres.
Il y'a aussi des différences pour les facettes câlcaniennes plus ou
moins concaves, plus ou moins égales, etc.
Dans le phoque l’astragale ne ressemble à celui d’aucun autre
animal. Il a d’abord une apophyse ou tubérosité en arrière, comme
si c’étoit un calcanéum; ensuite ses facettes tibiale et péronienne
presque égales font ensemble -un angle obtus placé le long du milieu
de l’os, en sorte qu’au lieu d’une poulie il présente une forme
de toit.
Le calcanéum de l’homme est plus court et plus gros que dans aucun
fissipède.
Sa tubérosité se comprime et s’allonge dans les quadrupèdes; en
même temps son apophyse interne portant la seconde facette astraga-
lienne s’y écarte davantage de l’axe.
Dans Y ours il est encore très-gros et assez court ; son apophyse interne
est très-près de l’extrémité cuboïdienne.
Elle en est plus éloignée dans les félis et les canis, où de plus la tubérosité
est beaucoup plus allongée et comprimée.
LesJ'élis se distinguent des canis parce que leur apophyse interne
est beaucoup plus saillante en dehors, etc.
Pour le reste du pied nous trouverions les mêmes difficultés que
pour la main. Un coup d’oeil sur nos dessins en dira plus que toutes
les paroles. -
Il faut remarquer que le pouce manqué plus souvent au pied qu’à
la main. Lesf é lis , les canis ne l’ont point, tandis qu’à la main il ne
manque guère qu’aux hyènes parmi les grandes espèces.
Il en résulte des modifications surtout dans la forme du scaphoïde
et des premiers os du tarse.
Les observations sur lès phalanges s’appliquent au pied à peu près
comme à la main.
Les paroles nous manqueraient encore davantage, à moins d’une
T. IV. 3 ;