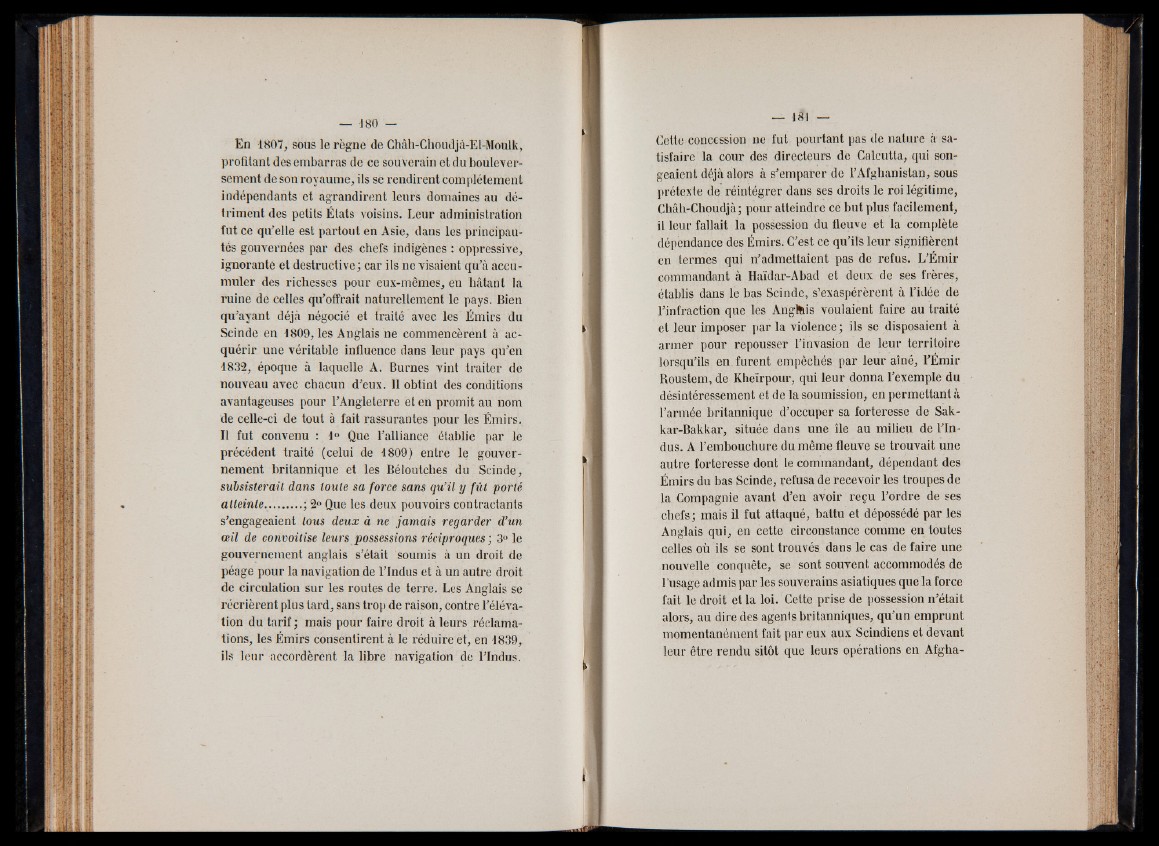
En 1807, sous le règne de Châh-Choudjà-El-Moulk,
profitant des embarras de ce souverain et du bouleversement
de son royaume, ils se rendirent complètement
indépendants et agrandirent leurs domaines au détriment
des petits États voisins. Leur administration
fut ce qu’elle est partout en Asie, dans les principautés
gouvernées par des chefs indigènes : oppressive,
ignorante et destructive; car ils ne visaient qu’à accumuler
des richesses pour eux-mêmes, en hâtant la
ruine de celles qu’offrait naturellement le pays. Bien
qu’ayant déjà négocié et traité avec les Émirs du
Scinde en 1809, les Anglais ne commencèrent à acquérir
une véritable influence dans leur pays qu’en
4832, époque à laquelle A. Burnes vint traiter de
nouveau avec chacun d’eux. 11 obtint des conditions
avantageuses pour l’Angleterre et en promit au nom
de celle-ci de tout à fait rassurantes pour les Émirs.
Il fut convenu : 1° Que l’alliance établie par le
précédent traité (celui de 1809) entre le gouvernement
britannique et les Béloutches du Scinde,
subsisterait dans toute sa force sans qu’il y fû t porté
atteinte. ; 2° Que les deux pouvoirs contractants
s’engageaient tous deux à ne jamais regarder d’un
oeil de convoitise leurs possessions réciproques ; 3° le
gouvernement anglais s’était soumis à un droit de
péage pour la navigation de l’Indus et à un autre droit
de circulation sur les routes de terre. Les Anglais se
récrièrent plus tard, sans trop de raison, contre l’élévation
du tarif ; mais pour faire droit à leurs réclamations,
les Émirs consentirent à le réduire et, en 1839,
ils leur accordèrent la libre navigation de l’Indus.
Cette concession ne fut pourtant pas de nature à satisfaire
la cour des directeurs de Calcutta, qui songeaient
déjà alors à s’emparer de l’Afghanistan, sous
prétexte de réintégrer dans ses droits le roi légitime,
Châh-Choudjà; pour atteindre ce but plus facilement,
il leur fallait la possession du fleuve et la complète
dépendance des Émirs. C’est ce qu’ils leur signifièrent
en termes qui n’admettaient pas de refus. L’Émir
commandant à Haïdar-Abad et deux de ses frères,
établis dans le bas Scinde, s’exaspérèrent à l’idée de
l’infraction que les Anglais voulaient faire au traité
et leur imposer par la violence; ils se disposaient à
armer pour repousser l’invasion de leur territoire
lorsqu’ils en furent empêchés par leur aîné, l’Émir
Roustem, de Kheïrpour, qui leur donna l’exemple du
désintéressement et de la soumission, en permettant à
l’armée britannique d’occuper sa forteresse de Sak-
kar-Bakkar, située dans une île au milieu de l’In-
dus. A l’embouchure du même fleuve se trouvait une
autre forteresse dont le commandant, dépendant des
Émirs du bas Scinde, refusa de recevoir les troupes de
la Compagnie avant d’en avoir reçu l’ordre de ses
chefs; mais il fut attaqué, battu et dépossédé par les
Anglais qui, en cette circonstance comme en toutes
celles où ils se sont trouvés dans le cas de faire une
nouvelle conquête, se sont souvent accommodés de
l ’usage admis par les souverains asiatiques que la force
fait le droit et la loi. Cette prise de possession n’était
alors, au dire des agents britanniques, qu’un emprunt
momentanément fait par eux aux Scindiens et devant
leur être rendu sitôt que leurs opérations en Afgha