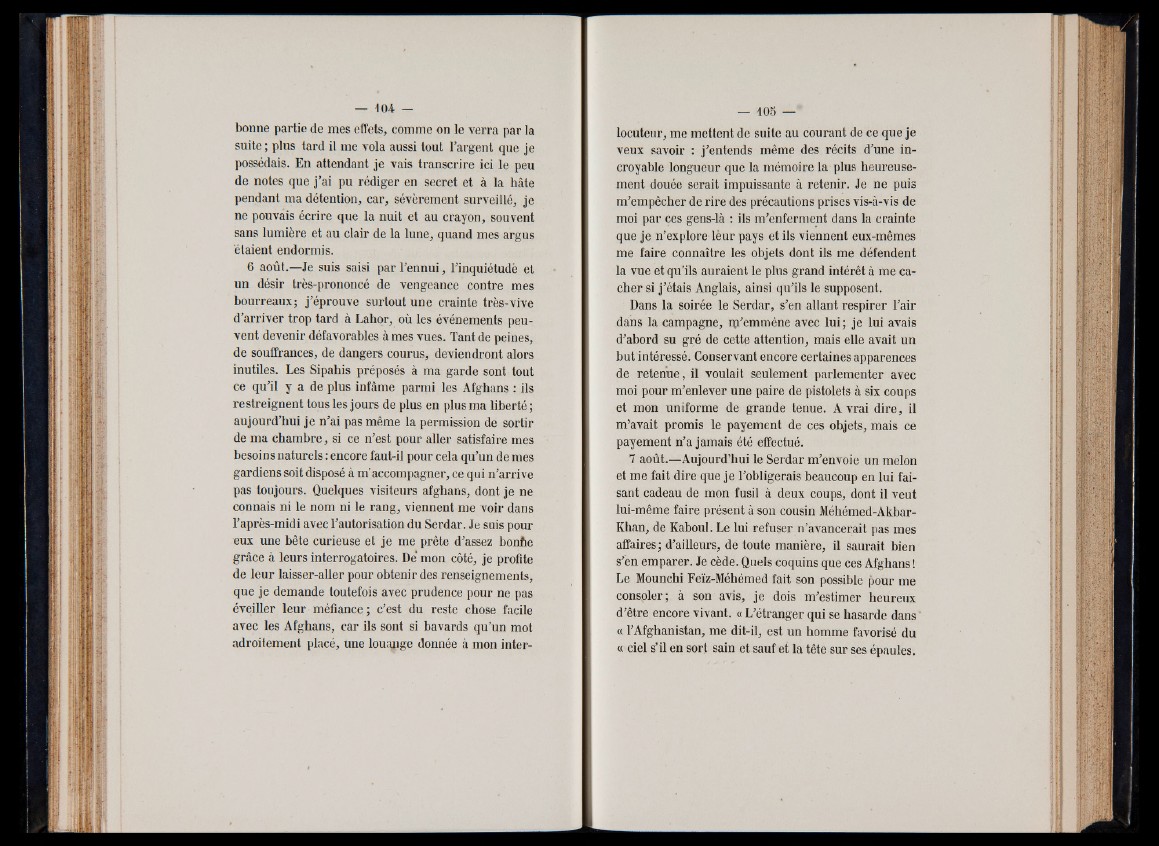
bonne partie de mes effets, comme on le verra par la
suite ; plus tard il me vola aussi tout l’argent que je
possédais. En attendant je vais transcrire ici le peu
de notes que j’ai pu rédiger en secret et à la hâte
pendant ma détention, car, sévèrement surveillé, je
ne pouvais écrire que la nuit et au crayon, souvent
sans lumière et au clair de la lune, quand mes argus
étaient endormis.
6 août.—Je suis saisi par l’ennui, l’inquiétudè et
un désir très-prononcé de vengeance contre mes
bourreaux; j ’éprouve surtout une crainte très-vive
d’arriver trop tard à Lahor, où les événements peuvent
devenir défavorables à mes vues. Tant de peines,
de souffrances, de dangers courus, deviendront alors
inutiles. Les Sipahis préposés à ma garde sont tout
ce qu’il y a de plus infâme parmi les Afghans : ils
restreignent tous les jours de plus en plus ma liberté ;
aujourd’hui je n’ai pas même la permission de sortir
de ma chambre, si ce n’est pour aller satisfaire mes
besoins naturels .‘encore faut-il pour cela qu’un de mes
gardiens soit disposé à m’accompagner, ce qui n’arrive
pas toujours. Quelques visiteurs afghans, dont je ne
connais ni le nom ni le rang, viennent me voir dans
l’après-midi avec l’autorisation du Serdar. Je suis pour
eux une bête curieuse et je me prête d’assez bonfte
grâce à leurs interrogatoires. De mon côté, je profite
de leur laisser-aller pour obtenir des renseignements,
que je demande toutefois avec prudence pour ne pas
éveiller leur méfiance ; c’est du reste chose facile
avec les Afghans, car ils sont si bavards qu’un mot
adroitement placé, une louapge donnée à mon interlocuteur,
me mettent de suite au courant de ce que je
veux savoir : j ’entends même des récits d’une incroyable
longueur que la mémoire la plus heureusement
douée serait impuissante à retenir. Je ne puis
m’empêcher de rire des précautions prises vis-à-vis de
moi par ces gens-là : ils m’enferment dans la crainte
que je n’explore leur pays et ils viennent eux-mêmes
me faire connaître les objets dont ils me défendent
la vue et qu’ils auraient le plus grand intérêt à me cacher
si j ’étais Anglais, ainsi qu’ils le supposent.
Dans la soirée le Serdar, s’en allant respirer l’air
dans la campagne, m’emmène avec lui; je lui avais
d’abord su gré de cette attention, mais elle avait un
but intéressé. Conservant encore certaines apparences
de retenue, il voulait seulement parlementer avec
moi pour m’enlever une paire de pistolets à six coups
et mon uniforme de grande tenue. A vrai dire, il
m’avait promis le payement de ces objets, mais ce
payement n’a jamais été effectué.
7 août.—Aujourd’hui le Serdar m ’envoie un melon
et me fait dire que je l’obligerais beaucoup en lui faisant
cadeau de mon fusil à deux coups, dont il veut
lui-même faire présent à son cousin Méhémed-Akbar-
Khan, de Kaboul. Le lui refuser n’avancerait pas mes
affaires; d’ailleurs, de toute manière, il saurait bien
s’en emparer. Je cède. Quels coquins que ces Afghans !
Le Mounchi Feïz-Méhémed fait son possible pour me
conspler ; à son avis, je dois m’estimer heureux
d’être encore vivant. « L’étranger qui se hasarde dans *
« l’Afghanistan, me dit-il, est un homme favorisé du
« ciel s’il en sort sain et sauf et la tête sur ses épaules.