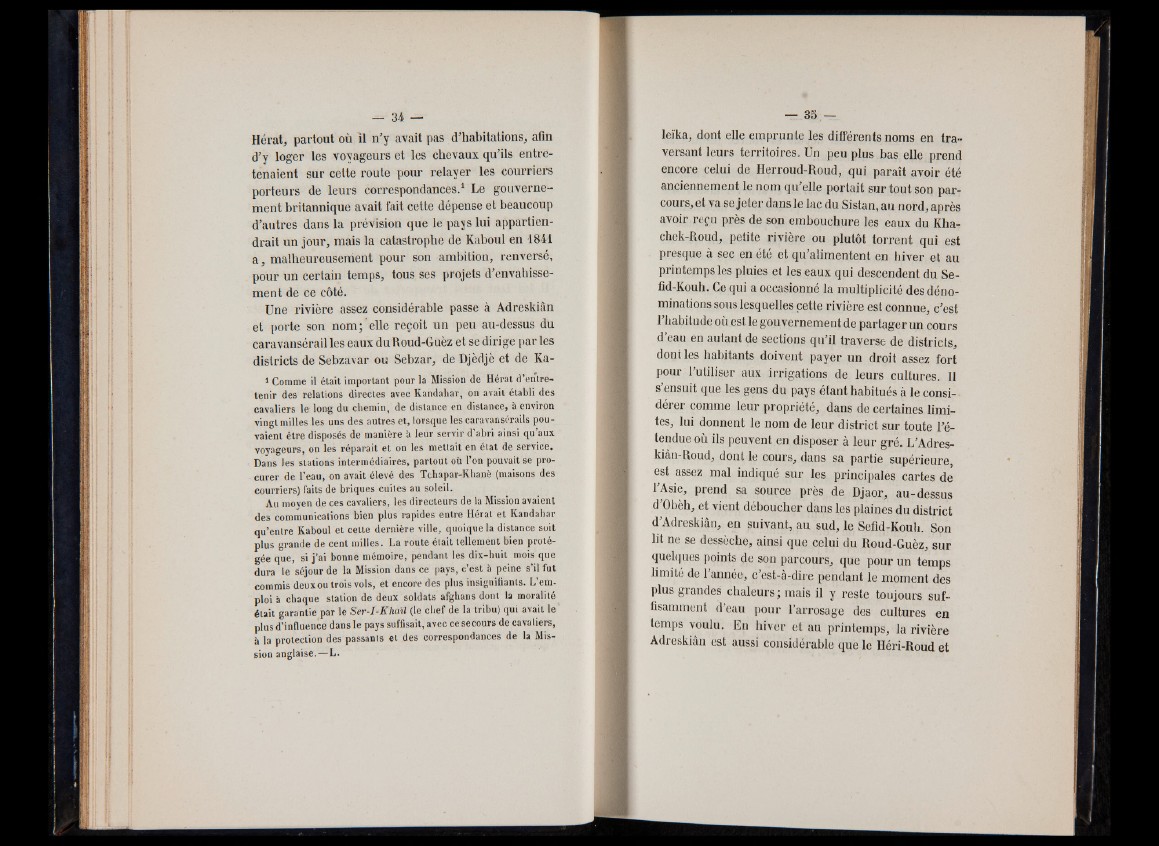
Hérat, partout où il n’y avait pas d’habitations, afin
d’y loger les voyageurs et les chevaux qu’ils entretenaient
sur cette route pour relayer les courriers
porteurs de leurs correspondances.1 Le gouvernement
britannique avait fait cette dépense et beaucoup
d’autres dans la prévision que le pajs lui appartiendrait
un jour, mais la catastrophe de Kaboul en 1841
a , malheureusement pour son ambition, renversé,
pour un certain temps, tous ses projets d’envahissement
de ce côté.
Une rivière assez considérable passe à Adreskiân
et porte son nom; elle reçoit un peu au-dessus du
caravansérail les eaux duRoud-Guèz et se dirige par les
districts de Sebzavar ou Sebzar, de Djèdjè et de Ka-
1 Comme il était important pour la Mission de Hérat d’entretenir
des relations directes avec Kandahar, on avait établi des
cavaliers le long du chemin, de distance en distance, à environ
vingt milles les uns des autres et, lorsque les caravansérails pouvaient
être disposés de manière à leur servir d abri ainsi qu aux
voyageurs, on les réparait et on les mettait en état de service.
Dans les stations intermédiaires, partout où l’on pouvait se procurer
de l’eau, on avait élevé des Tchapar-Khanè (maisons des
courriers) faits de briques cuites au soleil.
Au moyen de ces cavaliers, les directeurs de la Mission avaient
des communications bien plus rapides entre Hérat et Kandahar
qu’entre Kaboul et celte dernière ville, quoique la distance soit
plus grande de cent milles. La route était tellement bien protégée
que, si j ’ai bonne mémoire, pendant les dix-huit mois que
dura le séjour de la Mission dans ce pays, c’est à peine s’il fut
commis deuxou trois vols, et encore des plus insignifiants. L’emploi
à chaque station de deux soldats afghans dont la moralité
était garantie par le Ser-I-Khaïl (le chef de la tribu) qui avait le
plus d’influence dans le pays suffisait, avec ce secours de cavaliers,
à la protection des passants et des correspondances de la Mission
anglaise.—L.
lei'ka, dont elle emprunte les différents noms en traversant
leurs territoires, Un peu plus bas elle prend
encore celui de Herroud-Roud, qui paraît avoir été
anciennement le nom qu’elle portait sur tout son parcours,
et va se jeter dans le lac du Sistan, au nord, après
avoir reçu près de son embouchure les eaux du Kha-
chek-Roud, petite rivière ou plutôt torrent qui est
presque à sec en été et qu’alimentent en hiver et au
printemps les pluies et les eaux qui descendent du Se-
fld-Kouh. Ce qui a occasionné la multiplicité des dénominations
sous lesquelles cette rivière est connue, c’est
l’habitude où est le gouvernement de partager un cours
d eau en autant de sections qu’il traverse de districts,
dont les habitants doivent payer un droit assez fort
pour l’utiliser aux irrigations de leurs cultures. 11
s’ensuit que les gens du pays étant habitués à le considérer
comme leur propriété, dans de certaines limites,
lui donnent le nom de leur district sur toute l’étendue
où ils peuvent en disposer à leur gré. L’Adres-
kiân-Roud, dont le cours, dans sa partie supérieure
est assez mal indiqué sur les principales cartes de
l’Asie, prend sa source près de Djaor, au-dessus
d’Obèh, et vient déboucher dans les plaines du district
d’Adreskiân, en suivant, au sud, le Sefid-Kouh. Son
lit ne se dessèche, ainsi que celui du Roud-Guèz, sur
quelques points de son parcours, que pour un temps
limité de 1 année, c est-à-dire pendant le moment des
plus grandes chaleurs ; mais il y reste toujours suffisamment
d’eau pour l’arrosage des cultures en
temps voulu. En hiver et au printemps, la rivière
Adreskiân est aussi considérable que le Héri-Roud et