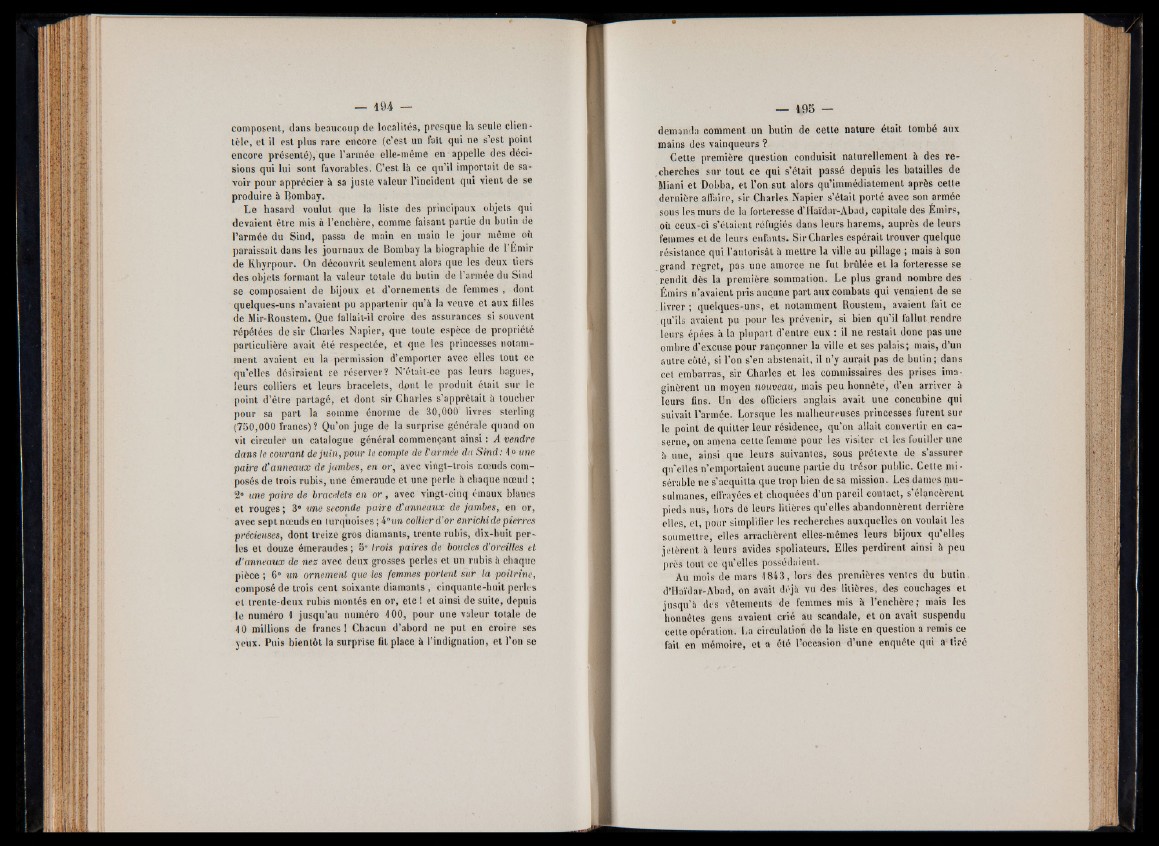
composent, dans beaucoup de localités, presque la seule clientèle,
et il est plus rare encore (c’est un fait qui ne s’est point
encore présenté), que l’armée elle-même en appelle des décisions
qui lui sont favorables. C’est là ce qu’il importait de savoir
pour apprécier à sa juste valeur l’incident qui vient de se
produire à Bombay.
Le hasard voulut que la liste des principaux objets qui
devaient être mis à l’enchère, comme faisant partie du butin de
l’armée du Sind, passa de main en main le jour même oit
paraissait dans les journaux de Bombay la biographie de l’Emir
de Khyrpour. On découvrit seulement alors que les deux tiers
des objets formant la valeur totale du butin de l’armée du Sind
se composaient de bijoux et d’ornements de femmes , dont
quelques-uns n’avaient pu appartenir qu’à la veuve et aux filles
de Mir-Roustem. Que fallait-il croire des assurances si souvent
répétées de sir Charles Napier, que toute espèce de propriété
particulière avait été respectée, et que les princesses notamment
avaient eu la permission d’emporter avec elles tout ce
qu’elles désiraient se réserver? N’étail-ce pas leurs bagues,
leurs colliers et leurs bracelets, dont le produit était sur le
point d’être partagé, et dont sir Charles s’apprêtait à toucher
pour sa part la somme énorme de 30,000 livres sterling
(730,000 francs) ? Qu’on juge de la surprise générale quand on
vit circuler un catalogue général commençant ainsi : A vendre
dans le courant de juin, pour le compte de l'armée du Sind: 1° une
paire d'anneaux de jambes, en or, avec vingt-trois noeuds composés
de trois rubis, une émeraude et une perle à chaque noeud ;
2° une paire de bracelets en or , avec vingt-cinq émaux blancs
et rouges ; 3* une seconde paire d'anneaux de jambes, en or,
avec sept noeuds en turquoises ; 4°«« collier d’or enrichi de pierres
précieuses, dont treize gros diamants, trente rubis, dix-huit p erles
et douze émeraudes ; 5” trois paires de boucles d'oreilles et
d ’anneaux de nez avec deux grosses perles et un rubis à chaque
pièce ; 6° un ornement que les femmes portent sur la poitrine,
composé de trois cent soixante diamants , cinquante-huit perles
et trente-deux rubis montés en or, etc ! et ainsi de suite, depuis
le numéro 1 jusqu’au numéro 100, pour une valeur totale de
10 millions de francs I Chacun d’abord ne put en croire ses
yeux. Puis bientôt la surprise fil place à l’indignation, et l’on se
demanda comment un butin de cette nature était tombé aux
mains des vainqueurs ?
Cette première question conduisit naturellement à des re cherches
sur tout ce qui s’était passé depuis les batailles de
Miani et Dobba, et l’on sut alors qu’immédiatement après cette
dernière affaire, sir Charles Napier s’était porté avec son armée
sous les murs de la forteresse d’Haïdar-Abad, capitale des Émirs,
oü ceux-ci s’étaient réfugiés dans leurs harems, auprès de leurs
femmes et de leurs enfants. Sir Charles espérait trouver quelque
résistance qui l’autorisât à mettre la ville au pillage ; mais à son
grand regret, pas une amorce ne fut brûlée et la forteresse se
rendit dès la première sommation. Le plus grand nombre des
Émirs n’avaient pris aucune part aux combats qui venaient de se
livrer ; quelques-uns, et notamment Roustem, avaient fait ce
qu’ils avaient pu pour les prévenir, si bien qu’il fallut rendre
leurs épées à la plupart d’entre eux : il ne restait donc pas une
ombre d'excuse pour rançonner la ville et ses palais; mais, d’un
autre côté, si l’on s’en abstenait, il n’y aurait pas de butin; dans
cet embarras, sir Charles et les commissaires des prises imaginèrent
un moyen nouveau, mais peu honnête, d’en arriver à
leurs fins. Un des officiers anglais avait une concubine qui
suivait l’armée. Lorsque les malheureuses princesses furent sur
le point de quitter leur résidence, qu’on allait convertir en caserne,
on amena cette femme pour les visiter et les fouiller une
à une, ainsi que leurs suivantes, sous prétexte de s’assurer
qu’elles n’emportaient aucune partie du trésor public. Celte m isérable
ne s’acquitta que trop bien de sa mission. Les dames musulmanes,
effrayées et choquées d’un pareil contact, s’élancèrent
pieds nus, hors de leurs litières qu’elles abandonnèrent derrière
elles, et, pour simplifier les recherches auxquelles on voulait les
soumettre, elles arrachèrent elles-mêmes leurs bijoux qu’elles
jetèrent à leurs avides spoliateurs. Elles perdirent ainsi à peu
près tout ce qu’elles possédaient.
Au mois de mars 1843, lors des premières ventes du butin
d’Ilaïdar-Abad, on avait déjà vu des litières, des couchages et
jusqu’à des vêtements de femmes mis à l’enchère; mais les
honnêtes gens avaient crié au scandale, et on avait suspendu
cette opération. La circulation de la liste en question a remis ce
fait en mémoire, et a été l’occasion d’une enquête qui a tiré