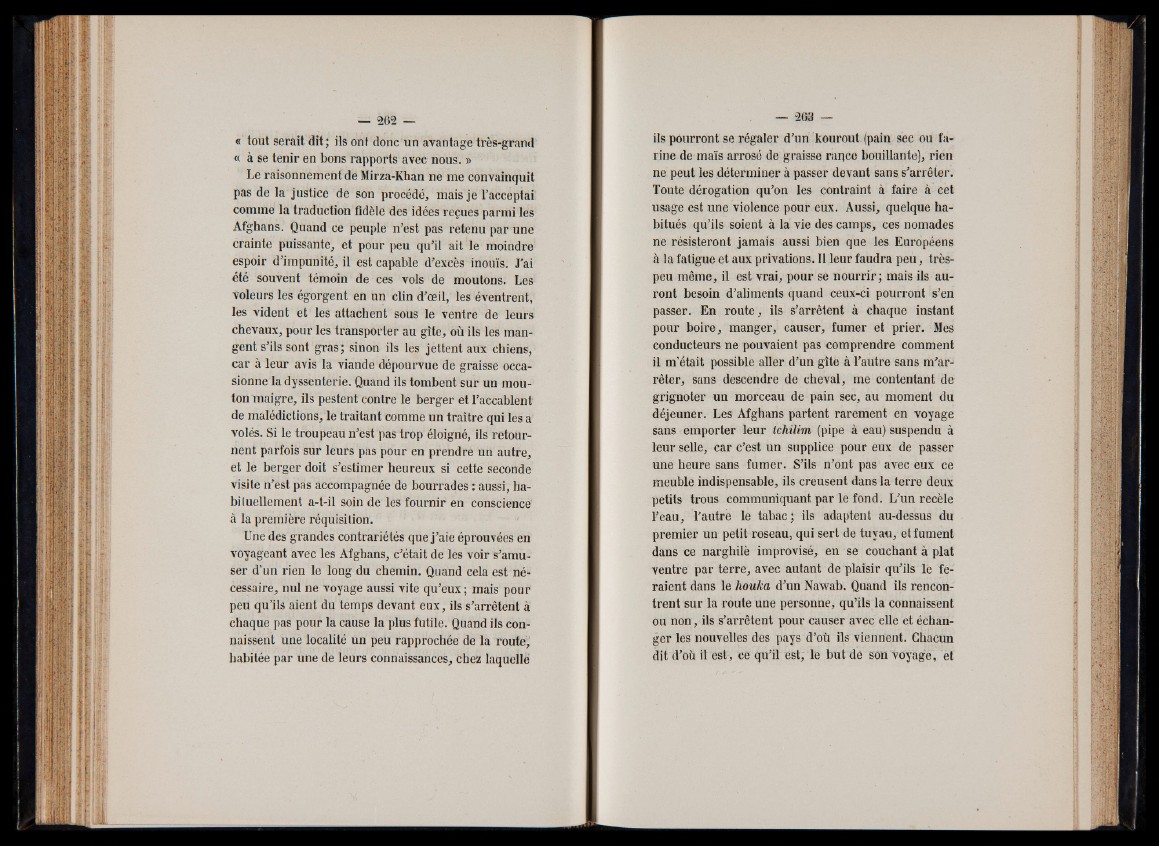
« tout serait dit ; ils ont donc un avantage très-grand
« à se tenir en bons rapports avec nous. »
Le raisonnement de Mirza-Khan ne me convainquit
pas de la justice de son procédé, mais je l’acceptai
comme la traduction fidèle des idées reçues parmi les
Afghans. Quand ce peuple n’est pas retenu par une
crainte puissante, et pour peu qu’il ait le moindre
espoir d’impunité, il est capable d’excès inouïs. J'ai
été souvent témoin de ces vols de moutons. Les
voleurs les égorgent en un clin d’oeil, les éventrent,
les vident et les attachent sous le ventre de leurs
chevaux, pour les transporter au gîte, où ils les mangent
s’ils sont gras; sinon ils les jettent aux chiens,
car à leur avis la viande dépourvue de graisse occasionne
la dyssenterie. Quand ils tombent sur un mouton
maigre, ils pestent contre le berger et l’accablent
de malédictions, le traitant comme un traître qui les a
volés. Si le troupeau n’est pas trop éloigné, ils retournent
parfois sur leurs pas pour en prendre un autre,
et le berger doit s’estimer heureux si cette seconde
visite n’est pas accompagnée de bourrades : aussi, habituellement
a-t-il soin de les fournir en conscience
à la première réquisition.
Une des grandes contrariétés que j ’aie éprouvées en
voyageant avec les Afghans, c’était de les voir s’amuser
d’un rien le long du chemin. Quand cela est nécessaire,
nul ne voyage aussi vite qu’eux ; mais pour
peu qu’ils aient du temps devant eux, ils s’arrêtent à
chaque pas pour la cause la plus futile. Quand ils connaissent
une localité un peu rapprochée de la route,
habitée par une de leurs connaissances, chez laquelle
ils pourront se régaler d’un kourout (pain sec ou farine
de maïs arrosé de graisse raqce bouillante), rien
ne peut les déterminer à passer devant sans s’arrêter.
Toute dérogation qu’on les contraint à faire à cet
usage est une violence pour eux. Aussi, quelque habitués
qu’ils soient à la vie des camps, ces nomades
ne résisteront jamais aussi bien que les Européens
à la fatigue et aux privations. Il leur faudra p eu, très-
peu même, il est vrai, pour se n o u rrir; mais ils auront
besoin d’aliments quand ceux-ci pourront s’en
passer. En ro u te , ils s’arrêtent à chaque instant
pour boire, manger, causer, fumer et prier. Mes
conducteurs ne pouvaient pas comprendre comment
il m’était possible aller d’un gîte à l’autre sans m’arrêter,
sans descendre de cheval, me contentant de
grignoter un morceau de pain sec, au moment du
déjeuner. Les Afghans partent rarement en voyage
sans emporter leur tchilim (pipe à eau) suspendu à
leur selle, car c’est un supplice pour eux de passer
une heure sans fumer. S’ils n’ont pas avec eux ce
meuble indispensable, ils creusent dans la terre deux
petits trous communiquant par le fond. L’un recèle
l’eau, l’autre le tabac; ils adaptent au-dessus du
premier un petit roseau, qui sert de tuyau, et fument
dans ce narghilé improvisé, en se couchant à plat
ventre par terre, avec autant de plaisir qu’ils le feraient
dans le houka d’un Nawab. Quand ils rencontrent
sur la route une personne, qu’ils la connaissent
ou non, ils s’arrêtent pour causer avec elle et échanger
les nouvelles des pays d’où ils viennent. Chacun
dit d’où il est, ce qu’il est, le but de son voyage, et