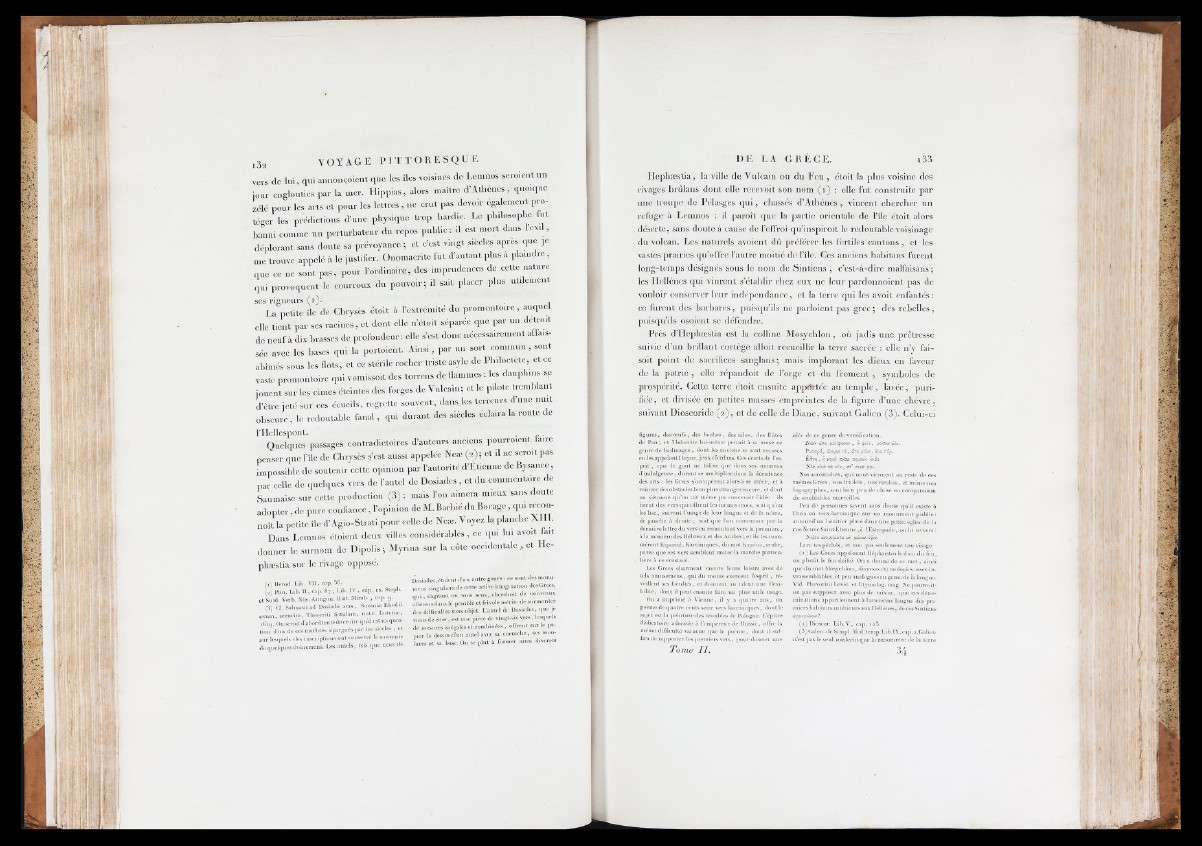
pf-'-;-
li#
fc/ ú vg¿
liv’î-V:
■ •' /■Y*3
t e
l ' / ê ’
I #
vers dc lui, qui uunouçoicut que les îles voisines dc l.eiiinos seroieiil mi
jour ciiglouües par la mer. Hippias, alors maître d’Athènes , quo.<luc
zèle pour les arls ct pour les lettres , nc crut |ias devoir cgalouicnt ¡iro-
tèger les prédictions d’nne physique trop hardie. Ec plnloso,>lio lut
banni comme nn perturbateur du repos public: Il est mort dans le x .l,
déplorant sans doute sa prévoyance ; et e’esl vingt sieeles après que ,e
me trouve appelé à le justifier. Ouomaerite fut d’autaiit plus à planidre,
que cc nc sont pas, pour l’ordinaire, des iiiipriidciiees do celte natine
qui provo<luent le courroux du pouvoir; il sait placer plus utilement
SCS vigueurs ( i ) . . ,
La ponte île de Chrysès ctoit à l’extrémité du promontoire , auquel
elle tient par ses racines, et dont elle n’étoit séparée que par uu détroit
de neuf à dix brasses de profondeur: elle s’est doue nécessairement allu.s-
sée avec les bases qui la portoicnt. Ainsi, par nn sort eomimni , sont
abîmes sous les Ilots, et cc stérile rocher triste asylc de Plnlocletc, ct ce
vaste promonlolrc qui vomissoil des lorreiis dc llaiiimcs : les dauphins sp
jouent sur les cimes éteintes dos forges de Vuleain; et le pilote tremblant
d’ètre jeté sur ces écueils, regrette souvent, dans les terreurs d’une nuit
obscure , lo redoutable fanal, qui durant des siècles éclaira la route de
rtlcllespoiit. ■ r ■
Quelques passages contradictoires d’auteurs anciens pourroicnt bure
penser que l’île de Chrysès s’est aussi appelée Ncæ (a); ct il ne seroit pas
impossible dc soutenir celte opinion par faulorité d’Etieiiiic dc Bysance,
par eclle de quelques vers dc l’autel de Dosiadcs , cl du commentaire de
Saumaisc sur cette production (3) : mais fon annera mieux sans doute
adopter, de pure coiillancc , l’opinion do M. Barbié dn Bocage, qui recon-
noit la petite île d’Agio-Strati pour celle dc Neæ. Voyez la pianelle X l l l .
Dans Lcmnos étoient deux villes considérables , cc qui lui avoit lait
donner le surnom dc Dipolis; Myrina sur la côte occidentale , ct Ho-
phæslia sur le rivage 0[)püsc.
( 0 llcroci. Lib. VII, cnp. 36.
(a) r liu .L ib .I I .ra p , 87 ; Lib. IV , cap. ra.Stepb.
et Suid. Verb. Ni«. Antigo». Hist- Mirai). , ctip. 9.
(3) Cl. SMinasii ail D.isiadæ aras , Smmiiæ miodii
ovum. securii.., ïheurrili Ibtt.l.arn . .«ottc. la.let.a-,
1619. Onseroitd'a bord futéc le,rot,cM¡u-ilostic. cptestioii
d'un do 00s niarltros ópargiiós par U'-s .su-clos , et
sur ks(pu-ls do.s inscriptions ont oousorvé le s-.nvcnir
do quelquos óvóiicmoiis. Los autels, tels <iue ceux de
Dosiadas, étoient d'nti autre genre i ce sont dcsmonu-
mons singuliers do cette active imagination dos C. ocs,
qni , s'agitant ou Ions sens, chcrclioil de nouveaux
alimcns dan.s le pénible el frivole mérite de surmonter
dos dibiouliés sans objet. L'auto! do Dosiados, (¡ne je
viens do citer, est une pièce de vingt-six vers, les,juels
dc mesures inégales et eoinliinées , offronl sur lo panier
le de.ssin d'uu auloi avco sa cornielie , .ses moulures
ot sa base. Ou so plut à former ainsi diverses
Ilcphæslia, la ville dc Vuleain ou du F eu , cLoil la plus voisine dos
rivages brùlaiis donl elle recevoil son nom ( i) : elle iùl construite par
une ü'üu[)e do Pi'lasges qui, cliass<“s d’Alhèncs, vinrent chercher un
re/’uge à Lemuos : il ¡»aroît que la partie orientale dc l’ilc éloil alors
tIcseiTc, sans doute à cause de l’elTroi ({ii’inspiroit le rcJoutabIc voisinage
du volcan. Les naturels avoicnl dù préférer les fertiles canlons, cl les
vaslcs prairies qu’offre l’aulrc moitié de l’île. Ces anciens liabilans fiircuL
long-lcmps désignés sous le nom de 8inliens , c’csl-à-dirc nialfaisaiis ;
les JlelJèncs qui vinrcul s’élaljlir chez eux ne leur pardonnoienl [»as de
vouloir conserver leur indt'pendaiicc , cl la lcrre qui les avoil enfantés :
cc furent des barbares, [»uisqu’ils nc parJoicnl [»as grec; des rebelles,
puisqu’ils üsoiciil sc déi'eiidrc.
Près d’ileplioesüa est la colline Mosychlon, où jadis une prêtresse
suivie d’uu brillant cortège alloil recueillir la terre sacrée : elle n’y fai-
soit point de sacrifices sanglaiis; mais implorant les dieux en faveur
de la [»atrie , elle répaiidoil dc l’orge el du froment , symboles de
prospérité. Celle terre ctoit ciisuiLc ap[)drt(à- au tem[*le, lavée, [»iiri-
iiéc, cL divisée cn petites niasses cin[»rcinlcs dc la figure d’uiic chèvre,
suivant DiosCüi'ide (2), et dc celle dc Diane, suivaiiL Galicn (3). (A'lui-ci
(igun-s. (k-ireiif«, des linrbes, des.iile.s, des (lûtes
de l’an; et Tliénorile lui-mèiiu: puniiil à .su muse ce
gelive de badiiiage.s , dont les aiieieii.s se sinit oxeusé.s
en les appelant jeux d'eiifaus. Ces écarts de IVspril
, que le goût ne tolère que dans ses monu-ns
d'indulgence. durent se multiplier dans la décadence
des arts : les Crces s'oceupèreiit alors à se créer, cl ;i
vaiiiere des ol>staelcsbiou plus étranges encore, el dont
ou .s’éUiiiue qu'on ail iiiéine pu eoucevoir l'idée ; ils
(irenl des vers qui ol'freul les mêmes mots, .soit qu'on
le.s lise, suis'aul l’usago de leur langue el de la tu'.tre,
de gauelie à droite ; soit <|uc l'on eoniiiieiiee par la
à la manière des lléljrcux el des Aralx-s ; ct ils les nommèrent
Kxyyjyui, Ixarriiiupies, du mot KapziVo; , crabe,
•e que ces vers semblent imiter la inaroke pariiculié.
istacé.
elmrmeiil s lolsi
du n U l'e,vpri
lira.
empereur ,i'
e que le po.
iap,,ov •s|,r,
Tome IJ.
co genre de versifiealioii.
xy assi (íü.íq'jiytty , à qûs, yùTxy «iv.
ÈS-.SÌ , f. 20(« T.XTX 7T.:m:
Kix «ivà rà v: , âr' ¿
veilloul ses farullés. el doimeul au laleiil une llexi-
l>ilité, doul il petilensuile faire uu plus ulile iisage,
On a imprimé á \ieuiie, il y a <|ualre aiis, un
poéme de qiiativ cents .soize vors kareiuiques, dout le
siijel esl la peíuture iles Iroiiiiles de l’ologiie. I.'epilrc
ilédiealoire adre.ssée ;i i'eiiipereur de Kussie, »I'IV,- la
mi-me dinieullé s
Nos aewslielies, qui nous vienueiil au reste de c,-s
mêmes Grecs, nos triolets, nos vin-l.ais, el même nos
logogryplies, sont bien peu de chose eu eompaniison
de soiiiblaliks merveilles.
Pari.s un 'e is kareinique sur uu montimejit piiblio:
aulourd'un béiutier placé dans une pelileégli.se de la
rueNeuv,'-,Sainl-Elienno,à l'Iùstrapade, ou lit covers ;
Nii|ov «vogzgara fir, iiéyxy C'iiv.
I-ave lespéelié.s, el non pa.s seulemeiU tou vi.sage.
( il I.i’.s Gri-es appeloicnt lléphai.slos le dieu du l'eu,
ou plurâl ie feu déilic. On a donné de ce mol , ainsi
que du mol .Mo.syelikm, divenses élymologii-s assez ¡livra
isendilalde.s, el peu anaiogue.s au génie dc ia langue.
Vid. Phavorini Le.xic. el Elymolog. inag. Ne pourroit-
011 |ias supposer avec plus do raison, que ee.s dénominations
apparliennenl à l'ancienne langue des premiers
baliitausantérioursuux Hellènes, deces.Siutiens
«ysioçûztuv?
ya'i l»io.seor. Lib .V , eap. i i 3.
(3;,<;aleti.de.Simpl..Med.lemp.Li!i.IX,eap.2.Galien
ii'est pas le seul niédeein que la renommé,- de la terre
3 ',