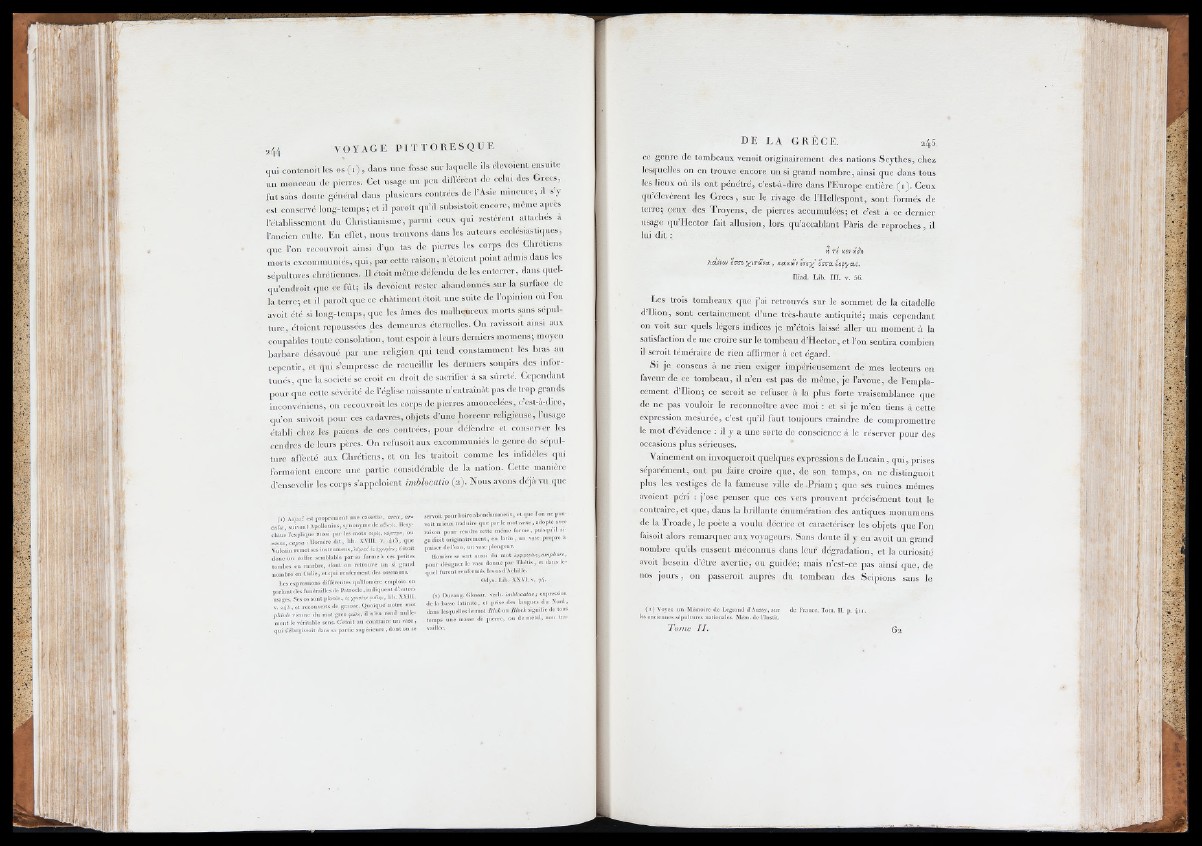
■¿•ri
S
‘T S ì
teter-
344 V O Y . V G E P I T T O R E S Q U E
qui coiucnoil les os (1) , daus une fosse sur la<iuelle ils élcvoieut ensuite
uu monceau de pierres. Cet usage uu peu différent ,1e cela, des Grecs,
fut sa'iis doute général daus plusieurs contrées de l'Asie mineure; .1 sy
est conserve loug-lemi>s; et il paroît qu'il snbsistoil encore, même après
l’établissement du Christianisme, liarmi eeu.v qui restèrent allaelics a
faneicn ctillc. Eu effet, nous trouvons dans les auteurs ecclésiastiques,
que l’on rceonvroit ainsi d’un las de pierres les corps des Cbréticus
morts cxcomimiiiiés, qui, par celle raison, ii'étoiciU point admis tlans les
séiHilliircs cliréliciincs. Il étoit même défendu do les enterrer, dans tpicl-
qu’ciulroit (¡ne ce fût; ils dévoient rester abandonnés sur la suriace de
la terre; ct il [laroil qnc cc oliâüment ctoit une suite dc fopiniou on l’on
avoit été si long-temps, tpic les âmes des malheureux morts sans sépiil-
Uirc, etoicnt repoussées des demeures étemelles. On ravissoit ainsi aux
coupables loulc consolation, toul espoir â leurs derniers momcns; moyen
barbare désavoué par une religion ipii Iciid eonslanimeiU les bras an
repentir, ct qui s’empresse dc recueillir les derniers soupirs des inl'or-
lu iu i 'S , que la société sc cro.l eu droit de sacrifier â sa sûreté. CepeiidaiU
(lOtir que ecuc sévérité tle l’église naissante n’eiilraiiiàt ¡las tic trop grands
¡neonvéïiiciis, on rceonvroit les corps de pierres amoncelées, e’cst-a-tlirc,
tpi’on suivoit pour ces catlavrcs, oljjcls d’une horreur religieuse, l’usage
établi clicz. les païens do ces contrées, pour délcndrc ct conserver les
eciulrcs de leurs pères. On rcl'usoit aux excommuniés le genre tic séiuil-
turc allccté aux rdircliciis, ct on les Iraitoit comme les infidèles qui
rormoiciil encore une partie considérable tle la nation. CeLle manière
d’ensevelir les coiqis s’aiipeluiciit itnblocaüo (2). Nous avons tléja vu ipie
(1) Aay«; fst pi'ojirenifnl une cassette, arca , arcala,
suivant Apollonius, synonyme (le w껫;. Hesy-
chius Vexpliquc aussi par les mots aapé-,, xdazzpx, ou
y.Btua, Ciytsa-• Homère dit, lib. XMll. v. /|i3 , que
Vuleain remet ses iiislrumens,>a>v»’ l;M-/L-,o6;v; c’étoit
donc un coffre semblable parsa forme à ces petites
lombes en marbre, dont ou retrouve uu si grand
nombre cn Italie, et (¡ui renferment des ossemcns.
Les expressions différentes qu'llomérc emploie eu
parlant des funérailles dc l'atroclc, induiuenl d'autres
usages. Ses os sonl placés, r; -/ovaérp ycDsp, lib. XXlll.
V. , et recouverts do graisse. Quoitjue notre mot
phiulc vienne du mot grec oia/», U n’cn rend niille-
ment le véritable sens. C'éloit au contraire un vase ,
qui s’éiargissuit dans sa partie supérieure, dont on se
servoit pourboire abondamment, et que l'on nc pouvoit
mieux traduire que par le mot «rne, adopté avec
raison pour rendre celle même forme, puisqu'il si-
gnifioit originairement, en latin, un vase propre à
puiser de l'eau, uu vase plongeur.
Homère se sert aussi du mot ¿pacpopiv;, amphore,
pour désigner le vase donné par Tliétis, cl dans lequel
fuient renfermés les osd'Acliille.
Odys. Lib. XXVI. V. 74.
(2) Diieaiig. Glossar. verb. imblocalas; expro.ssiou
(le la bas.se ialiiiité, el prise des langues du -Nord,
dans lesquelles le mol Blok ou Block .signilie de tous
ce genre de lombcaux venoit originairement des nalions Scjlfics, cbez
lesquelles on cn trouve encore un si grand nombre, ainsi que dans tous
les beux où ils ont pénètre, c’est-à-dire dans l’Europe entière ( i) . Ceux
qu’èlevcreiU les Grecs, sur le rivage de ITIcllespont, sont formés dc
terre; ceux des Troycns, de pierres accumulées; ct c’esl à cc dernier
usage qu’IIcclor lait allusion, lors qu’accablant Paris de rcprocbes, il
lui dit :
« TS KÎV H(b)
Activov éOTTo y iTm a ., aay.m s v s f ôW a iopyo-ç.
Ilia d . L ib . I I I . V. 5l3.
Les trois tombeaux que j ’ai retrouvés sur le sommet de la citadelle
d’Ilion, sont certainement d’une très-bautc antiquité; mais cependant
on voit sur quels légers indices je m’étois laissé aller un moment à la
satisfaction dc me croire sur le tombeau d’Hector, ct l’on sentira combien
il seroit téméraire dc rien affirmer à cet égard.
S i je consens à nc rien exiger impérieusement de mes lecteurs en
faveur de ce tombeau, il n’cn est pas de même, je l’avoue, de l’cmpla-
ccmcnt d’ibon; cc scroit se refuser à la plus forte vraisemblance que
de nc pas vouloir le reeonnoître avec moi : et si je m’en tiens à cette
cxjircssion mesurée, c’cst qu’il làut loujours craindre de compromettre
le mot d’évidence : il y a une sorte dc conscience à Je réserver pour des
occasions plus sérieuses.
\uincincnt on invoqucroit quelques expressions de Lucain, qui, prises
séparément, ont pu faire croire que, dc son temps, on ne distinguoil
plus les vestiges dc la fameuse ville de Priam ; que ses ruines mêmes
avoient péri : j’ose jienscr que ces vers prouvent précisément tout le
contraire, ct que, dans la l)rilIanto énumération des antiques monumens
de la Troade, le poète a voulu décrire el caractériser les objets (juc l’on
faisoit alors remarquer aux voyageurs. Sans doute il y eu avoit un grand
nombre qu’ils eussent méconnus dans leur dégradation, ct la curiosité
avoil besoin d’être avertie, ou guidée; mais u’cst-cc pas ainsi (jue, de
nos jours, 011 passeroiL auprès du Lombeau des Scipions sans le
( I ) Voyez un Ménioir,
les aiicieiiue.s sépullures ii
Tome 11.
(le Lcgrand d’Au.ssy, sur
lionalcs- Molli, de I'liislit,
de France. Tom. II, p. 411
r
iîr -av-
R k
\