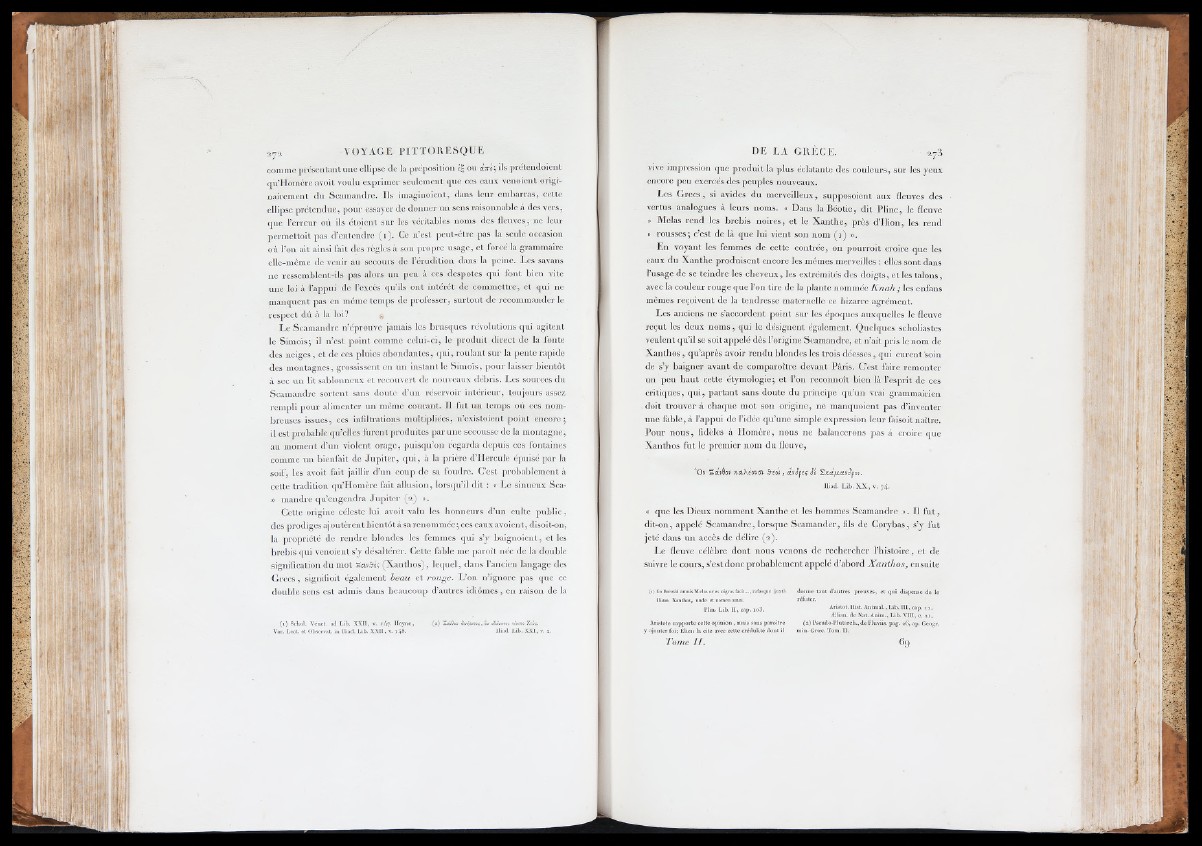
Vs
¿iv
III
i I'
comme jiréseuUuiLuue ellipse tle la [»réposilioii ou cÙtto; ils pi’cLcudoicnt
(p/nomère avoil voulu exjirimer studemcnl que ces eaux vcuoiciil origi-
uaircmciiL du Scamandre. Us imagiiioiciil, dans leur cmljarras, ccUe
ellijjsc prélenduc, pour essayer de donner uu sens raisonnable à des vers,
quo l’erreur où ils cLoienl sur les vérilal)ics noms des ileuves, nc leur
j)crmeUüil pas d’eiilendre ( i) . Co n’est peut-être pas la seule occasion
où l’on ait ainsi fait des règles à son ju-oprc usage, et Ibrcc la grammaire
elle-même de venir au secours dc rcrutliLiou dans la })cine. Les savans
ne ressemblent-ils pas alors un peu à ces despotes (jui ibul l)ieu vile
une loi à l’appui dc l’excès (ju’ils ont intérêt de eomiuctlrc, cl qui nc
manquent pas cn même temps de prolèsser, surLuiil dc recommander le
rcspeel dù à la loi?
Le Seamandrc n’éprouve jamais les lirusqucs révolutions qui agitent
le Simoïs; il n'est point comme celni-ci, le produit direct do la fonte
des neiges , ct de ces pluies abondantes, (pii, roulant sur la pente rapide
des monlagncs, grossissent en un instant le Simoïs, pour laisser bieuLùt
à sec uu lit sabioniieux el recouvert de nouveaux débris. Les sources du
Scumandro sortent sans doute d’un réservoir intérieur, loujours assez
rcm{)li pour alimenter uu mémo courant. Il l'ul un temps où ces nombreuses
issues, cos infiltrations multipliées, n’exisloient point encore;
il est probable (pi'ollcs furent produites par une secousse de la montagne,
au moment d’un violent orage, j»uisqu'on regarda dejjuis ces fontaines
comme uu bieiilait de Jupiter, cpii, ù la prière d’iiercule éjuiisé par la
soif, les avoit fait jaillir d'un coiij) dc sa foudre. C’csl probablement ù
cette tradition (lu'ilomère lait allusion, lorsiju’il dit : c Le sinueux Sea-
0 maiidrc qu’ciigeudra Jupiter (2) ».
Cette origine céleste lui avoil valu les honneurs d’nn culte pulilic,
des prodiges ajoutèrent hient()L à sa ix'iiümmée; ces eaux avoient, disoit-on,
la propriété de rendre bloiuks les femmes qui s’y baignoicnl, elles
brebis ([Lli venoient s’y désalUa’er. Cette l'ablc me [»aroît lub dc Ja doidile
signification du mot 'E.ciiAx; (Xanthos), Icipiel, dans l’ancien langage des
Grecs, signitioil également ôeau et rouifc. Jfon n’ignore jias (|uc cc
double sens est admis tlans luiaueoup d’autres idiomes, en raison de la
(1) Schol. Venet. ad Lil), XXll, v, 1/17. lleync,
Var, Lcd, ct Observât, lu lliad. Lib. X X ll, v. lüS.
(2) Svdazoi, i-j dAwzoi ziy.t-.o Zk;.
Iliad. Ld). XXI, V.
vive impression que produit la plus cclalaule des couleurs, sur les yeux
encore peu exercés des peuples nouveaux.
Les Grecs, si avides du merveilleux, supposoicnt aux fleuves des
vertus analogues à leurs noms. « Dans Ja Béotie, dit Pline, le fleuve
» Mêlas rend les brebis noires, et le Xanthe, près d’Ilion, les rend
» rousses; c’csl de hï (jue lui vient son nom ( i) ».
En voyant les femmes de cette contrée, on pourroit croire que les
eaux du Xanthe produisent encore les mêmes merveilles : elles sonl dans
l’usage dc se teindre les cheveux, les extrémités des doigts, et les talons,
avec la couleur rouge (¡ue l’on Lire do la ¡»lante nommée J\./i(ihÿ les cnfans
mêmes rc(:oivcnt de la tendresse maternelle cc bizarre agrément.
Les anciens ne s’accordent point sur les ép0(|iies aux(jucllcs le fleuve
reçut les deux noms, qui le désigneuL également. Quelques scholiasles
veulent qu’il sc soit appelé dès l’origine Scamandre, et n'ait pris le nom de
Xanthos, qu’après avoir rendu blondes les trois déesses, qui eurent soin
de s’y baigner avant dc comparoîlre devant Paris. C’est faire remonter
un peu liaui cette étymologie; ct l’on reconnoît bien là l’esprit de ces
critiques, qui, partant sans doute du principe qu’un vrai grammairien
doit trouver à chaque mot son origine, ne manquoient pas d’inventer
une fable, à l’appui dc l’idée qu’une simple exju'cssiou leur faisoit naître.
Pour nous, fidèles à Homère, nous ne balaiiecrons ¡»as à croire que
Xaiitlios fut le premier nom du fleuve,
''Ok SaiiÔov kcîAîovgi â-soi, avJpiç Si ^KcLfiai/Sfiov.
liiad. Lib. X X , V. 7,y
« que les Dieux nomment Xanlbe el les hommes Scamandre ». Il fut,
dil-on, appelé Scamandre, lorscjue Scainandcr, fils dc Corybas, s’y fut
jeté dans un accès do délire (2).
Le fleuve célèbre doul nous venons dc rccbcrclicr rliistoire, cl dc
suivre le cours, s’cst donc probablement appelé d’abord X a n th o s , cnsui le
(0 In Hoeolia amnUMelas oves uigras fadl..., rutasque juat:.
liiiim XoQihus, uudc cl nomen anini.
Pliu. Lib. U, rap. lo 3.
Aristotc rapporte cette opiuion , niais sans paroître
y ajoiiliT foi; Élieii la cite avec cetlc criidulilé tloiil il
donne lanl d'autres preuves, et qui dispense de le
réfuter.
Arisiot. llist. Animal., Lib. 111, cap. 12.
Æliaii. dc Nat, Auim., Lib- VIII, c, 21,
(2) Pscudo-Plularcli.,de Fluviis. pag. 2Ü, ap. Geogr.
iniii. Gtxc. Tom. II.
T ü i n c 1 1 . C<)
'•