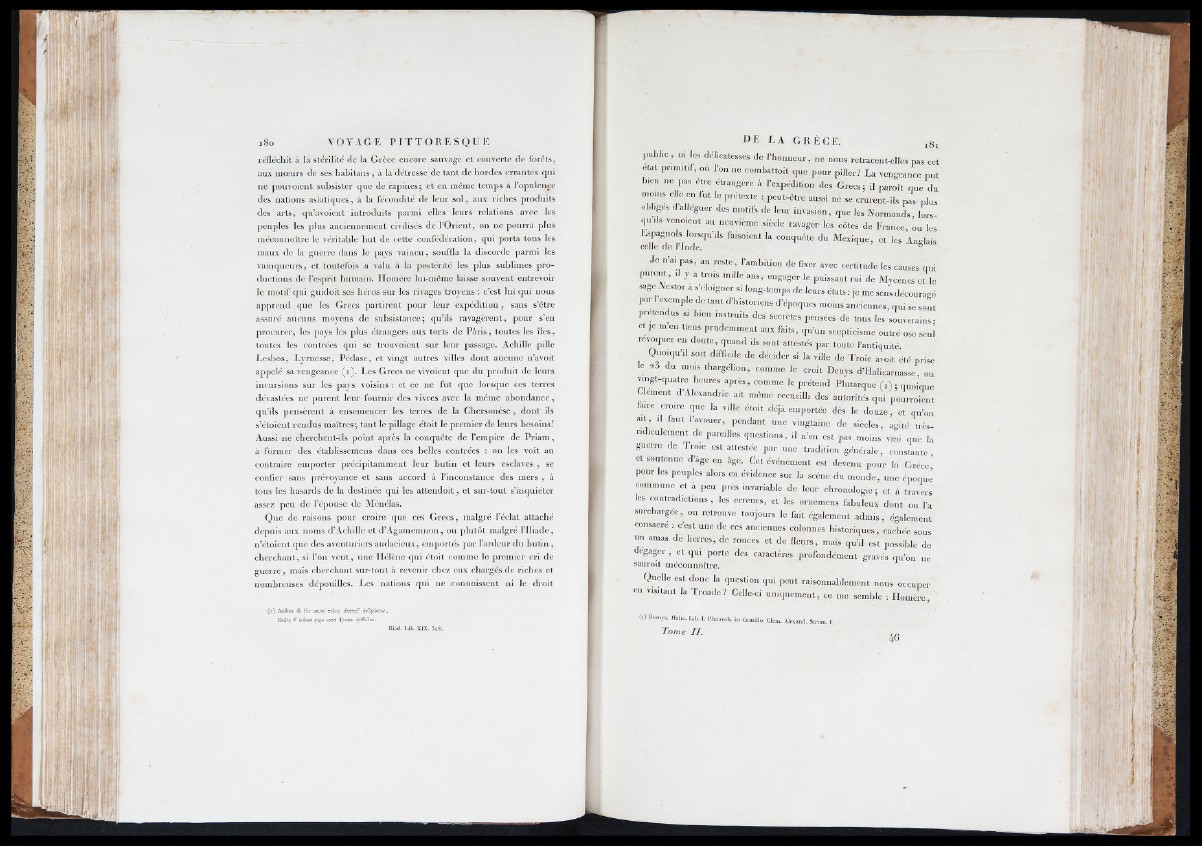
T
P
y
mI
.‘■•QV
I r i
i8o V O Y A G E P I T T O R E S Q U E
réfléchit à la stérilité de la Grèce encore sauvage ct couverte de forêts,
aux moeurs dc scs liahitans , à la détresse dc tant dc hordes errantes qui
nc pouvoicnt subsister ([ue dc rapines; ct on même temps à l’opulence
des nalions asiati([ucs, à la fécondité dc leur sol, aux ricbcs produits
dos arls, qu’avoicnl introduits parmi elles leurs relations avec les
peuples les plus anciennement civilisés dc l’Orionl, on ne pourra plus
méconnoîlrc le véritable but dc celte confédération, qui porta lous les
maux dc la guerre dans le pays vaincu, souffla la discorde parmi les
vainqueurs, et toutefois a valu à la postérité les plus sublimes productions
dc l’esprit liuinain. Homère Im-mcme laisse souvent entrevoir
le motif qui guidoit ses liéros sur les rivages troycns : c’est lui qui nous
apprend que les Grecs partirent pour leur expédition, sans s’ctre
assuré aucuns moyens dc subsistance; qu’ils ravagèrent, pour s’en
procurer, les pays les plus étrangers aux torts de Paris, toutes les îles,
toutes les contrées qui sc trouvoicnt sur leur passage. Achille pille
I.csbos, Lyrncssc, Pédasc, et vingt autres villes dont aucune n’avoit
appelé sa vengeance ( i) . Les Grecs ne vivoient que du produit de leurs
incursions sur les pays voisins : et ce nc fut que lorsque ces terres
dévastées nc purent leur fournir des vivres avec la même abondance,
qu’ils pensèrent à ensemencer les terres de la Chersoiièse, dout ils
s’étoient rendus maîtres; tant le pillage ctoit le premier de leurs besoins!
Aussi ne cherchent-ils point après la conquête de l’empire dc Priam,
à former des établisscmcns dans ces belles contrées : on les voit au
contraire emporter précipitamment leur butin et leurs esclaves , se
confier sans prévoyance ct sans accord à l’inconstance des mers , à
lous les hasards dc la destinée qui les attcndoit, et sur-tout s’inquiéter
assez peu dc l’épousc de Ménélas.
Que de raisons pour croire que ces Grecs, malgré l’éclat attaché
depuis aux noms d’Achille ct d’Agamemnon, ou plutôt malgré l’Iliadc,
n’étoicnt que des aventuriers audacieux, emportés par l'ardeur du butin ,
cherchant, si l'on veut, une Hélène qui étoit comme le premier cri dc
guerre, mais cherchant sur-tout à revenir chez eux chargés de riches ct
nombreuses déjiouillcs. Les nalions qui ne comioissent ni le droit
Ikii; J- ïvSvxd Zxi Tf.o!rr, k!&.ù.ov.
m
D E L A G R È C E .
p..blic, ... les dclicalosscs de l’I.o.meuF, ue ..ous retracent-elles nas cet
état pnm,t.l, ou l’on ne combatto.t que pour p.ller? La yeugcance put
b.cu ne pas être ét.angcrc à l’exped.t.on des Grecs; .1 pa.-oit que du
U.O.US ebo en fut le prétexte : peut-être anss. ne se orurent-.ls pas plus
obbges d alléguer des motifs de leur n.vasion, que les Normauds, lors-
qu ,1s veno.cnl au neuvième siècle ravager les côtes de France, ou les
Espagnols lo,squ’,ls fa,soient la conquête du Mexique, et les Anglais
celle de l’Inde. ®
Je n’ai pas, an reste, l’ambition de fixer avec certitude les causes qui
purciG ,1 y a trois mille ans, engager le puissant roi de Myeènes ct le
sage Nestor a s’éloigner s, long-temps de leurs états i je mesens découragé
par I exemple dc tant d’historiens d’époques moins anciennes, qu. se so!it
prétendus s. bien instruits des secrètes pensées de tous les souverains;
et JC m en tiens prudemment aux faits, qu’un scepticisme outre ose seul
révoquer en doute, quand ,1s sont attestés par toute l’antiquité.
Quoiqu’il soit difficile dc décider si la ville de Troie avoit été prise
le 23 du mo.sthargcl.on, comme le croit Denys d’Halicarnasse, ou
vingt-quatre heures après, comme le prétend Plutarquc ( , ) ; quoique
Clome.it d Alexandrie ait même recueilli des autorités qu. pourroicnt
aire croire que la ville étoit déjà emportée dès le douze , et qu’on
ail, 1 faut l’avouer, pendant une vingtaine de siècles, agité très-
nd.culemcnt de pareilles questions, il n’cn est pas moins vrai que la
guerre de Troie est attestée par une tradition générale, constante
ct soutenue d’âge en âge. Cet événement est devenu pour la Grèce,’
pour les peuples alors cn évidence sur la scène du monde, une époqu!
commune ct à peu près invariable de leur chronologie ; et à travers
les contradictions , les erreurs, et les orncmens fabuleux dont on fa
surchargée, on retrouve toujours le fait également admis, également
consacré : c’est une de ces anciennes colonnes historiques, cachée sous
un amas dc lierres, de ronces et de fleurs, mais qu’,1 est possible de
dégager , et qu. porto des caractères profondément gravés qu’on ne
sauroit mcconnoître.
Quelle est donc la question qui peut raisonnablement nous occuper
eu visitant la Troade ? Celle-ci uniquement, ce me semble : Homère,
(>) Diony.. Hniic. Lib. I. Plularch. iu Camillo, C!em. Akxand. Slrom, 1.
Tome I I .
46
'ï t