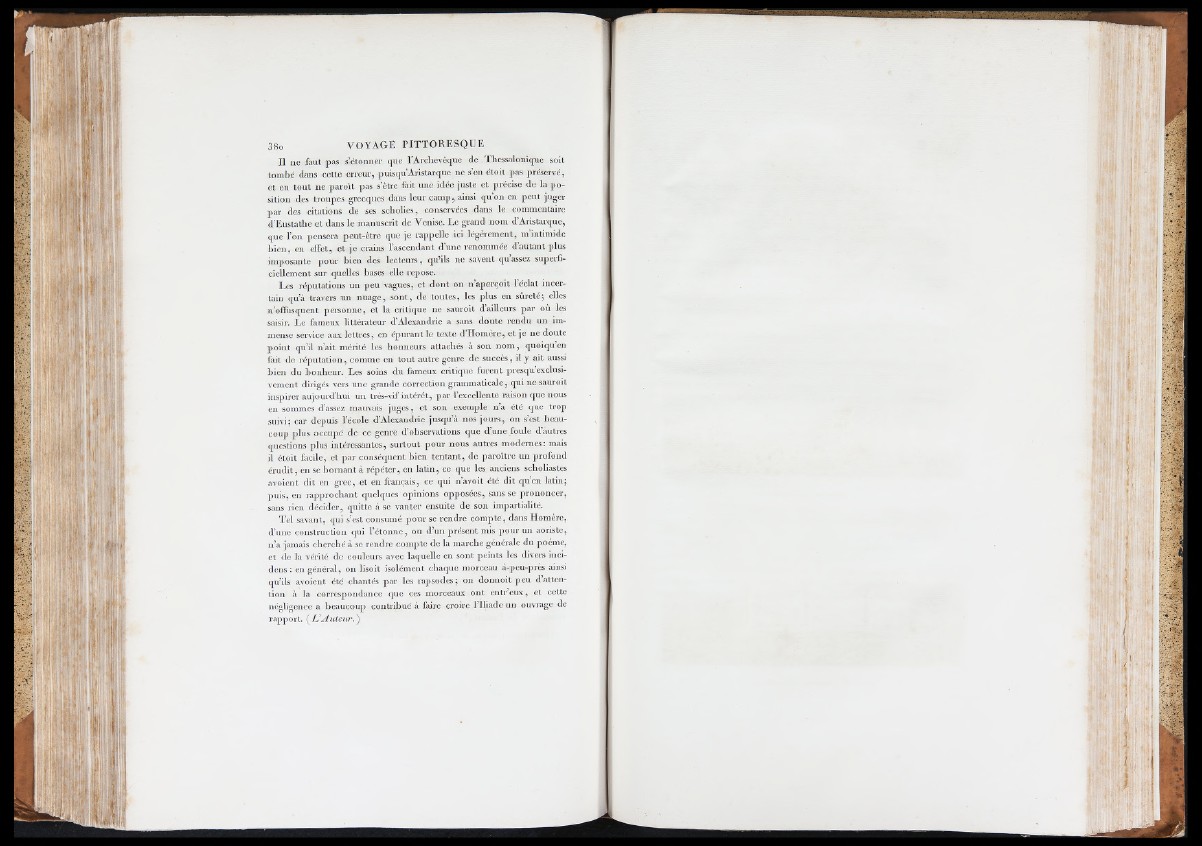
L ' r i r
' " i I *
I n ; *
■-ÇÏ
li. 'rip >
■ , .1'
H i !■
II nc faut pas setouiicr que l'Aicliovêque de Thcssalonique soit
tombé dans cotte erreur, puisqu’Aristarquo nc s’cn étoit pas jiréscrvé,
cl eu tout ne paroit pas s’ctrc fait mro idée juste ct précise dc la posilion
des Iroupcs grecques daus leur camp, ainsi qu'on cn pont juger
l>ar des citations dc sos scholics, conservées dans le coinmcnuivc
d’Eustalbc ct dans le manuscrit de Venise. Le grand nom d Arislarquc,
que l'on pensera peut-être que je rappelle ici légèrement, m'intimide
bien, cn eilet, ct je crains rascendant d’une renommée d autant plus
imposante pour bien des lecteurs, qu’ils ne savent qu’assez, supcrli-
cicllcmcnl sur quelles bases elle repose.
Les réputations un peu vagues, ct dont on n’aperçoit l’éclat incertain
qu’à travers un nuage, sont, de tontes, les plus en sfireté; elles
n’offusquent personne, ct la critique ne sauroit d’ailleurs par où les
saisir. Le fameux litlératonr d’.-Ucxandric a sans doute rendu un immense
service aux lettres, cn épurant le texte d’Homère, et je ne doute
point qu’il n'ait mérité les honneurs attachés à son nom, quoiquen
fait dc réputation, comme cn tout autre goure do succès, il y ait aussi
bien du bonheur. Les soins du fameux critique furent presqu’cxcbisi-
vemciil dirigés vers une grande correction grammaticale, qui uc sauroit
inspirer aujourd'hui un très-vif intérêt, par l’excellente raison qnc irons
cn sommes d'assez mauvais juges, et son exemple n’a été (jne trop
suivi; car depuis l’école d’Alexandrie jusqu’à nos jours, on s’cst beaucoup
plus occupé de ce genre d’observations que d’une foule d’autres
questions plus intéressantes, surtout pour nous autres modernes: mais
il étoit facile, et par conséquent bien tentant, dc paroîtrc un profond
érudit, cnsc bornant à répéter, en latin, co que les anciens sclioliastes
avoient dil en grec, et en français, cc qui n’avoit été dil qu’en latin;
jmis, en rapprochant quebjues opinions opposées, sans se prononcer,
sans rien décider, quitte à sc vanter ensuite dc son impartialité.
Tel savant, ijui s’est consumé poursc rendre compte, dans Homère,
d’une construction cpii rètonne, ou d’un présent mis pour un aoriste,
n’a jamais cherché à sc rendre compte de la marche générale dn poème,
cl de la vérité dc couleurs avec laquelle cn sont peints les divers inci-
dcns: en général, on lisoit isolément cbaiiuc morceau à-pcu-près ainsi
qn’ils avoient été chantés par les rapsodes; on donnoit peu d’altcn-
tioii à la correspondance que ces morceaux ont entr’eux, ct cette
négligence a beaucoup contribué à làirc croire l’iliadc un ouvrage de
rapjiort. ( L 'A u ie u r .)
'
'.'■3