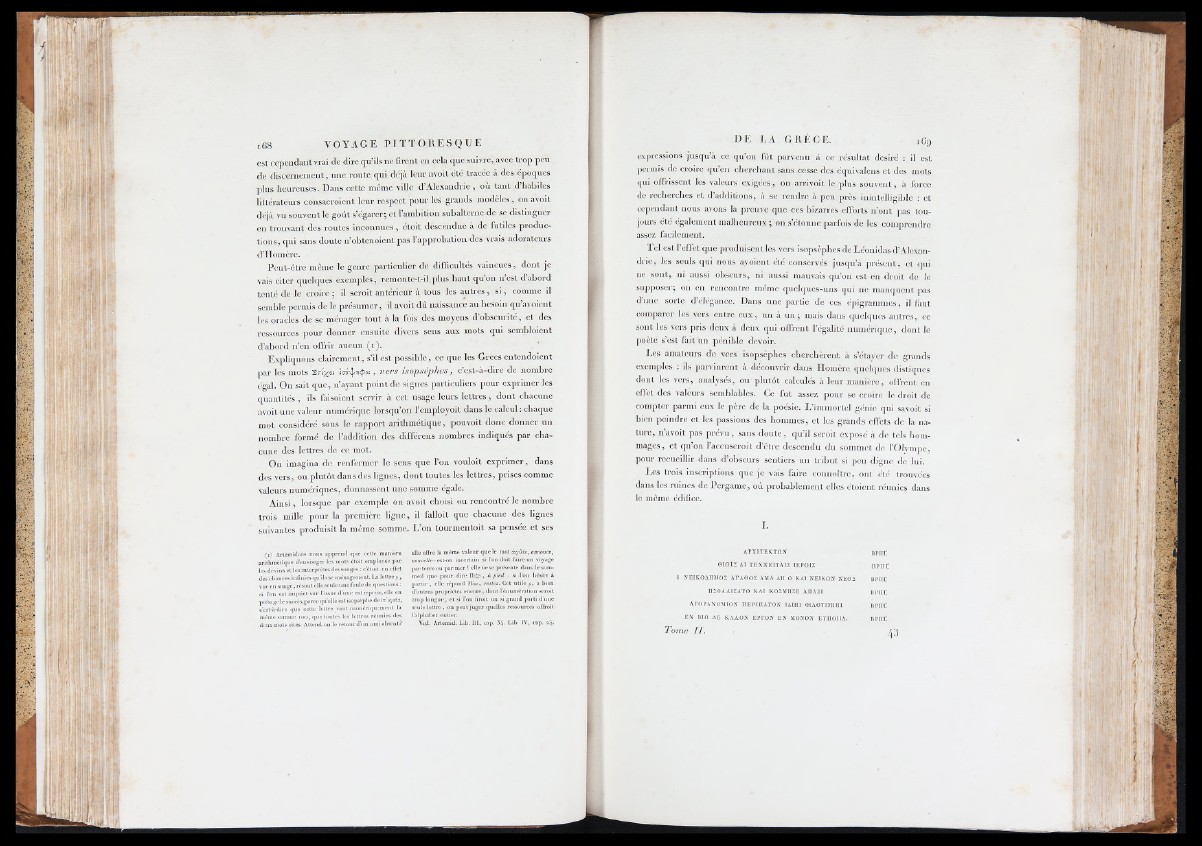
I s í i
pI
t e '-
M l
■ ikg-.'-
líV r i
est cependant vrai dc dire qu’ils nc firent eu cela que suivre, avec trop peu
dc discernement, une route qui déjà leur avoit été tracce à des cijoqucs
]>lns Itcurcuscs. Dans cette même ville d'Alexandrie , oii tant d’habiles
littérateurs consacroient leur respect pour les grands modèles, on avoit
dcjà vu souvent le goût s’égarer; cl l’ambition subalterne dc sc distinguer
cn trouvant des routes inconnues , étoit descendue a dc lutiics produc-
iioiis, qui sans doute n’oblenoient pas l’approbation des vrais adorateurs
d'Homcrc.
Peut-être inclue le genre particulier dc difiicultes vaincues, dont je
vais citer quefipies exemples, rcmontc-t-il plus liant qu’on n’est tl’abord
U'iitc dc le croire ; il scroit autcrieur à tons les autres, s i, comme il
semble permis dc le présumer, il avoit dù naissance au besoin qu’avoieiit
les oracles dc sc ménager tout à la fois des moyens d’obscurité, ct des
ressources pour donner ensuite divers sens aux mots qui scmbloiciit
d’.abürd n’cn offrir aucun (i).
Expliquons clairement, s'il est possible , cc que les Grecs entendoient
par les mots isiiiJnitSiii , v ers isopsèplws, c’cst-à-dirc dc nombre
égal. On sait que, n’ayant point de signes parlienlicrs pour exprimer les
quantités, ils faisoicnt servir à cet usage leurs lettres, dont cliacniic
avoil une valeur iinmcriquc lorsqu’on l’cmployoit dans le calcul : chaque
mot considéré sous le rapport arillimétiqiic, pouvoit donc donner un
nombre forme dc l’addition des différons nombres indiqués par clia-
cunc des lettres dc cc mot.
Ou imagina dc renfermer le sens que l’on vouloit exprimer, clans
des vers, ou plutôt dans des lignes, dont toutes les lettres, prises comme
valeurs numériques, doiiuasseiil une somme égale.
Ainsi , lorsque par exemple on avoit choisi ou rencontré lo nombre
trois mille pour la première ligne, il falloit que chacune des lignes
suivantes produisit la même somme. L ’on tourmcntoit sa pensée cl scs
( il Arlémidore nous apprenti que celle manière
arithmétique d'envisager les mots étoit employée par
les devins et les interprètes dessonges : c’étoit eu effet
des chances infinies qu'ils se ménageoient. La lettre p,
vue en songe, résout elle seule une foule de questions ;
si l'on est inquiet sur ris.sue d'une entreprise, elle eu
présage le succès,parce qu'elle est isoji.sèphe de h ' «r/sÆi,
c'est-à-dire quo celle lettre vaut numériquement la
même somme lo o , que toutes le.s lelires réunies des
deux mots cités. Altcnd-ou le rclour d'un ami absent?
elle offre la même valeur que le mot àvyàix, annonce,
nouvelle ; cst-on incertain si l’on doit faiie un voyage
par terre ou par mer? elle ne se pré.sente dans le sommeil
que pour dire IliÇi , à pied ; si l'on hésite à
jiarlir , elle répond Mi«, re.slcz, Cel utile p, a bien
d'autres propriétés encore, donl l’énumération seroit
trop longue ; et si l’on liroil un si grand parti d'une
seule lettre , on peul juger quelles ressources offroit
l'alphahel entier.
Vid. Artcmid. Lib. lll, cap. 34. Lib. IV, cap. a/(.
cxjircs.siOiis jusqu’à cc qu’ou fût parvenu à ec résultat désiré : il est
permis (le croire cpi’cn chcreliaiil sans cesse des cquivalciis cl des mots
qui olfrisseiit les valeurs exigées, ou arrivoit le jihis souvent, à force
dc reclicrclies ct d’aildilions, à se rendre à peu près iiiiiilelligililc : et
cepcndaiit nous avons la preuve que ces bizarres cl'forls ii’oiil ]kis loujours
été cgalcmeilt malheureux ; ou s’étonne parl'ois dc les comprendre
assez facilcuicjil.
Tel est l’effet que produisent les vers isopsèplics de Léonidas d’Alexandrie,
les seuls qui nous avoient été conserves jusqu’à présent, ct qui
ne sont, ni aussi obscurs, ni aussi mauvais qii’on est en droit de le
supposer; on en rencontre mémo quelques-uns qui nc manijucnl pas
(l'une sorte d’éltgaiico. Dans une parlic do ces (tpigramiiics, il faut
eoiiiparcr les vers entre eux, un à uu; mais dans qiielipies autres, cc
sont les vers pris deux à deux qui olfrcut fcgalilc numérique, dont lo
poète s’esl fait un pénible devoir.
Les amateurs de vers isopsêphcs clierdièrcnt à s’étaycr de grands
exemples : ils parvinrent à découvrir dans riomèrc quelques distiipics
dont les vers, analysés, ou jilulôt calculés à lour manière, olfreiil en
effet des valeurs semblables. Cc fut assez pour sc croire le droit do
compter parmi eux le père de la poésie. L ’immortel guinic qni savoit si
bien peindre el les jiassions des lioilimcs, et les grands elfcls de la nature,
n’avoit pas prévu, sans dontc, qu'il seroit exposé à de tels liom-
niages, cl qu’on rueeuseroit d’êlrc tiescemlu du sommet de l’GIvnipe,
pour recueillir dans d’obscurs sentiers un tribut si peu digue de hii.
Les trois inscriptions que je vais l'aire comioitrc, ont été tromarés
dans les ruines dc Pergame, oi'i probablement elles étoient réunies dans
le même édifice.
I.
APXITEKTfiN BPIir
0 IOI2 AI TEXiXElTAtS IEP0 I2 BPllC
1 NEIK0 AHM0 2 A r.\ 0 O2 AMA AU O KAI NEIKiiN NE0 2 BPIlC
II2 'I>AAI2ATO KAI K0 2 MII2E AI1A21 UPllE
Al’OPA.VüMION IIEPlllATON lAIIll -IMAOTIMIIII BPnC
EN II1ÍÍ AE KAAON EPI'ON EN MOXON EVIIOIIA. BPHE
Tonte I I . ■ /.3
■ Ê i
^ ' ' 3 1
1
/
/
11
M
/ ■
i
l
u.. i I ■