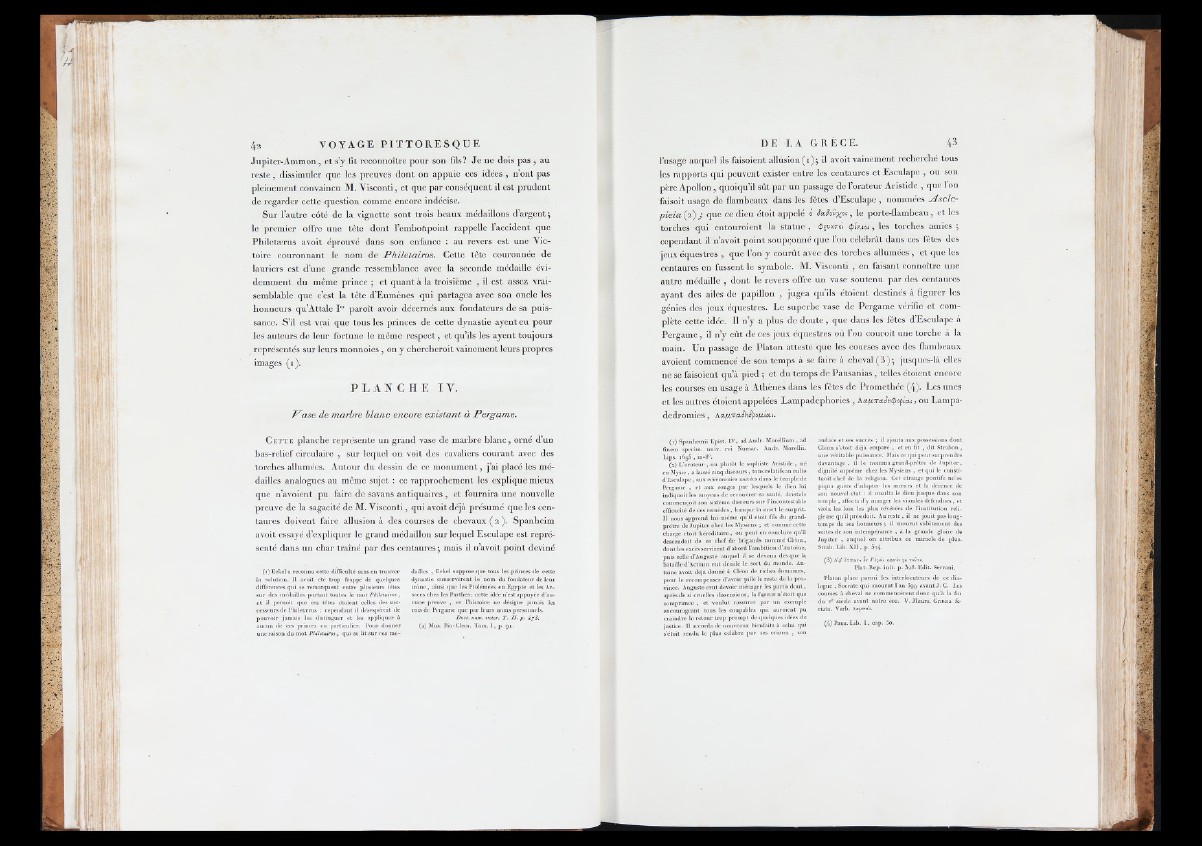
U'
Jupiter-Ammon, ct s’y fit rcconnoîlre pour son fils? Je ne dois pas , au
reste, dissimuler que les preuves dont on appuie ces idées , n’ont pas
pleinement convaincu M. Visconti, et que par conséquent il est prudent
de regarder cette question comme encore indécise.
Sur l’autre coté de la vignette sont trois beaux médaillons d’argent;
le premier offre une tête dont l’cmbofiipoiiiL rappelle l’accident que
Philctærus avoit éprouvé dans son enfance : au revers est une Victoire
couronnant le nom de Pkiletairos. Cette tète couronnée de
lauriers est d’une grande ressemblance avec la seconde médaille évidemment
du même prince ; et quanta la troisième , il est assez vraisemblable
que c’est la tète d’Eumènes qui partagea avec son oncle les
honneurs qu’AUalc I" paroît avoir décernés aux fondateurs de sa puissance.
S’il est vrai que tous les princes de cette dynastie aycntcu pour
les auteurs de leur fortune le même respect, et qu’ils les ayent toujours
représentés sur leurs monnoies , 011 y chercheroit vainement leurs propres
images (i).
P L A N C H E I V.
V^ase de marbre blanc encore existant à Pergame.
C e t t e planche représente un grand vase de marbre blanc, orné d’un
bas-relief circulaire , sur lequel on voit des cavaliers courant avec des
torches allumées. Autour du dessin dc ce monument, j’ai placé les médailles
analogues au même sujet : ce rapprochement les explique mieux
que n’avoicnt pu faire de savans antiquaires, el fournira une nouvelle
preuve dc la sagacité de M. Visconti, qui avoit déjà présume que les centaures
doivent faire allusion à des courses de chevaux ( 2 ). Spanhcim
avoit essayé d’expliquer le grand médaillon sur lequel Esculape est représenté
dans un char traîné par des centaures ; mais il n’avoit point deviné
(i) Eckel a reconnu cette difficulté sans en trouver
la solution. Il avoit été trop frappé de quelques
différences qui se remarquent entre plusieurs têtes
sur des inédaille.s portant toutes le mol Phileiairos,
et il pensait que ces têtes étoient celles de.s successeurs
de Pliiletærus : Cependant il désespéroit de
pouvoir jamais les dislinguer et les appliquer à
aucun de ces princes en jiarticulicr. Pour donner
une raison du mot Philctairas , qui se lit sur ces raédailles
, Eckel .suppose que tous les princes de cette
dynastie conservèreut le nom du fondateur de leur
trône , ainsi que les Ptoléniécs en Egypte et les Ar-
saces ciiez les Partbes ; cette idée n’est appuyée d’aucune
preuve , el riiisloire ne désigne jamais les
rois de Pergame que par leurs noms personnels.
Ûocl. num. vecer. T. U. p. 4j 3.
(a) Mus. Pio-Cleui. Torn. I , ji. 91.
t
l’usagc auquel ils faisoicnt allusion(i); il avoit vainement recherché tous
les ra¡)ports qui peuvent exister cuire les centaures et Esculape , ou son
père Apollon, quoiqu’il sût par un passage de l’orateur Aristide , que 1 ou
faisoit usage de flambeaux dans les fêles d’Esculapc , nommées A s c le -
pieia (2) J que ce dieu étoit appelé ó , le porte-ííambeau, cl les
torches qui entouroient la statue , (p^v/.To'i (pixm , les torcixes amies ;
cependant il n’avoit point soupçonné que l’on célébrât dans ces fêtes des
jeux équestres , que l’on y courût avec dos torches allumées , et que les
centaures en fussent lo symbole. M. Visconti , en faisant connoître une
autre médaille , dont le revers offre un vase soutenu par des centaures
ayant des ailes de papillon , jugea qu’ils étoient destinés à figurer les
génies des jeux équestres. Le superbe vase de Pergame vérifie et complète
cette idée. Il n’y a plus dc doute, que dans les fêtes d’Esculape à
Pergame, il n’y eût de ces jeux équestres où fou couroit une torche à la
main. Un passage dc Platon atteste que les courses avec des flamlDcaux
avoient commencé de son temps à sc faire à cheval ( 3 ) ; jusques-là elles
ne sc faisoient qu’à pied ; et du temps dc Pausanias, telles étoient encore
les courses en usage à Athènes dans les fêles dc Proinethéc (4)- Les unes
ct les autres étoient appelées Lampadephories , Act/xTrAnèiio^icti > ou Lampa-
dcdromies, AapTa.<hilfo/j.icti.
(1) .Sp.inliemii Epi.st. IV, ad Aiiclr. Moreliium , ad
spcci.) Numar. Aiïdr. Morellii.
Lips. ifigS , .
G) L’orateur , ou plutôt le sophiste Aristide , né
en àlysic , a laissé cinq discours, tous relatifs au culte
dXsculape , aux cérémonies usitées dans le temple de
Pergame , et aux songes par lesquels le dieu lui
indiquüit les moyens do recouvrer sa santé. Aristide
commciiçoit sou sixième discours sur l’incontestable
efficacité de ces remèdes , lorsque la mort le surprit.
Il nous apprend lui-même qu’il étoit fils du grand-
prêtre de Jupiter chez les Mysiens ; el comme cette
charge ctoit héréditaire , on peut on conclure qu'il
descendoit de ce chef de brigands nommé Cléou,
dont les excès .servirent d’abord l'ambition d’Antoine,
puis celle d’Auguste auquel il se dévoua dès tjue ia
bataille d'Actium eut décidé le sort du monde. Antoine
avoil déjà donné à Cléon de riclics domaines,
pour le récompenser d’.avoir pillé le re.ste de la province.
Auguste crut devoir ménager les partis dont,
après de si cruelles dissen.sious, la fureur n'étoit que
comprimée , et voulut rassurer par un exemple
encourageant lous les coupables qui -auroient pu
craindre ie retour trop prompt de quelques idées de
justice. 11 accorda de nouveaux bienfaits à celui qui
s’éloit reiulii le plus célèbre par ses crimes , son
audace el ses succès ; il ajouta aux possessions dont
Cléou s’ètoit déjà emparé , et en fit , dit .Strabon ,
une véritable puissance. Mais ce qui peut surprendre
dav.aniage , il le nomma grand-prêtre de Jupiter,
dignité suprême chez les Mysiens , et qui le coiisti-
tuoit chef de la religion. Cet étrange pontife ne se
piqua guère d’adopter les moeurs et la décence de
sou nouvel élat ; il insulta ie dieu jusque dans son
temple , affecta d'y manger les viandes défoiidiies , et
viola les loix les plus révérées de l'instilulion religieuse
qu’il présidoit. -Au reste, il ne jouil pas longtemps
de ses honneurs ; il mourut subilemeiit des
suites de son intempérance , à la grande gloire d»
Jupiter , auquel on attribua ce miracle de plus.
Strab. Lib. X l l , p. 5i 4 .
(3) A>- Iv xaiv.'r tovt..
Plat. Rcp. iuit. p. 328. Edit. Serrani.
Platon place parmi les interlocuteurs de ce dialogue
, Socrate qui mourut l’aii 899 avant J. C. Les
courses à cheval ne commencèrent donc qu'à la fin
du v ' siècle avant notre ère. V. Meurs. Ciiecia fe-
riata. Verb. Saptrii.
G) Paus. Lib. T, cap- 3o.