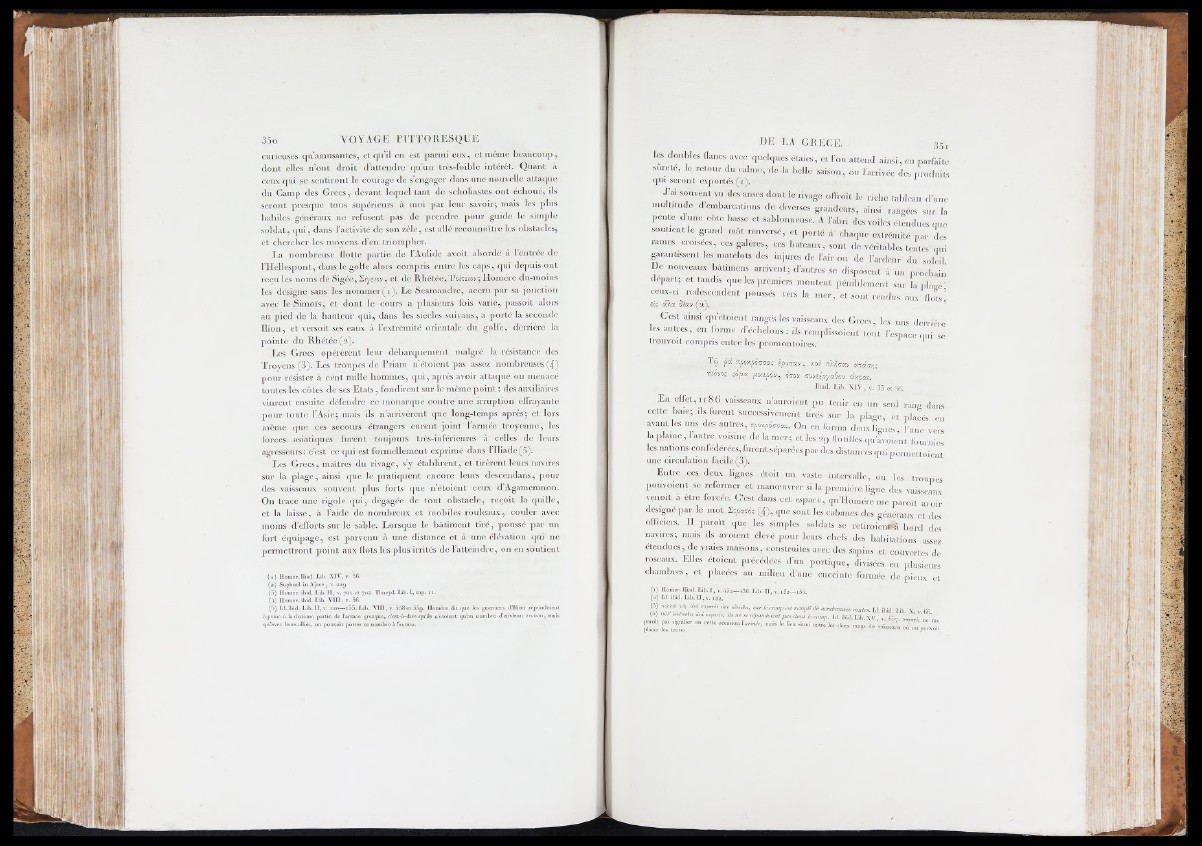
cuncLiscs qu'amusanLes, cU p i’il cn est ¡»anni eux, elniênio beaueoiij),
dont elles n’ont droit d’aLü'iidrc c[u’un Lrès-foible intérêt. Quant a
ceux <[ui sc sentiront lo courage de s'engager dans une nouvelle attaque
du Camp des (irccs, devant lequel tant do scholiasles ont échoué, ils
seront prcs([iic tous supérieurs à moi par leur savoir; mais les j)lus
habiles généraux uo rcfusciil jias de ¡»rendre pour guide lo siinjile
soldat, ([lli, dans l'activité dc son zèle, l'sl ailé reeonnoître les obstacles,
et cbcrebcr les movens d’en trionqilier.
La nombreuse iloLle partie de rAulido avoit abordé à l’entrée de
rllellcspont, dans le gollc alors compris entre les cajis, qui depuis ont
recules noms dc Sigée, î^ t y iio y , ct de Rhétée,'P o iv n o v ; llomère du-moins
les désigne sans les noiuiuer(i). Le Scamandre, accru par sa jonction
avec le Simoïs, ct dont le cours a plusieurs fois varié, passoit alors
au pied de la hauteur (jui, dans les siècles suivans, a porté la seconde
llion, CL vcrsoit ses ('aux à l'extrémité orientale du golfe, derrière la
pointe du Rhétée (12).
Les Grecs opérèrent leur débarcjuemcnl malgré la résistance des
Trovcns (3). Les tronjies de Priam iVétoionl pas assez nombreuses (4)
pour résister cà cent mille hommes, qui, après avoir aLla(|ué ou menacé
toutes les côtes dc ses Etals, fondirent sur le même point : tlesauxihair<;s
vinrent ensuite défendre ce monarque contre une irruption elfrayanic
pour toute l’Asie; mais ils n'arrivèrent (pie long-tcmjis après; ct lors
même que ces secours étrangers curent joint l’armée troyeunc, les
forc(;s asiati([iies furent toujours irès-iuféricurcs à celles dc leurs
agresseurs; c’est cc qui est formellement cxj»rimé dans l’Iliade(5).
Les Grecs, maîtres du rivage, s’y éta]»lirent, ct tirèrent leurs navires
sur la plage, ainsi que le pratiquent encore leurs dcsccndans, pour
(les vaisseaux souvent plus forts que n’étoicnt ceux d’Agamenmon.
On trace une rigole qui, d(*gagéc dc tout obstacle, ro<;oil la <piillc,
et la laisse, à l’aide de nombreux ct mobiles rouleaux, couler avec
moins d’efforts sur le sal»lc. Lorsque h» bâtiment tiré, poussé ¡»ar un
fort équipage, est j>arvcnii â imc distance ct à une é'iévation (jui nc
permettront point aux flots les plus irrités de l'atteindre, on en soutient
( I ) 1 lomer. Uiad. Jl.il>. XIV, v. 3G.
(2) Sopliocl.iiiAjacc, V.419.
(5) Ilonicr. ibid. Lib. II, -v. 701 el 702. Tbucyd. Lib. !, c.-ip. 11.
(.1) llomcr. ibid. Lib. V l i l , V. 56.
te) Id.ibid. Lil). JI, Y. 320— i 35. Lib. V l l l , V. 558 Cl 559. Uomèrc dil (1110 les gucrrici;. d’Ilion iciiuiiiîoiciil
.1 peine à la dixième parlie dc l’armée grecque, c’esl-à-dire qu’ils a’éujieril qu’au nombre d’environ 10,000, mais
qii’a\cc leurs alliés, on pouvoil porler cc nombre à 5o,ooo,
les douilles ilanc.s .avec ,|uel.,„cs <'.taie.s, cl Ton attend ainsi, cn parlkite
sureté, le retour d.t caltne, ,1c la heile sai,„n„ ou l'arrivée .les produHs
qui seront exj»ortés (i).
.f’ai souvent vtt des .anses dont ic rivage olíVoil le riche tablean d'une
multitude d'.nnb.arcal.ous .le diverses gra,«leurs, ainsi raugécs sur la
])entc .Iniie côte liasse ct s.ililoniieuse. A l'aliri des voiles étendues qu.-
soutient le gran.l mât renversé, ct jiorté â elia,|uc extrémité par des
rames croisées, ces galères, ces liatcaux, sont de vérital,les lentes qui
g,arant,ssei,t les matelots <l.-s injures de l'air ou dc l’ardeur du soleil
De „onvcaux liâlimens arrivent; d’autres sc disposent à un pro.liaii,
dejiart; et taudis que les premiers moment péniblement .snr Ja |,l «.c
ceiix-ei redcseendom jioitssés vers la mer, et sont rcu.lus aux lloîs’
siç álce Oiay ^
C’est ainsi <|n’étoicm rangés les vaisseaux des (irees, les uns derrière
I.-S autres, en l'omie d’échelons : ,1s reinpli.ssoi.-nt lom i'e.,p,ice qni se
IrouvoiL compris entre les promontoires.
I '2 py. T.pov.pcoyy.ç ip - ja y .'j, v.y} z):r,/7yy 'j- .à .n r t
•/îtovoç çopa pay.pdv, ¿Voy ü - rjú p y y [)o 'j á v .p a i,
Iliad. U , . X ) V , V. 35 CL 36.
Ell elfct, 1 ,8 6 ..ahsscaux „ ’aiiroiciil pu tenir ou m, seul ram.- ilans
cette Iiaïc; ,l.s lurent .suecessivomem tirés sur la plage, cl plaY-s eu
avant les uns .les .autres, Ou en forma dcnxiigncs, l’une ver,
la pl.,me, I autre voi,sinc de lamer; et les a., Ilm.lles .ju’avoiem l ’onrnh-!
les nations confédéréc,s, furent séparées j.ar des distances ,,ni pcrnictloiem
une circulation lacile (3).
Entre ces deux ligues éloit uu vaste intervalle, ou les troupes
pouvoicnt se reformer cl manoeuvrer si la première ligue des vaisse.-iux
venoil à cire forcée. C’est dans cet espace, qu’UomèrYne iiaroit avoir
désignc par le mot (4), .(ne sont les cabanes des généraux .-t des
olhcicrs. 11 jiaroît <,nc les simiihis soldats se reliroiem -à bord des
navires; mais ,1s avoiem elevé (loiir leurs eliefs .les iiabilallons assez
élciidiics, de vraies maisons, construites avec des sapins et couvertes de
roseaux. Elles éloient précédées d’un j.orlique, divisées en plusieurs
cliaiiihres, ct placées au milieu (func encciiUc formée de pieux et
(i) Home-. Ilitul, Lil>. ( , r - 452— wG.Llb. I l, v. i 52— i 5 i
(a) L l il)i<I.Lil>,II,v.2,'5a.
Î a Wwrav«,w£,p,,.i<i.ibi<).Lib. \ V GG
(•1) OoJ „.Jari,, xr» rrp«»/; ûs ne serépanchion!pas dans h camp. Ll. ibid. Lib. XV y G57 '
;z: ™ ”
’. . 'I . k;î
r ? V .
f : .1
’ -i: j ■ ! 11
' i l ; .
’ 1 1 '
i . ) l A
% i- A J •4.
f l . : : #
, y
h'
Y' il
r . '
<
J