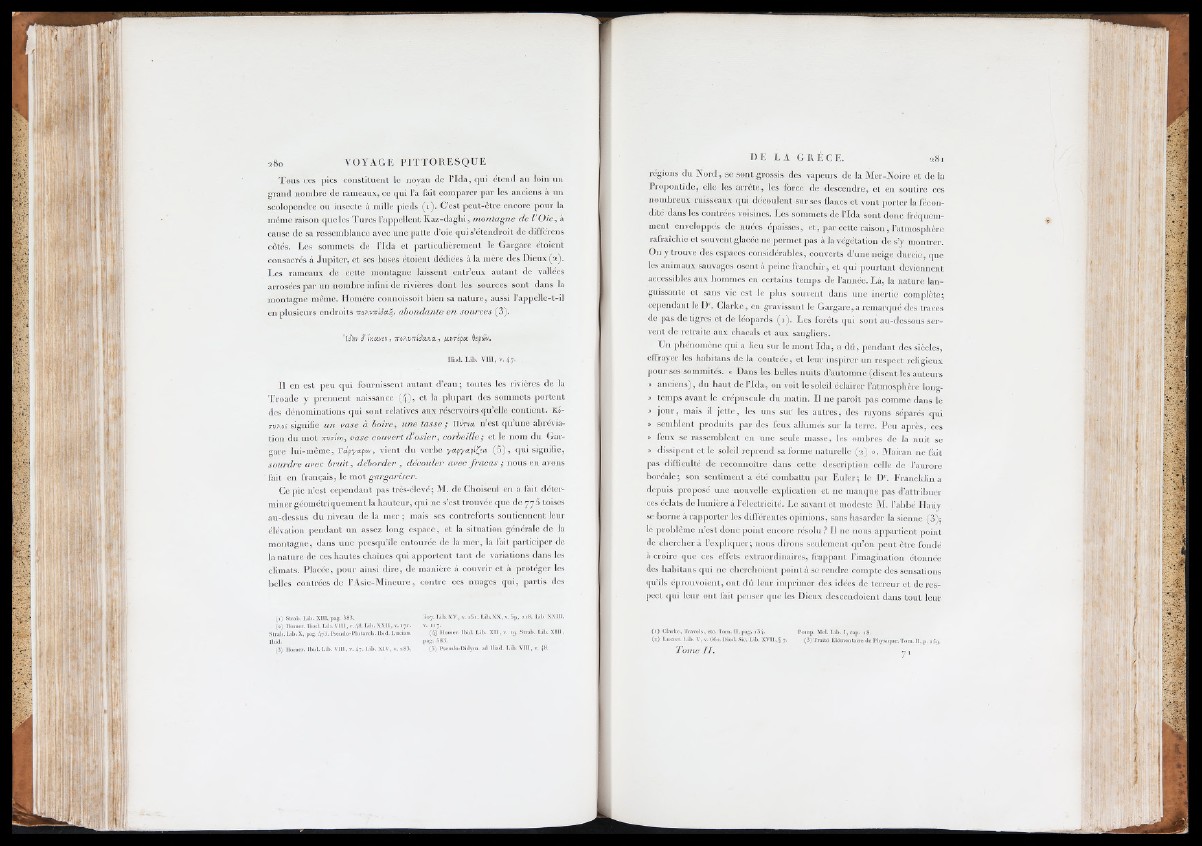
i
'il 7
i l '
m
te
Z-y
\
if : J
'îifr
Tous CCS pics coiisliUioiiL le noyau de t’ ida, <iui ct.ciid au loin uu
grand nombre dc rameaux, cc qui Ta l'ail conqiarcr ¡»ar les anciens à nn
scolopendre ou insecte à mille ¡»icds ( i) . C’csl peiit-èlrc eucore ¡»our la
nièine raison que les Eurcs ^a¡»¡»ellcJU Ka/.-daghi, monlag/ie de l Oie., a
cause dc sa ressemblance avec une paLlc tl’oie qui s’ctciidroit dc dil'iereiis
cülés. Les sommels dc l’ Ida el parlicuiièremenl le Gargare éloicuL
consacrés à Jupilcr, ct scs bases éloicnl dediées à la mere des Dieux (2).
IjCS rameaux de colle monlagne laissent enlr’eux aulaiil de vallées
a r r o s é e s par un nombre iiilini dc rivières donl les sources sont dans la
montagne meme. Homère coimoissoil bien sa nalure, aussi rappellc-L-il
cn plusieurs endroits TroAute/a^, abondante en sources (3).
libiv J ixavsv, 7roAu7r»cTaxa 5 /myitî^o. fispav.
Iliud, Tdb. VIII, V. 47.
Tl en esl peu qui fournisscnl aulant d'eau; toutes les rivières de la
Troade v prennent naissance (4), cl la plnj»art des sommets ¡»orleiil
des dénominations qui sont relatives aux réservoirs qu’elle coiiüenl. K ô -
7-uAoç signifie un vase à boire., une tasse ; nérva n’est (¡u’unc abréviation
du mol TTvrm, vase couvert d ’o s ie r , corbeille ; et le nom du (iar-
gare lui-mème, rùpyapov, vient du verbe (5) , qui signifie,
sourdre avec b ru it, déborder , découler avec fra ca s y nous en avons
lait cn français, tc mol g(27-jOrj/7'Ato-.
Ce pic n’est cependant pas Irès-élcvé; M. dc Choiseul cn a fait déterminer
géomélriqucmeiil la hauteur, (¡ui nc s’est trouvée que de yyS loises
au-dessus du niveau de la mer ; mais scs conlreforls souüennenl leur
élévali(»ii peiidanl uu assez long es[»acc, ct lu silualion gcniéralc dc la
montagne, tlans une prestpi’ilc entouriic tle la mer, la l'ail ¡»arliciper de
la nature de ces hautes chaines qui ap|»orleiil lanl de variations dans les
climats. Placée, ¡»oiir ainsi dire, tle manière à couvrir el à proL(‘gcr les
hclles contrées dc l’Asic-Miiieiirc, conlrc ces nuages qui, partis ties
(i) Siral>. Lib. XI!1, )iag. .583.
(a) Humer, lliad. Lib, \ 111 , v, 48. Lib. XXll, v. 17 1.
Strab. Lili.X, pag. Iffi. PseiKio-l’ liilarcli. Ibid. Liiciaii.
Ibid.
^3) llomcr. Jbid. Lib. \ l l l , v. .'17. l.ib, Xl\ , v, aS3,
307. I.il.. X V , V 5 i.L ib .X X ,y .59, 2 i8. l.ib X.XIII,
(.4) Homer, ll.id. Lil». Xll 9. Slrab, Lib. X lll,
I.a». ,583.
I'seud..-I»id>m. ad lliad. I.ib. VIH , v. .jH.
régions du Nord, se sont grossis des vapeurs do la Mer-Noire el ilc la
Projionlide, elle les arrête, les force de tlcsccndre, cl en soutire ces
nombreux ruisseaux (¡ui découlenl sur scs ilaucs cl vont ¡»orler la fécoii-
tlilé tlans les eoiilriies voisines. Les sommels dc l’Ida sont tlonc ^^■(¡ucm-
mcnl enveloppés dc nuées épaisses, et, par celle raison, l’almosphcrc
rafraîchie cl souvenlglacéc ne ¡»ermcl pas à la végélalion de s’y moiilrcr.
On y trouve des es¡)accs considtirahics, couverts d’une neige durcie, que
les animaux sauvages osent a ¡»eine franchir, cl qui ¡»ourlant devicunenl
accessibles aux hommes cn eerlains temps de l’année. Là, la nalure lau-
guissaiile cl sans vie csl le phi,s souvent dans une iiK-rlic com¡)lèlc;
cc¡»entlanl le D'. Clarkc, cn gravissant le Gargare, a remarqué des traces
dc ¡»as dc tigres et de léopards ( i) . Les forêts qui sonl au-dessous servent
dc relraile aux chacals ct aux sangliers.
Un phénomène qui a lieu sur le monl Ida, a dù, pendant tics siècles,
oni'aycr les liabilans de la coiilréc, el leur ins|»ircr un resj»eel religieux
¡»our scs soimujlés. » Dans les belles nuits d’automne (disent les auteurs
» anciens), du liaul de l’Ida, on voit le soleil éclairer ratmosphèrc long-
» temps avant le cr(q»uscule du matin. Il ne ¡»aroît pas comme dans le
» jour, mais il jeLLe, les uns sur les autres, des rayons stq»arés qui
» semlilcnl ¡»rotlulls par dos feux allumés sur I;i terre. Peu aj»rès, ces
» feux sc rassemblent en une .seule masse, les ombres dc la nuil se
» dissij»euL el le soleil rcj)rentl sa forme iiaLurelle (2) ». Mairuii nc lait
|»as diificullé de reeoiinoîlre dans celle tloscrij»lion celle dc faurorc
b(»r(ùle; son scntimonl a été combaltu par Eulcr; le D'. Frauckhn a
depuis ]»roj»osé une nouvelle explication cl ne manque pas d'allriliuer
ces éclals de lumière à rOeclricilé. Lo savaul cl motlosLc M. l’abhc Haüy
su borne à rapporlcr lus différcnlcs opinions, sans hasarder la sienne (3);
le problème ii’esl donc point encore résolu ? 11 ue nous apparlicnl poiul
de chercher à l’exjili([uor; nous dirons sculcmeiiL (¡u’on ¡»ciiL élre fondé
à croire (¡uc ces cCfels cxlraordiiuùrcs, (rappanl l’imagination élonnik
des hahilans qui no ehcrchoicnl ¡»oiiiL à sc rendre compte des sensalions
([ii’ils ('¡»roiivoicnt, onl dù leur imprimer des idées dc terreur cl de res-
pecl (jui leur onl làil penser ([tie les Dieux descciidoienl tlans loul leur
(I) Clarko, iMvcIs, cto. Tom, II, pag. i 3.'|.
(a) Lucrol. I,ib. V, v, (iba. Diod. .Sic. Lib. XV11,Ç
Tome I I .
Pomp. Mcl. Lib. 1, cap. i8.
(3) Trailé Élcniuiitairc de Physique. Tom. II, p. j S9.