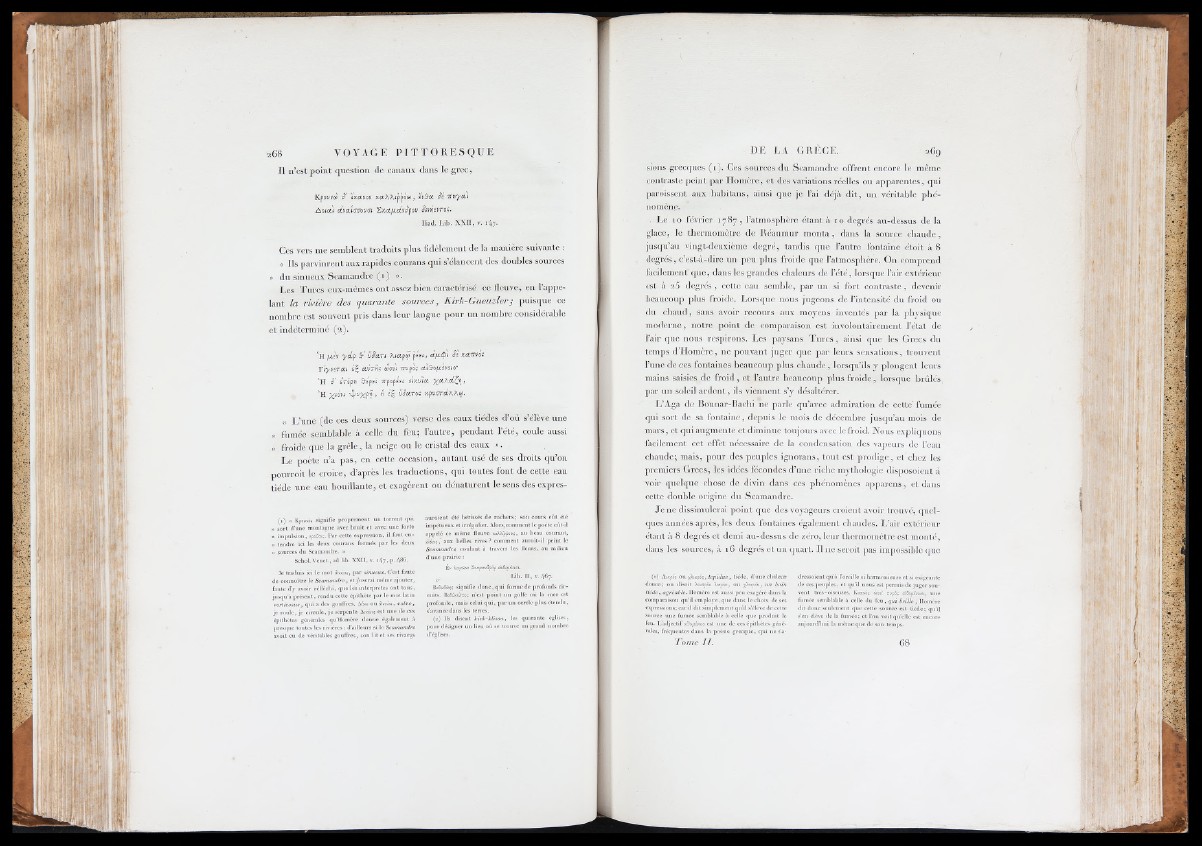
r i ' • j ¡1
Vi# '
A»
i i
te?
V-tej
IpfA
M '
-7
2G8 V ( ) Y A G E P i T T O R E S Q U E
il n'csl point question de canaux dans lo grec,
Kpobvd L ¡y.avQV xaAAippoa, 'in^ct ¿~î imycti
Aoict) dvcÎKTiTovin ^Kcty-dvdfov thvtisvroç.
lliad. L ib . X X I I , V. 1/17.
Ces vers me semlilcnl traduits plus Iklèlcmcnt dc la manière suivante :
. Ils parviiireul aux rapides courans qui s’clancont des doubles sources
» du sinueux Scamandre ( i ) ».
Les Turcs eux-iucmcs onl assez bien caractérisé co lleuve, cn l’appelant
/a rivière des i/uararte so u r ce s , K ir k -G u e u z le r ; i)uis(|uc cc
nombre est souvent pris dans lour langue pour un nombre considérable
Cl indéterminé (2).
' h ,u îv y c tp vh.Ti A i a p a p iâ i, dfj.fi S I K0.7Vik
ViynTM ct'Jrfiç oursi Trupo; a.\5nfiivoio’
'H S' sVip« 0 i ï Trpopki iV/.vict
' h ;<^îou SSctTOi xpuiTTttAAw.
c. L'une (dc ces deux sourccs) verse des eaux tiédes d’où s’élève une
» fumée seniljlalde à celle du feu; l’autre, pendant l’été, coule aussi
I) froide que la grêle, la neige ou le cristal des eaux ».
Le poète n’a pas, en cette occasion, autant use dc scs droits qu’on
pourroit le croire, d’après les traductions, qui toutes font de cette eau
tiède une eau bouillante, et exagèrent ou dénaturent le sens des expres-
(i) « Kpovvdi signifie projirement un torrent qm
sort (l’une mont.igne avec bruit et avec une forte
> im|)ulaioii, y.çoCoi:. Par celte expression, il faut en-
» icndre ici les deux courans formés par les deux
» sourccs du .Scamaiulre- »
Scliül, Vcnet., ad llb. XXII, v. 147, p. 486,
Je traduis ici le mol Saim, par sinueux. C'est faute
dc connoître le Scamandre, et j'oserai mciup ajouter,
faute d'y avoir rélléchi, que les interprètes ont tous,
jusqu’à présent, rendu cette épitliele par le mol latin
porii'eosiis, qui a de» gouffres. Aïvoi o u 5wiA), volvo,
je roule, je circule, je .serpente. Ùi-Mii; esl une dc ces
épitliètes générales iju'llomère doiiiic également à
presque toutes les rivières ; d'ailleurs si le Scamandre
avoit eu de véritables gouffres, son Ht et scs rivaegs
auroient été hérissés dc rochers; son cours ei'il été
impétueux et irrégulier, Alors,comnicnt le poète eùt-il
appelé ce même fleuve xaïXppoo;, au beau courant,
éiiÎEi;, aux belles rives? comnieiU anroit-il peint le
Scamandre coulant à travers les fleurs, au milieu
d'une prairie ;
Év l.uçcivi Xzapavipéi) àvSepoiVZi.
Lib. il, V. 467.
RaCoSm; signifie donc, qui forme de ¡irofonds circuits.
mOézcXiTo; n'est point un golfe où la niCr esl
profonde, mais celui qui, par un cercle plus étendu,
s’avance dans les terres.
(2) Ils disent kirk-klissa, les quarante églises,
pour désigner un lieu où »e liouvc uu grand iionibic
d'êalise.s.
.sioiis grcc([U0S ( i) . Cc.s sourccs du Scamandre oflrciit encore le même
coiilrasle peint par Ilomcrc, ct des variations réelles ou apparentes, qui
paroissent aux habitans, ainsi qnc je l’ai déjà dit, uu véritable plié-
iiomèiio.
Le 10 février 1787 , ratmosphèrc étant à 10 degrés au-dessus de la
glace, le thermomètre dc Réaumur monta, dans la source chaude,
ju-squ’aii vingt-deuxième degré, taudis f|ue l’autre fontaine ctoit à 8
ticgrés, c’esl-à-dirc un peu plus froide que l’almosjihcrc. On comprend
facilement (juc, dans les grandes cfialeurs de fiàc“, lorsque l’air extérieur
est à 9.5 degrés, cette eau semble, par un si fort contraste, devenir
l)caucoiip [)Iits froide. Lor.squc nous jugeons de riiileiisilé du froid ou
(lu chaud, sans avoir recours aux moyens inventés par la plissique
moderne, notre jioiiit dc comparaison est involontairement félat de
l'air que nous respirons. Les paysans Turcs, ainsi que les (irccs du
temps d’Homère, nc jfouvant juger que par leurs sensations, trouvent
l’une de ces fontaines beaucoup plus chaude, lorsqu'ils y plongent leurs
mains saisies do froid, et l’autre beaucoup plus froide, lorscpie Ijrùlcs
par un soleil ardent, ils viennent s’y désalüà’cr.
L ’Aga de Bouiiar-Bachi nc parle qu’avec admiration dc cette' fumée
(|ui sort de sa foiilaiiio, dcjjuis le mois de décciiibre jus(|ivau mois de
mars, et (jui augmente et diminue loujours avec le froid. Nous ('xpli(pioas
làcilcmont cet effol nécc'ssairc de la condensation des vajjcurs de l’eau
ciumdc; mais, pour des peuples ignorans, Loul est prodige, ct chez les
premiers (irccs, les idées fécondes d'une riche mylliologic disposoieiil à
voir (piclifuc chose dc divin dans ces phénomènes appareils, ctdans
cetlc double origine du Scamandre.
J e ue dissimulerai point (pie des voyageurs croient avoir lrouv(‘, (picl-
qncs années après, les deux l'onlaincs ('gaiement eliandcs. L'air extérieur
(’tant à 8 degrés et demi au-dcs.sus do z(à'o, leur lliormomèlrc csl mout(û
daus les .sources, à 16 degrcS ct un quart. II nc scroll pas impossible (|uc
(0 A(«o'i ou tepidus, liêdc, iriine chtiicur
chnirc; ou dUoil hovzpm Xiaoov, uu yhapiv, un bain
tiède, agréable. Homère est nu,si pou exagéré dan» la
Compiuaisoii qu’il omployc, que dans Ic elioix do ses
cxjiressioiis: car il dil .sinqiloiiieiit qu'il s'élève do cette
.‘'Ouvco une fumée semblable à celle <|ue produit le
feu. L'adjcclif xCûusvoio csl une de CCS épitliètes générales,
frêqneiitc.s dans la poésie grecque, qui nc s'a-
' i o i n e i l .
drcssoient qu'à l'oreille .si baniioniense et si exigeante
de ces peuple». el «|u'il nous (
l permis de juger soii-
vent Irés-oiseuscs. Karrè,-
fumée semblable à celle du f
dit donc sciilcnicnt que cette
s'en élève dc ia fimiêc; ct l'oi
atijotird'iaiL la même «juc de s
I , qui brille , Homère
lOurce est tiède; qu'il
voit quelle est encore
u tcinjis.
G8
T