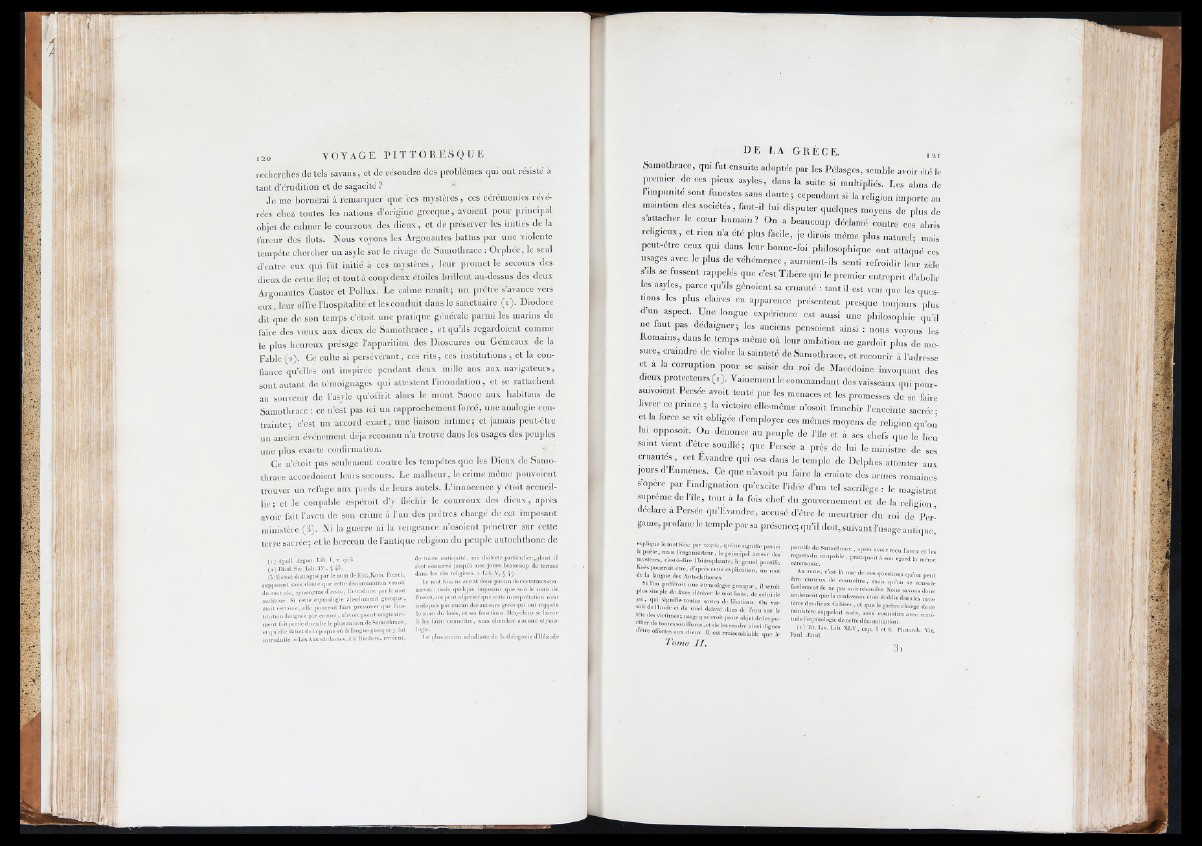
i-eclicrchcs de tels savans, ct dc résoudre des problèmes qui ont résisté à
tant d’cruditioii et dc sagacité ?
Je me bornerai à remarquer que ces mystères , ces cérémonies révérées
cliez toutes les nations d’origiiic grecque, avoient pour prineiiial
objet dc calmer le courroux des dieux, ct dc préserver les initiés dc la
fureur des Ilots. Nous voyous les Argonautes battus par uuc violente
tempête cbcrclier un asyle sur le rhage dc Samotlirace : Orpliee, le seul
d’entre eux qui lût liiilié à ces mystères, leur promet lo secours des
dieux dc cette île; el tout i coup deux étoiles brillent au-dessus des deux
Argonautes Castor ct Pollux. Le calme renaît; un prêtre s’avance vers
eux, leur offre riiospitalité ct les conduit daus le sanctuaire ( i) . Diodorc
dit que de son temps c’èloit une pratique générale parmi les marins de
['aire des voeux aux dieux dc Samothrace, ct qu’ils rcgardoiciil comme
lo plus licurcux présage l’apparition des Dioscures ou Gémeaux dc la
Fable (2). Cc culte si persévérant, ces rits, ces iiistitulioirs , ct la con-
fiaiicc qu’elles ont inspirée pendant doux mille ans aux navigalcurs,
sont autant de témoignages qui alleslcnt l’inondation, el sc ratlaclieiit
au souvenir de l’asyle qu'ollrit alors le mout Saoco aux liabilaiis dc
Samotlirace ; cc n’est pas ici uu rapprocliement force, une analogie contrainte;
c’est un accord exact, une liaison intime; ct jamais peut-être
un ancien événement déjà rccoiinii n'a trouve daus les usages des peuples
une plus exacte coiiürmaüoii.
Cc n’étoit pas seulement contre les tempêtes que les Dieux dc Samothrace
accordoient leurs secours. Le malheur, le crime mémo pouvoicnt
trouver uu refuge aux pieds de leurs autels. L ’iiiiiocencc y étoit accueillie
; ct le coupable espéroit d’y lléebir le courroux des dieux, après
avoir fait favcu dc sou crime à fuii des prêtres cliargc dc cet imposant
ministère (3). Ni la guerre ni la vciigcaiicc ii’osoicnt pénétrer sur ccUo
terre sacrée; ct le berceau dc l’aiitique religion du ¡icuplo autoelitlionc dc
(1) Apoll Argon. Lib. I, v. giC.
(2) Diod. Sic. Lib. IV , § 43
(3) Il étoii distiiiguó par ie nc
9iippo.»aiU sans doute que cel
1 (1l-Kîi;î,Ko?.s. Frerel,
déiiominalioii venoit
............................... raU’udnile par le mot
andiUnr. .Si celle étymologie absohmicnl grecque,
étoit ccrlaiiie. elle pourroil faire présumer que l'ins-
tilulion désignée par ce mol, n'avoil point originaire-
roeiu fait parlieduculle le pln.sancien de Siiraollirace,
et quelle daloil de lepoqucoù la langue grecque y fui
iiUroduite. « Les Aulochllione.s, dit Diodorc, avoient.
(le toute antiquité, un dialecte parlictilier, dont il
s’est con.servé jusqu’à no.s jours beaucoup dc termes
dans les rils religieux. » Lib. V, § 47.
Le mol Kir.i ne seroit donc pa.s un dcces termescon-
senés : mais quelque imposant que soit le nom de
Frerel, on peut objecter que celle inlerjirélalion n’est
indiquée par aucun dcsaulcurs grecs (¡ui oui rajipelé
le nom (lu k.K-s, el ses fonctions. Ilésycliius se borne
à les làirc coimoilre, sans clierclicr aucune étymologie.
Le plus ancien scljoliaste de la lliéogonio J'IIésioJe
Samotlirace, qui fut ensuite adoptée par les Pélasges, semble avoir été le
premier de ces pieux asyles, dans la suite si multipliés. Los abus de
fimpiinitc sont funestes sans doute; cepciulaiit si la religion importe au
maintien des sociétés , faul-il lui disputer quelques moyens dc plus dc
s’attacher le coeur liiimain? On a beaucoup déclamé contre ces abris
religieux, et rien n’a été plus facile, je dirois même plus naturel; mais
peut-être ceux qui dans leur bonne-foi pliilosoi,bique ont attaqué ces
usages avec le plus de véhémence, auroicnl-ils senti refroidir leur zèle
s’ils sc fussent rappelés que c’est Tibère qui le premier entreprit d’abolir
les asylcs, parce qu’ils gênoiciil sa cruauté : tant il est vrai que les quc.s-
tioiis les plus claires en ajiparcnce préseiileiil presque toujours iilus
d’un aspect. Une longue expérience est aussi une pliilosojiliie qu'il
ne faut pas dédaigner; les anciens pensolent ainsi : nous voyons les
Romains, dans le temps même où leur ambition ue gardoit plus de mesure,
craindre de violer la sainteté de Samotlirace, ct recourir à l’adresse
ct à la corruption pour sc saisir du roi dc Macédoine invoquant des
dieux protecteurs ( i) . Vaiircmeiit le commandant des vaisseaux qui pour
suivoieirt Persce avoit tenté par les mei.aecs ct les promesses de se faire
livrer ce prince ; la victoire elle-même n’osoit franchir l’cuceiiitc sacrée •
et la force se vit ohiigco d’employer ces mêmes moyens dc religion qu’on’
lui opposoit. On dénonce au peuple dc l’ile ct à scs chefs que le lieu
saint vient d’être souillé; que Persée a près de lui le ministre de scs
cruautés, cet Evandre qui osa dans le tcnqilc dc Delphes attenter aux
jours d’Eumèuos. Ce que n’avoit pu faire la crainte des armes romaiiics
s’opère par l’iiidignatioii qu’excilc fidée d'uu tel sacrilège : le ma»islrat
suprême de l’ilc, tout à la foi» chef du gouveriie.iiciit ct de la relimo,',
declare ,à Persée qu’Evai.drc, accusé d’être le meurtrier du roi de' Pe.?
game, p r o fá n e le tem p le p a r sa p résen ce ; q u ’ il d o it, su iv an t l'u.sage au h'quc
explique le inotKou; par iroiDrât, qui ne sigiiiiie pas iei
le pocle, mais l'organistileur, le principal acteur des
mystères, c’c.skMiire l’hiéropbante, le grand pontife.
Kocspourroit cire, d'après cette explication, un mol
de la langue des Auioclillioncs.
Si i on préféroil une étymologie grecque , il .scroit
plus .simple dc faire dériver le mol koès , dc celui de
Zûû, qui siguilie toutes sortes dc libation,». On ver-
suil de fluiilo Cl (ln ntic! délayé dans de lean sur la
tète (les victimes ; usage qui avoil pour objet de lcsi>u-
dWt de toutes.»,,,ullurcs.cl dc le.» ,’eudre ainsi dignes
cire oiTertes aux dieux. !1 est vraisemblable qu<t le
Tome y/.
pontife de -Samolliraee, après avoir rer-u l'aveu el les
regrc’lsdu coupable , pratiquoit à son égard la méme
cérémoitie.
Au reste, c'esl-là une de ce.» questions qu’on peut
ctre cuneux dc connoÎDe. mais qu’on se cou.,oie
facicmcntde nc pas voirréxsoudre. Nous savons donc
seulement que la coufc.ssion étoil établie dans ic.» mystères
des dieux Cabires , et que le prêtre chargé de'ce
mm,siere s’appcloit Koès, sans connoître avec cerli-
tilde fétyniologie de celle dénomination.
(>) Tit I.iv, Lib. XLV, cap. 5 et 6. Plularcl. Vit
Paul. Æ.ull.
3 l