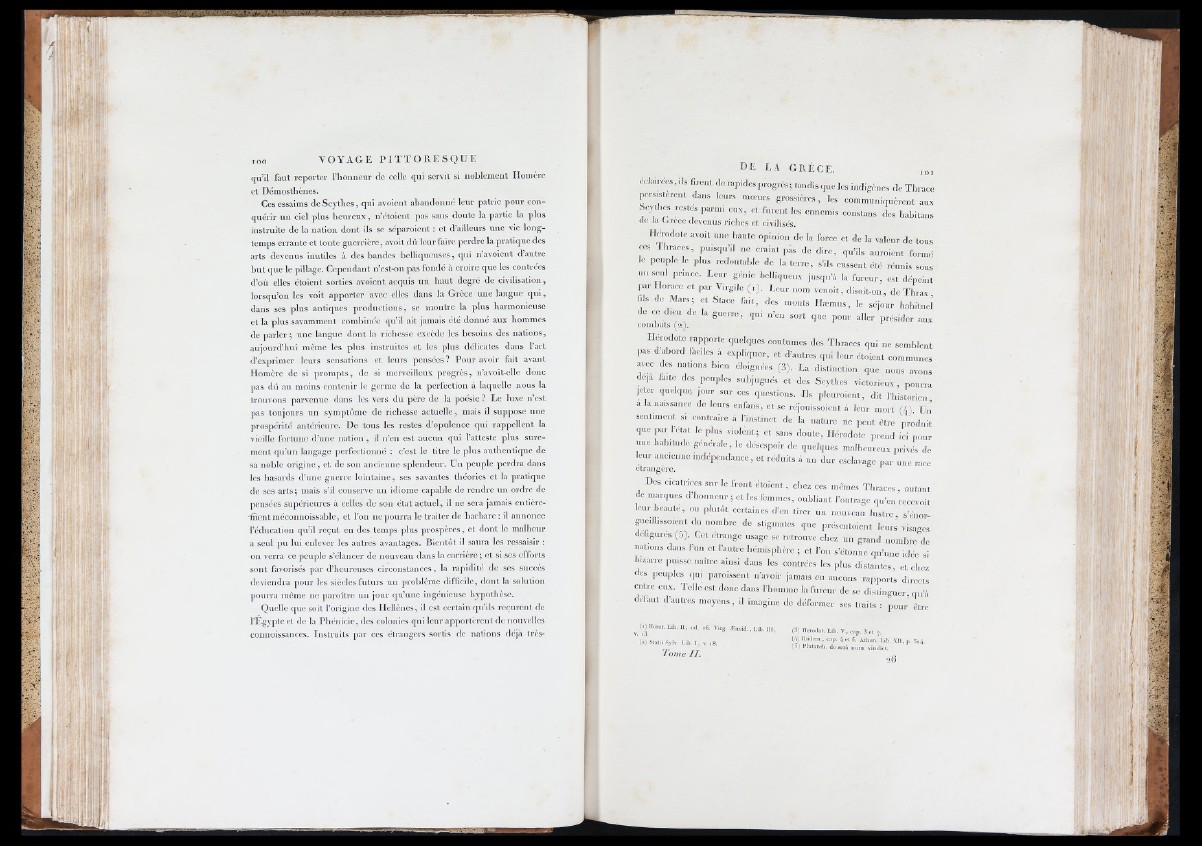
/
qu’il faut reporter rhonneur dc celle qui servit si noblement Homère
ct Dèmostbèncs.
Ces essaims dc S cylbcs, qui avoieul abandonne leur patrie pour conquerir
uu ciel plus licurcux, n’éloienl pas sans doute la partie la plus
instruite dc la nation dont ils sc séparoicnt : et d’ailleurs une vie longtemps
errante ct toute guerrière, avoit du leur faire perdre la pratique dos
arls devenus inutiles à desbandes belliqueuses, <{ui navoient d’aulrc
but que le pillage. Cependant n’esl-on pas fondé à croire que les contrées
d’où elles étoient sorties avoient acquis uu haut degré dc civilisation,
lorsqu’on les voit apporter avec elles dans la Grèce une langue qui,
dans scs plus antiques productions, sc montre la plus harmonieuse
ct la plus savamment combinée qu’il ait jamais été donné aux hommes
de parler ; uuc langue dont la richesse excède les besoins des nations,
aujourd’hui même les plus instruites et les plus délicates dans l’art
d’exprimer leurs sensations ct leurs pensées? Pour avoir fait avant
Homère dc si prompts, dc si merveilleux progrès, n’avoit-clle doue
pas dù au moins contenir le germe dc la pcrfcclion à laquelle nous la
trouvons parvenue dans les vers du père dc la poésie? Le luxe n’est
{»as Loujours un symptôme de richesse acluollc, mais il suppose uuc
{-»rospérité antérieure. Dc lous les restes d’o{-»ulcucc qui rappellent la
vieille forlunc d’une nation , il n’cn est aucun qui l’altcstc plus sûrement
qii’uii langage pcrlcctionné : c’est le litre le plus authcnlic{uc de
sa noble origine, et dc son ancienne splendeur. Un pciqvlc {"»erdra dans
les hasards d’iinc guerre lointaine, scs savantes lliéorics cl la {-»ralique
de ses arts; mais s’il conserve un idiome ca{'»ablc dc rendre un ordre de
pensées supérieures à celles dc son étal actuel, il ne sera jamais cnticrc-
'fûcntmécoiinoissablc, ct l’on ne pourra le traiter dc barbare : il amioiicc
l’éducation qu’il reçut cn des temps plus prospères, et donl le mallieur
a seul pu lui enlever les autres avantages. Bientôt il .saura les rcs.saisir :
on verra cc peuple s’<3anccr dc nouveau dans la carrière; el si scs efforts
sont favorisés par d’hcureuscs circonstances, la rapidité dc scs succès
deviendra pour les siècles futurs un problème difficile, dont la solution
pourra même ne {•»aroîlrc nn jour qu’une ingéaiieiisc hypothèse.
Quelle ([UO soil l’origine des Hellènes, il est cerlain (pfils reçuvcnl de
l’Egyplcet (le la Phénicie, des colonies qui leur apporlèrcnl de n(»uvellos
connoissanccs. Instruits {»ar ces étrangers sorlis dc nations d(qà Irc-sccl.,
uxcs, il., de rapide., progrès; (andi, <,ue les „,d,gènes de TIrracc
pers.slerenl, dans leurs meenrs grossières, les comnrnni.juèrcnt aux
Seyll.es resles parm, eux, et Idrenl les ennemis constans des Irabitans
de la (ji-ece devcnns riches cl civiii.sés.
Hérodote avoit une liante opinion de la force et dc la valeur dc tous
CCS Ihraecs, puisqu’il no craint pas dc dire, qu’ils .auroient formé
le peuple le plus redoulalile dc la terre, s’ils eussent été réunis sous
un .seul prinec. Leur génie belliqueux jusqn’i, la fureur, est d.naciut
par Horace ct par Virgile ( ,) . Leur nom venoil, diso.t-on, do Thrax
fils de Mans ; et .Staee li.it, des mon,s Hmmus, le séjour liabi.tiol
de ce dire de la guerre, qu. n’en sort que pour aller présider aux
coniJ)als (2).
Hérodote rapporte quelques coutumes des Tl.races qui no semblent
pas d abord laeiles à expliquer, cl d’autres qui leur élotcnt communes
avec des nalions bien éloignées (,5). La distinction que nous avons
de,a iaile des peuples snlijugnés et dos Scylbcs victorieux, pourra
jeter quelque jour sur ces questions. Ils pleuroie.it, dit l’Iiistorieu
a la naissance dc leurs cnfans, el so réjonissoicnl à leur mort fj) . üii
sentiment si contraire à i’instinet de la na.nro ne peut être produit
que par leta, le plus violent; el sans doute, ll,™dotc prend ici jiour
une habitude générale, le désesjioir de qmdqucs mallienrenx privés de
leur ancienne nidependauce, el réduits à uu dur esclavage jiar une race
étrangère.
Des cicatrices sur le front étoient, cl.cz ces mêmes Tbraces, autant
de marques d’honneur ; e, les femmes, oubliant l’on,rage qu’en rcecvoil
lour beauté, ou plutôt ccrlaines d’en tirer tm nouveau lustre s’énor
g,,e,Ilisso.ret dn nombre dc sligmales que p.-ésretoicm leurs visages
défigurés (o). Cet é,range usage se retrouve chez un grand nombrc'de
lia,mus dans fim ct fantrc hémisphère ; el l’on s’étonne qn’nnc idée si
bizarre ,misse nailrc aimsi dans les contrées les plus d.slaiilcs, etcl.cz
Jcs peu,,les qui paroissent n'avoir jamais c.i aiiotms rajiporl’s directs
crilrc eux. Telle est donc dans flionimc la fureur dc sc distinguer, qti’à
delatit d’autres moyens, il imagine dc déformer scs traits : pour être
^ (!) liera,. Llb. II, ,„1. ,6. Virg. , m , . (3, ^ _
'w'.s..iü s-iv, I.a,. I, V ,a <■? “'i'- < xii.,,. 5,4.
WuUrch. de sert num. viinlicl.
Tü?nc I I . 2Gr