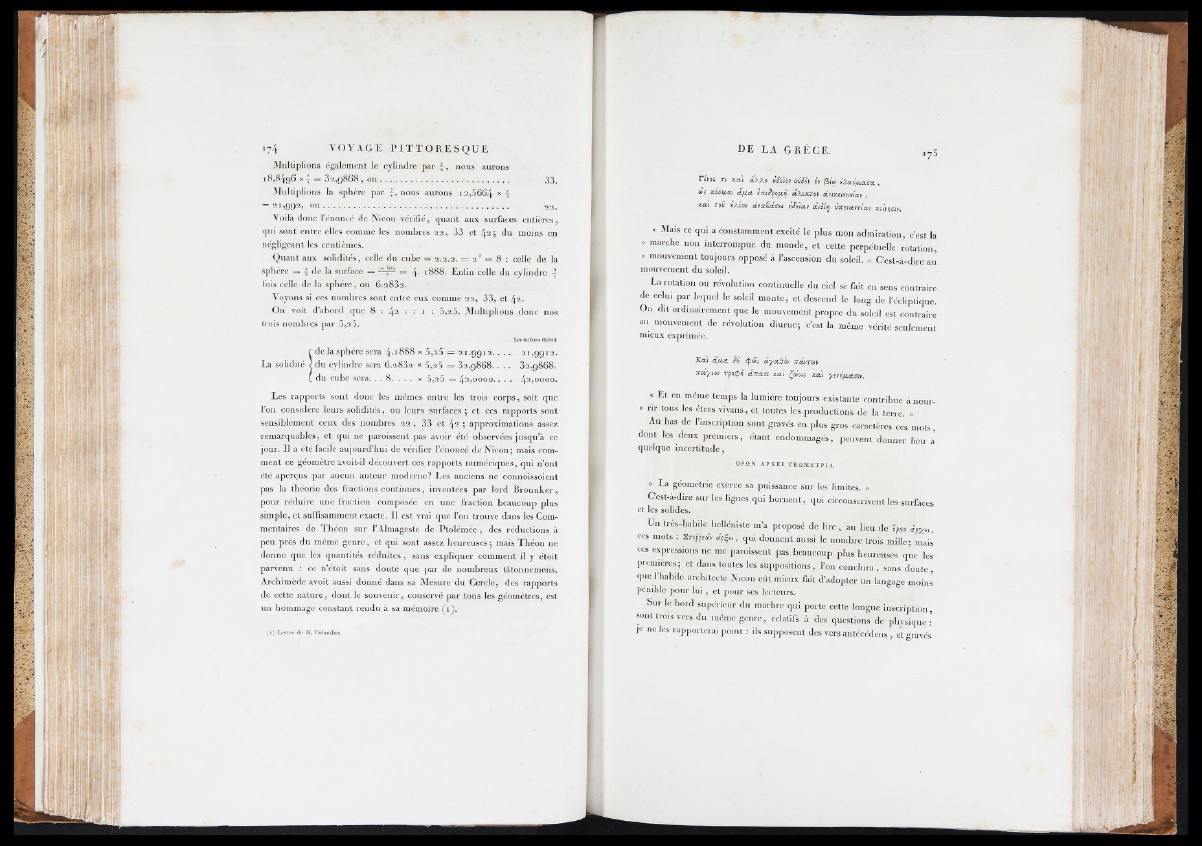
m :
t.4 7 '
Multiplions cgalcmcnt le cylindre par # nous aurons
18,8496 X ^ = 39,9868 , o u ........................................................ 33.
Multiplions la sphère par 7, nous aurons 12,5664 4
-2 1 ,9 9 2 , o u ................................................................................. 32.
Voilà donc l’cnoïK'C dc Nicon vérifié, quant aux surfaces entières,
qui sont ciiirc elles comme les nombres 22, 33 el 42; du moins en
negligeant les centièmes.
Quant aux solidités, celle du cube = 2.2.2. = 2^ — 8 : celle de la
sphère = 4 de la surface = 1888. Enfin celle du cylindre
Ibis celle de la splière, ou 6.2832.
3 oyons si ces nombres sont entre eux comme 22, 33 , et 42.
On voit d’alîord que 8 : 42 : : 1 : 5,25 . Multiplions donc nos
trois nombres par 5,25 .
Les surfaces ctoicot
r de la sphère sera 4 - i8b8 x 5,25 = 21.9912. . . . 21,9912.
La solidité j du cylindre sera 6.2882 x 5^35 = 82,9868. . . . 32,9868.
( du cube sera.. . 8. . . . x 5,25 = 42,0000.. . . 4'-^5*^ooo-
Les rapports sont donc les mêmes entre les trois corps, soit que
l’on considère leurs solidités, ou leurs surfaces ; ct ces rapports sont
sensiblement ceux des nombres 22 , 33 et 42 ; approximations assez
remarquables, et qui ne paroissent pas avoir été observées jusqu’à ce
jour. Il a été facile aujourd’hui dc vérifier l’énoncé de Nicon; mais comment
ce géomètre avoit-il découvert ces rapports numériques, qui n’ont
été aperçus par aucun auteur moderne? Les anciens ne connoissoient
pas la théorie des fractions continues, inventées par lord Brounker,
pour réduire une fraction composée en une ifaclion beaucoup plus
simple, et suffisamment exacte. Il est vrai que l’on trouve dans les Commentaires
de Tbéon sur l’Almagestc de Ptolémée, des réductions à
peu près du même genre, ct qui sont assez heureuses ; mais Tbéon ne
donne que les quantités réduites, sans expliquer comment il y étoit
parvenu : ce n’éloit sans doute que par dc nombreux tâtonncmens.
Archimède avoit aussi donné dans sa Mesure du Cercle, des rapports
dc cette nature, donl le souvenir, conservé par tous les géomètres, csl
un hommage constant rendu à sa mémoire ( i) .
( 0 Lctifu «le M. Delambie.
rsvoç Tt Kai à'AAo ilehv wSiv iv (élu iâavficKra. ,
ùç *oV«ou ¿«.et ¿xijpo.u.» O.MXTM àiiximcrlcu ,
K!Ù nû ,'aλu dvitSaa, liAîcti àïîU CnvcUTÎtti ¡tclnav.
« Mais ce qui a constamment excite le plus mon admiration, c’est la
» marche non interrompue du monde, et cette perpétuelle rotation,
.1 motiYcmcnt toujours opposé à l’ascension du soleil. » C’esl-à-dirc au
mouvement du soleil.
La rotation ou révolution continuelle du ciel sc fait en sens contraire
dc celui par lequel le soleil monte, et descend le long de l’écliiilique.
Ou dit ordinairement que le mouvement propre du soleil est contraire
au mouvement de révolution dmruc; c’est la même vérité seulement
mieux exprimée.
Ka'i x,u.x /))' àjuç àyxâ-ov TTCtVTùlV
TTaytov Tpocpri xTrctiji xa< xct'i ygi-w^ctcïv.
« Et en même temps la lumière toujours existante contribue à nour-
•> rir tous les êtres vivans, cl toutes les productions de la terre.
Au bas dc l’inscription sont gravés en plus gros caractères ces mots,
dont les deux premiers, étant endommagés, peuvent donner lieu à
quelque incertitude,
OPQN A PX E I r E iIM E T P lA .
» La géométrie exerce sa puissance sur les limites. »
C’est-à-dirc sur les lignes qui bornent, qui circonscrivent les surfaces
et les solides.
Un très-habile helléniste m’a proposé de lire, au lieu de i'pm à'fxv,
ces mots : Snfps®-, ¿'pgs,, q,,i donnent aussi le nombre trois mille; mais
ces expressions ne me paroissent pas beaucoup plus heureuses que les
premières; ot dans toutes les suppositions, l’on conclura, sans doute,
que l’habile archilectc Nicon eût mieux fait d’adoplcr un langage moin!
pénible pour lu i, ct pour scs lecteurs.
Sur le bord supérieur du marbre qui porte cette longue inscription,
sont trois vers du même genre, relatifs à des questions do physique
je ne les rapporterai point : ils supposent des vers anlécédens , cl gravés