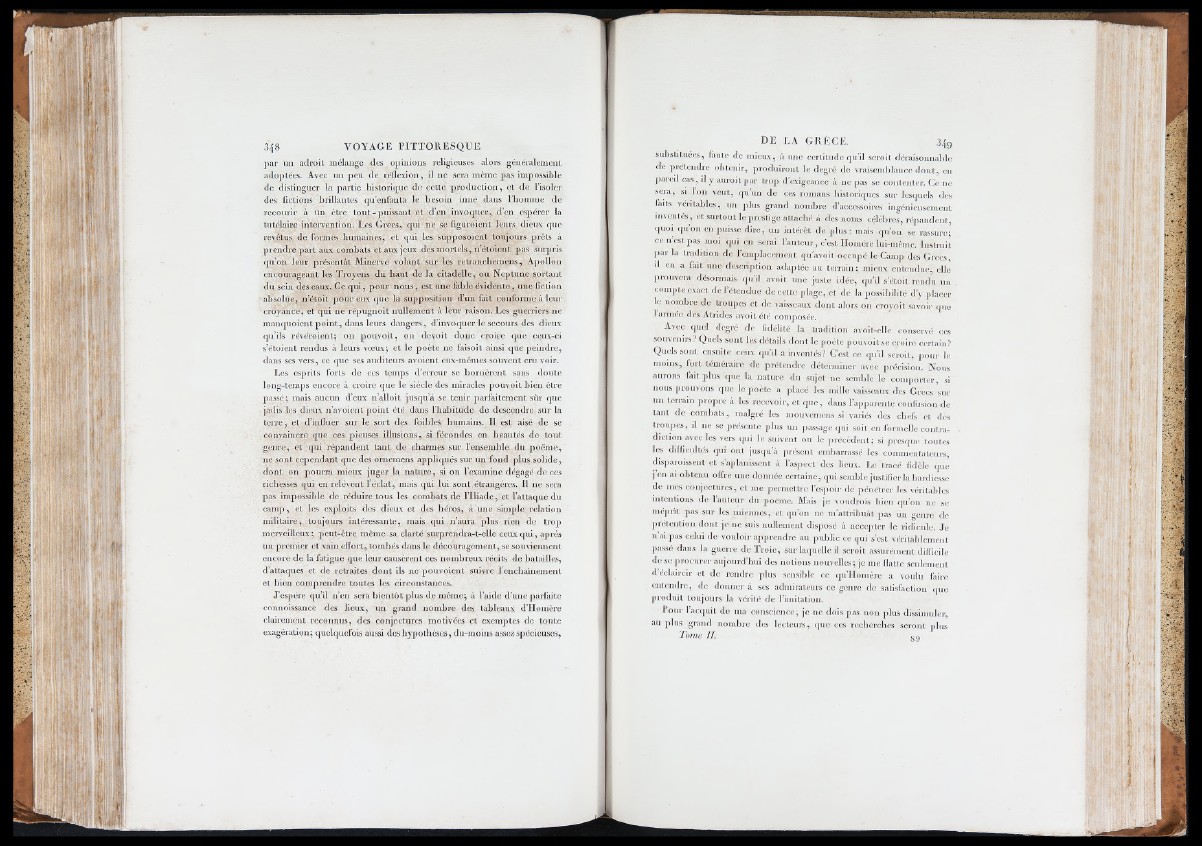
i
%
'i i
•'ï..'«
5 #
te#
LÛ
-V:'
rÂ\>
i
•'V?i
par un adroit mélange des opinions religieuses alors généralement
adoptées. Avec un peu dc réflexion, il nc sera même pas impossible
de dislinguer la parlic liistoricpie dc cette production, et de l’isoler
des üelions brillantes qu’enfanta le besoin inné dans l'homme de
recourir à un cire tout-puissant el d’en invoquer, d’en espérer la
tutélaire intervention. Les Grecs, qui nc sc figuroicnt leurs dieux que
revêtus de formes humaines, et qui les supposoicnt toujours prêts à
prendre part aux combats et aux jeux des mortels, n’étoicnt pas surpris
qu'on leur présentât Minerve volant sur les rclranclicmens, Apollon
encourageant les Troyens du haut de la citadelle, ou Neptune sortant
du sein des eaux. Cc qui, pour nous, est une fable évidente, une fiction
absolue, n’étoit pour eux que la supposition d’un fait conforme â leur
croyance, et qui ne répugnoit nullement â leur raison. Les guerriers ne
manquoient point, dans leurs dangers, d'invoquer le secours des dieux
qu’ils révéroient; on pouvoit, ou devoit donc croire que ceux-ci
s’étoient rendus â leurs voeux; ct le poète ne faisoit ainsi (¡uc peindre,
dans scs vers, cc (¡ue ses auditeurs avoient eiix-mèmcs souvent cru voir.
Les esprits forts de ces temps d’cMTcur sc bornèrent sans doute
long-temps encore â croire (¡ue le siècle des miracles pouvoit bien être
passé; mais aucun d’eux n’alloit jus(¡u’â se tenir parfaitement sûr que
jadis les dieux n’avoiciiL point été dans l'habitude de descendre sur la
terre, et d’influer sur le sort des foibleS humains. Il est aisé de se
convaincre (jue ces pieuses illusions, si fécondes cn beautés de tout
genre, ct qui répandent tant de charmes sur l'ensemble du poéme,
ne sont cependant (¡ue des ornemens appliqués sur un fond plus solide,
dont on ¡»ourra mieux juger la nalure, si on l’examine dégagé dc ces
richesses c¡u^ en relèvent l’éclat, mais qui lui sont étrangères. Il ne sera
pas impossible dc réduire tous les combats de l’Iliade, et l’altaquc du
cainj), ct les exploits des dieux et des béros, à une simple relation
militaire, toujours intéressante, mais qui n’aura plus rien de trop
merveilleux; peut-être môme sa clarté surprendra-L-elle ceux cjui, ajirès
un premier et vain effort, tombés dans le découragement, se souviennent
encore de la fatigue (¡ue leur causèrent ces nombreux récits de batailles,
d’attaques et de retraites dont ils nc pouvoicnt suivre l’eiicliainemenl.
et bion comprendre toutes les circonstances.
J'espère qu’il ii’cn sera bientôt plus de même; â l’aide d’iiiic parfaite
connoissance des lieux, un grand nombre des tableaux d’Uomère
clairemeul reconnus, des conjectures motivées ct exemptes de toute
exagération; (¡uelqiicfois aussi des hypothèses, du-moijis assez spécieuses,
substituées, faute dc mieux, â une certitude qu'il seroit déraisonnable
de ¡»réUaidre obtenir, ¡»roduiront le degré de vraiseinljlanco dont, l'ii
¡»areil cas, il y auroil ¡¡ar troj) d’cxigeance â nc ¡¡as se contcnlcr. Ge ne
sera, si Ion veut, (¡u’un de ces romans liisLoriques sur lesqiu'I.s des
laits véritalilcs, un plus grand nomlu-e d’accessoires ingénieusement
unentés, et surtout le prestige attaché â des noms célèbres, réjiaiident,
(|uoi ([(l’on en puisse dire, uu inüirét de ¡¡lus: mais qu’on se rassure;
cen ’estpas moi qui en serai l’auteur, c’est Homère lui-mèane. Instruit
j>ar la tradition de l’enq)laccment qu’avoîL occupé lo Canqj des Grecs,
il en a fait une description adaptée au Lerrain; mieux entendue, clic
prouvera désormais qu'il avoit uue juste idée, qu’il s’étoit rendu un
compte exact dc l’étendue dc ccLLc plage, et de la possibilité d’y ¡»lacer
le nombre de troupes et de vaisseaux dont alors on eroyoit savoir que
rarméc des Atrides avoil, élé eomjiosée-
Avec quel degré de iidélité la tradition avoil-elle couscrvi; ces
souvenirs? Quels sont les délails dont le poète pouvoit sc croire cerlain?
Quels sont ensuite renx qu'il a inventés? C’est ce qu'il seroil, pour le
moins, fort téméraire dc prétendre déterminer avec précision. Nous
aurons fait plus (¡uc la nature du sujet ne semble le eomporiev, si
nous prouvons que le poète a ¡»lacé les mille vaisseaux dos Grecs’sur
un Lerram ¡»ropre â les recevoir, ct que, dans l’apjiarente conl'usion de
tant dc coml»aLs, malgré les mouvemens si variés des cbcis et des
irou]»cs, il ne se ¡»rescnte ¡»lus un ¡»assagc qui soit en formelle conlra-
dicLion avec les vers qui le suivent ou le ¡»récixlent; si presque toutes
les diiïiciiltés (¡111 ont jusqu’à présent emljarrassé Jcs commeulateurs,
(lisparoissent et s’a[»lanisscnt â ras[.eet des lieux. Le tracé lidèlc (¡ue
j cn ai obtenu oifre une donnée certaine, qui semble jiisiilicr la hardiesse
dc mes conjectures, cl me ¡»ermcllrc l’csjioir de pénétrer lus véritables
imenlions de l'auteur du poëme. Mais ¡e voudrois bii'n qu'oa ne se
méprit pas sur les miennes, et qu'on 11c m’attribuât ¡»as un genre de
¡»réleiilion dont je ne suis nullement disposé â accepter le ridicule. Je
n’ai ¡»as celui de vouloir apprendre au pul»lic cc qui s’cst vérilal»lcmcnt
¡tassé dans la guerre dc Troie, sur laquelle il seroit assurcmcnt diffieile
de sc procurer aujourd'hui des nolions nouvelles; je me flatte sculemeui
d éclaircir cl de rendre ¡dus sensible cc qu'Homère a voidu faire
cutendre, de donucr â s('s admiraleurs cc genre de satisfaclioii (¡ue
produit toujours la vérité de l’imitation.
Tour l’acquit dc ma conscience, je nc dois pas non ¡»lus dissimuler,
au plus grand nmni»re dcîs lecteurs, ijue ces recherches seront ¡»lus
'J.oine 11. 89
iht>
£'/• ; '
f ri
t
/■ ■