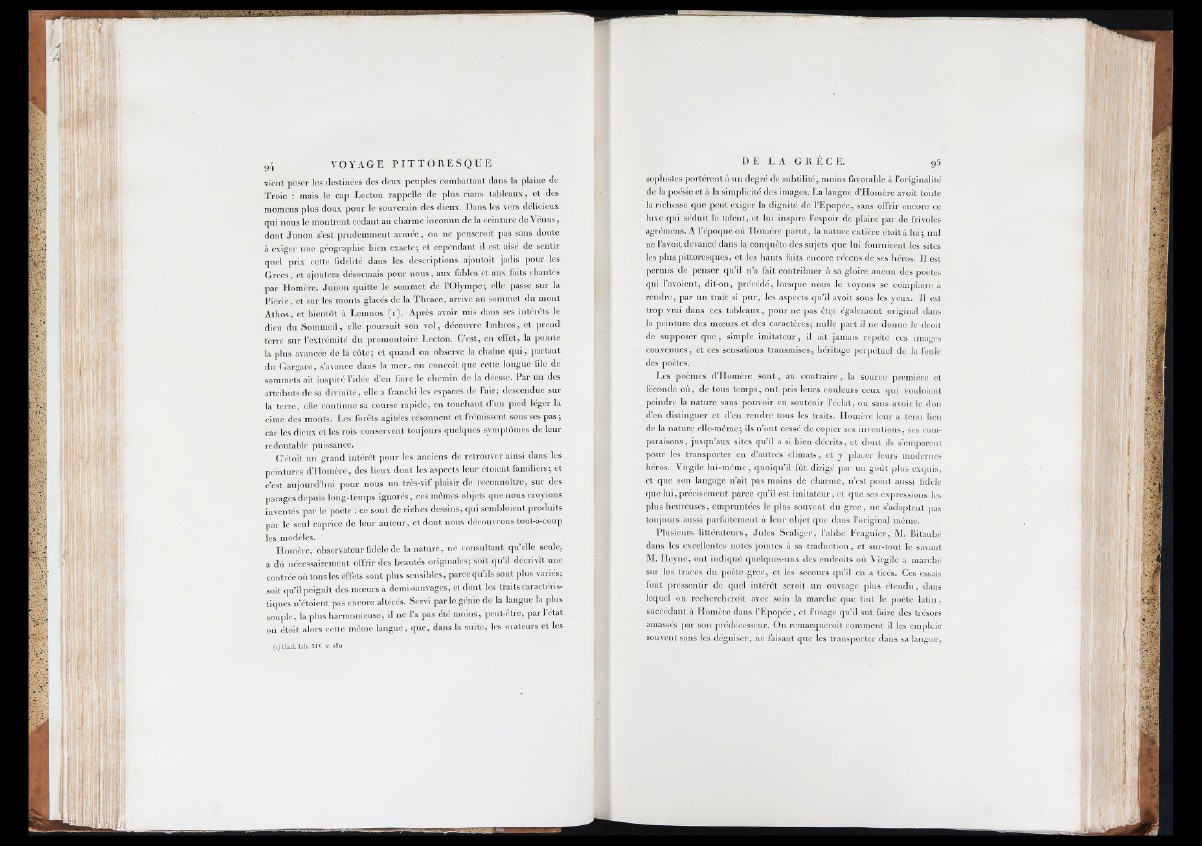
f
vient peser les destinées dos deux peuples combattant dans la plaine dc
Troie : mais le cap Lecton rappelle dc plus rians tableaux, et des
momcns pins doux pour le souverain dos dieux. Dans les vers délicieux
qui nous le montrent ct'daut au charme inconnu de la ceinture dc Vénus,
dont Junon s’est prudemment armée, ou ne pcnscroit pas sans doute
à exiger une géograpbic bien exacte; ct cependant il csl aisé dc sentir
quel prix cette fidélité dans les descriptions ajouloit jadis pour les
Grecs, et ajoutera désormais pour nous, aux fables ct aux fails ehanles
par Homère. Junon quitte le sommet dc fOlympc; elle passe sur la
Piiaio, et snr les monts glaces dc la Tlirace, arrive au sommet du mont
Athos, ct bientôt à Lcmnos (i) . Après avoir mis dans ses intérêts le
dieu du Sommeil, elle poursuit son v o l, découvre Tmbros, ct prend
terre sur l’cxlrèmité du promontoire Lecton. C’est, en eflct, la pointe
la pins avaiicco de la côte; et quand on observe la cbainc qui, partant
du Gargare, s’avance dans la mer, on conçoit que cette longue file dc
sommets ail inspiré l’idée d’en faire le chemin de la déesse. Par nn des
attributs dc sa divinité , elle a franchi les espaces do l’air; descendue sulla
terre, elle continue sa course rapide, en touchant d’un pied léger la
cime des monts. Les forêts agitées résonnent et frémissent sous scs pas;
car les dieux et les rois conservent toujours quelques symptômes dc leur
redoiilablc puissance.
C’Goit nn grand intérêt pour les anciens dc rclronver ainsi dans les
peintures d'Homère, des lieux dont les aspects leur étoient familiers; cl
c’csl aujourd'hni pour nous un très-vif plaisir de rcconnoîtrc, sur des
parages depuis long-temps ignorés, ces mêmes objets que nous croyions
inventés par le poète : cc sont dc riches dessins, qni scmbloiciit produits
par le seul caprice de leur aulcnr, ct dont nous dceonvrons tont-a-conp
les modèles.
Homère, observateur fidèle de la nature, ne consultant qu’cllc seule,
a dù nécessairement offrir des beautés originales; soit qn’il décrivit une
contrée où tons les effets sont plus sensibles, parce qu’ils sont pins varies;
soit qn’il peignit des moeurs à demi-sauvages, cl dont les traits caracttuis-
tiqucs n’ctoient pas encore altérés. Servi par le génie dc la langue la pins
souple, lapins harmonieuse, il ne fa pas été moins, peut-être, par l’état
où iùoit alors cette même langue, que, dans la suite, les orateurs ct les
(j) lUad, Lib. XJV. V. 280.
sophisles portèrent à un degré de subiilitc, moins fiivorablc à l’origiiialilé
de la poésie cl ù Ja simplicité dos images. I^a langue d'Uomère avoit toute
la richesse que peut exiger la dignité dc l’Epopcc, sans offrir encore cc
luxe qui séduit le talent, ct lui inspire fcspoir dc plaire par dc frivoles
agrémens. A l’époque où Homère parut, la nature entière étoit à lui; nul
ne favoit devancé clans la conquête clos sujets que lui fournireiiL les sites
les ¡)lus pilloresqucs, el les bauls faits encore récens de scs héros. 11 est
permis de penser qu’il n’a iàil contribuer à sa gloire aucun des poètes
cjui l’avoient, dit-on, précédé, lorscjuc nous le voyons sc complaire à
rendre, par un trait si pur, les aspects qu’il avoit sous les yeux. 11 est
trop vrai daus ces tabk’aux, pour ne pas être également original dans
la peinture des moeurs et des caractères; nulle part il 110 donne le droit
dc supposer que, simple imilalcur, il ait jamais répété ces images
convenues, ct ces sensations transmises, hikilage ¡lerpétucl dc lu ibulc
des poètes.
Les poèmes d’Homcrc sont, au contraire, la source première et
féconde où, dc tous temps, ont ¡»ris leurs couleurs ceux qui votdoieiiL
peindre ia nature sans pouvoir en soutenir l’éclat, ou saus avoir le don
d'en distinguer et d’en rendre tous les traits, llomère leur a tenu lieu
dc la nature ellc-racmc; ils n’ont cessé dc copier ses inventions, ses comparaisons,
jusqu’aux sites qu’il a si bien décrits, ct dont ils s’emparent
pour les transporter en d’aulrcs climats, et y placer leurs modernes
liéros. Virgile lui-même, quoiqu’il fût dirigé par un goùL plus exquis,
et que son langage n’ait pas moins de charme, n’est ¡»oint aussi üdèle
que lui,précisément parce qu’il csl imilatcur, et que scs expressions les
plus licurcuses, empruntées le ¡»lus souvent du grec, ne s’adaptent pas
loujours aussi parfaitement cà leur objet que dans l’original même.
Plusieurs liLlératours, Jules Scaligor, fabbé Fraguier, M. Rilaubé
dans les cxccllcuLes notes jointes à sa traduction, ct sur-tout ic savant
M. Ilcync, ont indiqué quelques-uns des endroits où Virgile a marché
sur les traces du poète grec, cl les secours qu’il eu a tirés. Ces essais
font pressentir de quel intérêt scroit un ouvrage plus étendu, dans
lequel ou rcehcrcheroit avec soin la marche que litil le poète latin,
succédant à Homère daus l'Epopée, et l’usage qu'il sut faire des trésors
amassc's par son ¡»rcàkk'cssour. On reniarqueroil eommeiiL il les enq»loie
souvent sans les dc'guiser, ne faisant que les Iran.sporter dans sa langue,