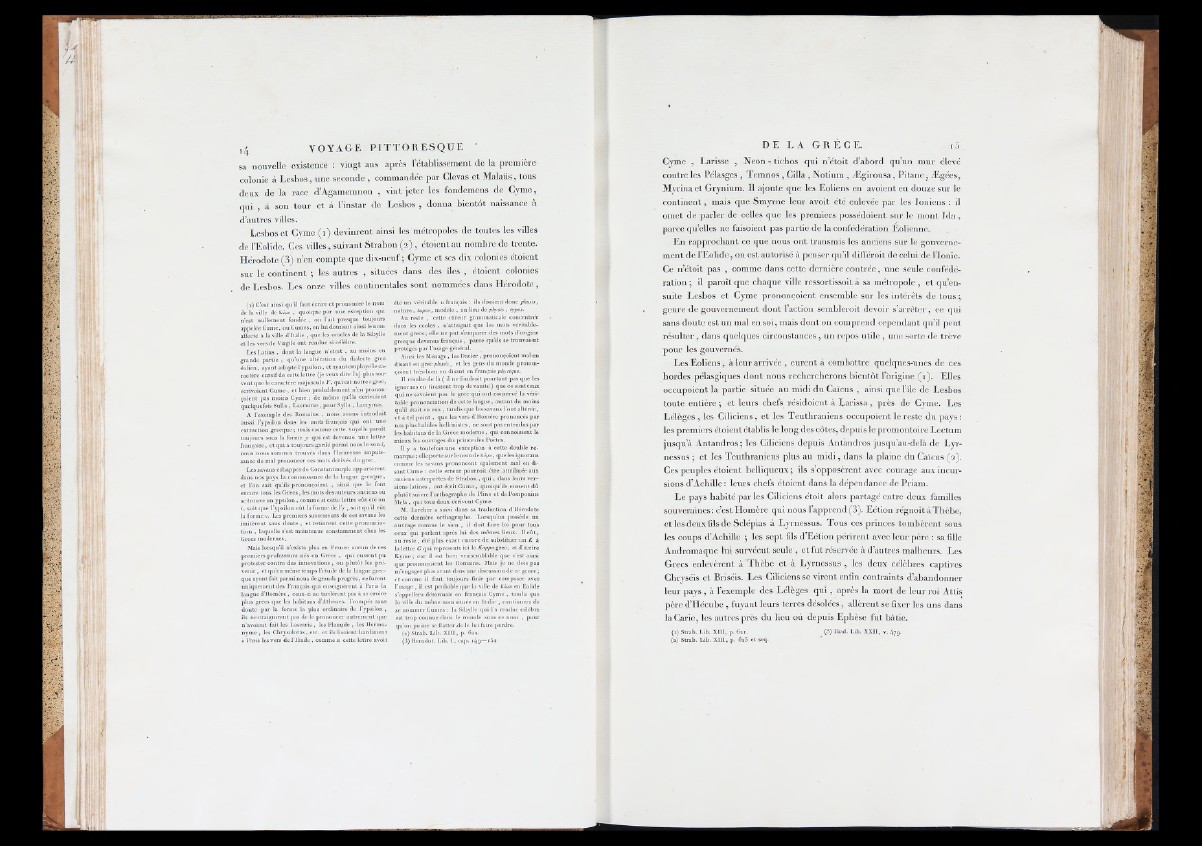
i ;
î
sa nouvelle existence : vingt ans après 1 établissement de la première
colonie i Lcsbos, une seconde , commandée par CIcvas ct Malaiis, Lous
deux do la race d’Agamemnon , vint jeter les fondcmcns dc Cymo,
tjni , à son tour ct à l’instar de Lcsbos , donna bientôt naissance à
d’autres villes.
Lcsbos ct Cvme ( l) devinrent ainsi les métropoles dc toutes les villes
dc l’Eolidc. Ces villes, suivant Strabon (a) , étoient au nombre dc trente.
Hérodote (3) n'en compte que dix-neuf ; Cymc ct scs dix colonies étoient
sur le continent ; les autres , situées dans des îles , étoient colonies
de T.esbos. T.es onze villes continentales sont nommées daus Hérodote,
(1) C’est ainsi qu'il faut écrire et prononcer le nom
de la ville de KuVii , quoique par mie exception qui
11‘osl nullement fondée , on l'ait presque toujours
appelée Cume, ou Cunies. en lui donnant ainsi le nom
affecté à la ville d'Italie , que les oracles de la Sibylle
et les vers dc Virgile ont rendue si célèbre.
Les Latins , dont la langue neloil , au moins en
grande partie , qn’uue altération dn dialecte grec
eolieii, ayant adopté l'ypsilon , et ayant employé le caractère
cursif de cette lettre (je veux dire 1’«) plus souvent
que le caractère majuscule T. qui est notre i grec,
écrivoienl Cume , et bien probablement n’en pronon-
çoient pas moins Cyme ; de même qu’ils écrivoient
quelquefois Sulla , Lacrumæ, pourSylla , Lacryma;.
A l'exemple de.s Romains . nous avons introduit
aussi l'ypsilon dans les mots français qui ont une
extraction grecque; niais comme cette voyelle paroit
toujours sous la forme y qui est devenue une lettre
française, e tq u ia toujours gardé parmi nous le son i,
nous nous sommes trouvés dans l'heureuse impuissance
de mal prononcer ces mots dérivés du grec.
Les savans échappés de Conslanlinople apportèrent
daus nos pays la connoissance de la langue grecque,
et l’on sait qu’ils pronoiiçoient , ainsi que le fout
encore lous les Grecs, les mots des auteurs anciens où
se trouve uu ypsilon, comme si cette lettre eût été un
i, soit que l'ypsilon eût la forme de l’y , soit qu’il eût
la forme v. Les premiers successeurs de ces savans les
imitèrent sans doute , et retinrent cette prononciation
, laquelle s'est maintenue coiislamment chez les
Grecs modernes.
Mais lorsqu'il n’exista plus en France aucun de ces
premiers professeurs nés en Grèce , qui eussent pu
protester contre des innovations , ou plutôt les prévenir
, et qu’en même temps l’étude de la langue grecque
ayant fait parmi nous de grands progrès, ce furent
uniquement des Français qui enseignèrent à Paris la
langue d'Uomère, ceux-ci ne lardèrent pas à se croire
plus grecs que les habitans d’Athènes. Trompés sans
doute par la forme la plus ordinaire de l'ypsilon ,
ils ne craignirent pas de le prononcer autrement que
n’avoicijl fait les I.ascaris , les Planude , les Herrao-
nyme , les Chrysoloras, elc. el ils lisoient bardiment
à Paris les vers de l’iliade , comme si celle lettre avoit
été un véritable u fr.ançais ; ils disoient donc phuis,
nature, Uipos, modèle , au lieu de physis , trpos.
Au reste , celte erreur gramnialiealc concentrée
dans les écoles , n’atteignit que les mots véritablement
grecs ; elle ne put s'emparer des mots d'origine
grecque devenus français , parce qu’ils se trouA'oient
prolégtès par l'usage général.
Ainsi les Ménage, les O.acier, prononçoient mal en
disant en grec phusis, et les gens du monde pronon-
çoieiit très-bien en disant en français physique.
11 résulte de là ( il ne faudroil pourtant pas que les
ignoraiisen tirassent trop dcvaiiité) que ce sontceux
qui ne savoient pas le grec qui ont conservé la véritable
prononciation dc celte langue, autant du moins
qu’il étoit en eux , tandis que les savans l’ont altérée,
et à tel point , que les vers d’Uomère prononcés par
nos plus habiles hellénistes, ne sont pas entendus par
les habitans de la Grèce moderne , qui comioissent le
mieux les ouvrages du prince des Poètes.
Il y a toutefois une exception à cette double remarque
; elle porte sur le nom de Kénn, que les ignorans
comme les savans prononcent également mal eu disant
Cume ; cette erreur pourroit être attribuée aux
anciens interprètes de Strabon , qui , dans leurs versions
lutines, ont écrit Ctima , quoiqu’ils eussent dû
plutôt suivre l’orthographe de Pline et de Pomponius
Mêla , qui lous deux écrivent Cyme.
M. Larcher a suivi dans sa traduction d'Hérodote
cette dernière orthographe. Lorsqu'on possède un
ouvrage comme le sien , il doit faire loi pour tous
ceux qui parlent après lui des niùmcs lieux. Il eû t ,
au reste , été plus exact encore de substituer un K à
ia lettre C qui représente ici le Kappa grec, cl d’écrire
Kyme ; car il Mt liien vraisemblable que c'est ainsi
que prorionroiciit les Romains. Mais je ne dois pas
m'engager plus avant dan.s une discussion de ce genre;
et comme il faut loujours finir p.ir composer avt
l'usage , il est probable t|ue la ville de Kii,<in e
s’appellera désormais en français Cyme , i:n
la ville du même nom située en Italie , conlii
se nommer Cumes : la .Sibylle qui l'a itikIik
est trop connue dans le imintle sous ce non
qu’on puisse sc liultcr.de le lui faire perdre,
(a) Strab, Lib. X lll, p. Gaa.
(i) Kerodoi. Lib. I, cap. ¡/,tj— i 5 i
, Füiitle
Cyme , Larissc , Neon-tichos qui n’éloit d’abord qu’un mur clcvc
conLre les Pclasges , Tcmnos , Cilla , Notium , Ægirousa , Pitane, Ægccs,
Myrina cL Grynium. Il ajoute que les Eoliens en avoient eu douze sur le
continent, mais que Smyrne leur avoit etc enlevée par les Ioniens : il
omet de parler de celles que les premiers possédoient sur le mont Ida ,
parce quelles ne faisoient pas partie de la confédération Éoliennc.
En rapprochant cc que nous ont transmis les anciens sur le gouvernement
do l’Eolidc, ou est autorisé à penser ([u’il différoiL dc celui dc floiiic.
Ce n’étoit pas , comme dans cette dernière contrée, une seule confédération;
il paroît que chaque ville ressortissoil à sa métropole , et qu’ensuite
J.esbos et (iymc prononçoient ensemble sur les intérêts dc tous;
genre de gouvernement dont faction scmbleroit devoir s’arrêter, ce qui
sans doute est un mal en soi, mais dont on comprend cependant qu'il peut
résulter , dans quelques circonstances, un repos utile , une sorte de trêve
pour les gouvernés.
Les Eoliens, à leur arrivée , eurent à combattre quelques-unes de ces
hordes pélasgiques dont nous rechercherons bientôt l'origine (i). Elles
occupoicnt la partie située au midi du Caïcus , ainsi que file dc Lesbos
toute entière ; cl leurs chefs résidoient à Lai’issa, près de Cyme. Les
Lélèges , les Cilicicns, et les Tcuthraniens occupoicnt le reste du pays :
les premiers étoient établis le long des côtes, depuis le promontoire Lectiim
jusqu’à Anlandros; les Cilicicns depuis Autandros jusqu’au-delà de Lyr-
nessus ; ct les Teulhraniciis plus au midi, dans la plaine du Caïcus (2).
Ces peuples étoient belliqueux; ils s’opposèrent avec courage aux incursions
d'Achille : leurs chefs étoient dans la dépendance de Priam.
Le pays habité par les Cilicicns étoit alors partagé entre deux familles
souveraines: c’csl Homère qui nous l’apprend (3). Eétion régnoit àThèbc,
et les deux fils de Sclépias à Lyrnessus. Tous ces princes tombèrent sous
les coups d’Achille ; les sept fils d’Eétiou périrent avec leur père : sa fille
Andromaque lui survécut seule , et fut réservée à d’autres malheurs. Les
Grecs enlevèrent à Thcbe ct à Lyrnessus , les deux célèbres captives
Chryséis el Briséis. Les Cilicicns sc virent enfin contraints d'abandonner
leur pays, à l’exemple des Lélèges qui , après la mort dc leur roi Attis
père dTlécube , fuvant leurs terres désolées, allèrent sc fixer les uns dans
la Carie, les autres près du lieu où depuis Ephèse fut bâtie.
( i) Strab. Lib. X lll, p. Gai. (3) Uiad. Lib. X X ll, v. 479.
(a) Strab. Lib. X lll, p. 6i 5 et seq.