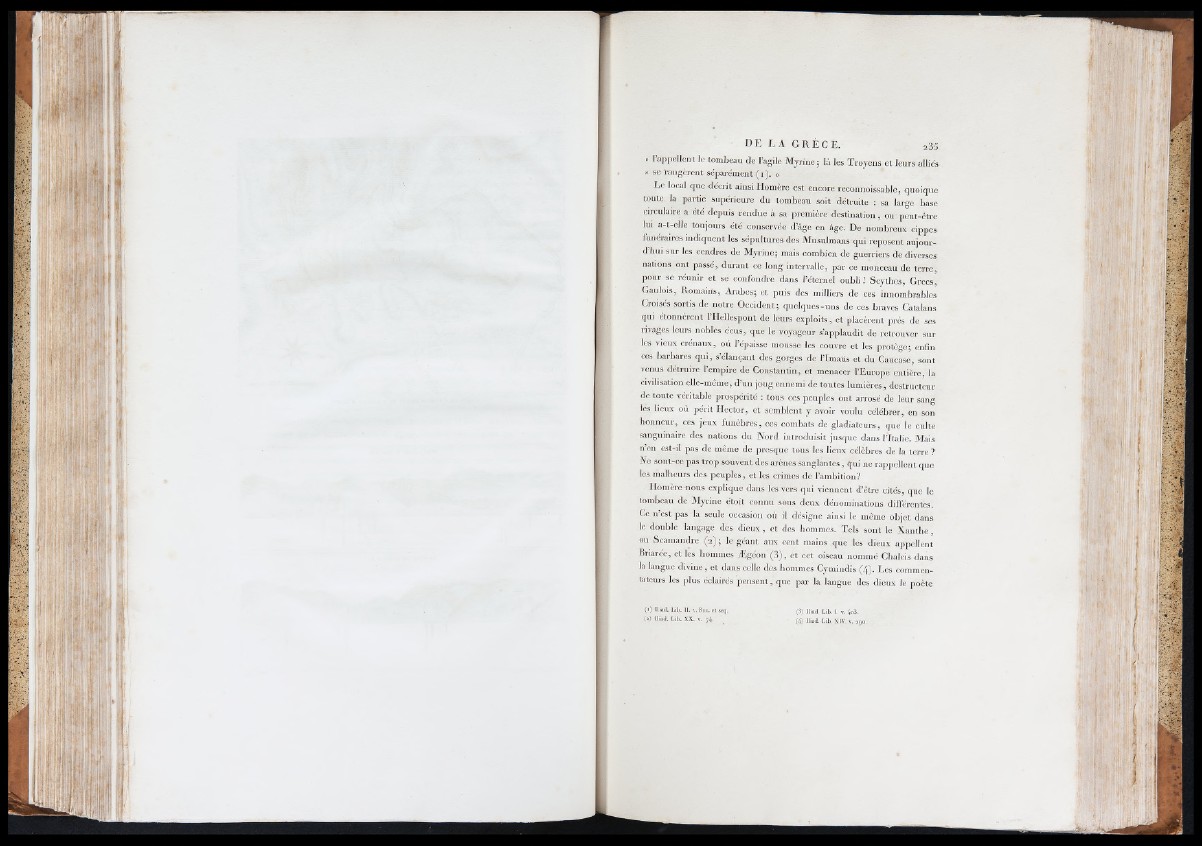
ri.R-
r i é ‘- '
fi l’appcUcat le lombeau de Tagilc Myrine; là les Troyens el leurs alliés
» sc rangcrcnl séparément ( i) . »
L e local que décrit ainsi Homère est encore reconnoissablc, quoique
toute la partie supérieure du tombeau soit détruite : sa large base
circulaire a été depuis rendue à sa première destination, ou peut-être
lui a-l-cllo toujours clé conservée d’âge cn âge. De nombreux cippes
ruuéraircs indiquent les sépultures des Musulmans qui reposent aujour-
d’iuii sur les cendres do Mji-iuc; mais combien dc guerriers de diverses
nations ont passé, durant ce long intervalle, par ce monceau de terre,
pour sc réunir el so conlbndrc dans l’éternel oubli! Scythes, Grecs,
Gaulois, Romains, Arabes; ct puis des milliers dc ces innombrables
Croisés sortis dc notre Occident; quelques-uns de ces braves Catalans
qui ctouucrciit l’IIellospont dc leurs exploits, ct placèrent ju-ès dc ses
rivages leurs nobles écris, que le voyageur s’applaudit de retrouver sur
les vieux créiiaux, oii l’épaisse mousse les couvre et les protège; eiifiu
ces barbares qui, s’élançant des gorges de l’imaus et du Caucase, sont
venus détruire l’empire de Constantin, ct menacer l’Europe entière, la
civilisation elle-même, d’un joug ennemi de toutes lumières, destructeur
dc toute véritable prospérité : tous ces peuples ont arrosé de leur sang
les lieux ou périt Hector, et semblent y avoir voulu célébrer, en son
honneur, ces jeux funèbres, ces combats do gladiateurs, que le culte
sanguinaire des nalions du Nord introduisit jusque dans l’Italie. Alais
n’eu est-il pas dc même dc presque tous les beux célèbres de la terre ?
Ne sonl-ce pas trop souvent des arènes sanglantes, qui ne rappellent quo
les mallicurs des peuples, ct les crimes dc fambitiou?
Homèrc-nous explique daus les vers qui viennent d’être cités, que le
tombeau do Myrinc éloit connu sous deux dénominations différentes.
Cc n est pas la seule occasion où il désigne ainsi le même objet dans
le double langage des dieux, cl des liommes. Tels sont le Xantbe,
ou Scamandre (2); le géant aux cent mains quo les dieux appellent
llriarce, cl les hommes Ægcon (3) , et cet oiseau nomme Clialcis dans
la langue divine, cl daus celle des liommes Cymindis (4). Les commentateurs
les ¡llus éclairés pensent, que par la langue des dieux le poète
( 1) lliac!. J.ib. U. Y, 811. e t SI
(2) lliùil. Lib. XX. y. 74.
(3) lliad Lib. t V. 4o3.
(.i) lliad. Lib. XIV. V. 29
'ri Tiiv.
h.-
I I®
■, f ' :