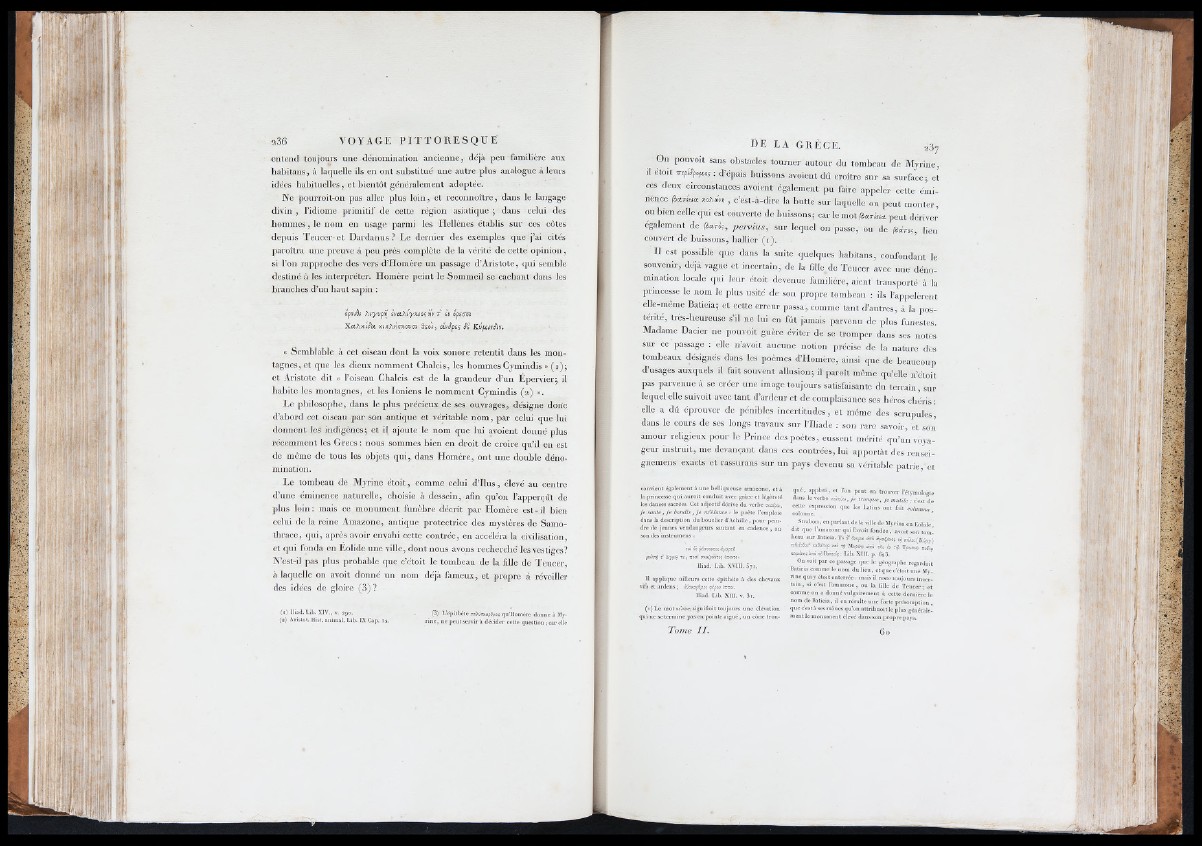
...í*
I.
à u î -
•. ù,
■¡ 4
' ! te;
L. i -
entend toujours une dénomination ancienne, déjà peu iamilièrc aux
habitans, à laquelle ils cn ont substitué une autre plus analogue à leurs
idées Jiabiluclles, cl bientôt généralement adoptée.
Ne pourroit-on pas aller plus loin, cl rcconnoîtrc, dans le langage
divin , l’idiome primitif dc cette région asiatique ; dans celui tics
liommes, le nom cn usage parmi les Ilellcncs établis sur ces côtes
depuis Tcuccr ct Dardanus ? Le dernier des exemjiles que j’ai cités
paroîtra une preuve à peu près complète de la vérité de cette opinion,
si l’on rapproche des vers d’Homère un passage d’Aristotc, qui semble
destiné à les interpréter. Homère peint le Sommeil se cachant dans les
branches d’un haut sapin :
opv'0* è vc t ÎyK io ç iiv T îv op io v i
X x À K tS 'x JCixA»<Txovin â-éoi, àW p g ç I s Kvy.iv<hv.
H Semblable à cet oiseau donl la voix sonore retentit dans les montagnes,
et que les dieux nomment Chaléis, les hommes Cymindis » ( i) ;
cl Aristotc dit « l’oiseau Chaléis est dc la grandeur d’un Éjiervier; il
habite les montagnes, ct les Ioniens le nomment Cymindis (2) ».
Le philosophe, dans le plus précieux dc ses ouvrages, désigne donc
d’abord cet oiseau par son antique et véritable nom, par celui que lui
donnent IcS indigènes; et il ajoute le nom que lui avoient donné plus
récemment les Grecs : nous sommes bien en droit de croire qu’il en est
dc meme de tous les objets qui, dans ilomcrc, ont une double dénomination.
Le tombeau de Myrinc étoit, comme celui d’Ilus, élevé au centre
d’une éminence naturelle, choisie à dessein, afin qu’on l’appcrçût de
plus loin: mais cc monument funèbre décrit par Homère est-il bien
celui dc la reine Amazone, antique protectrice des mystères dc Samo-
ibrace, qui, après avoir envahi cette contrée, cn accéléra la civilisation,
ct qui fonda cn Eolide une ville, dont nous avons rccbcrcbé les vestiges?
N’est-il pas plus probable que c’étoit le tombeau dc la fille de Teucer,
à laquelle on avoit donné un nom déjà fameux, ct propre à réveiller
des idées dc gloire (3) ?
(.) Ilkô.Lib.XIV., V
(a) Arisiot. Hist, aiiiin il, l.ib, IX Cap. I
(3) J.’épillipte ml.ùmapOpo; qu’llomère donne à Myrine,
nc peul servir k décider cette queslioii ; car elle
On pom-oit sans obstacles tourner autour du tombeau de Myrine,
il doit mfUfofiK : d’épais buissons avoient dù croître sur sa surlâco; d
CCS deux circonstances avoient cgalcmcnt pu faire appeler cotte éminence
«A«» , c’est-i-dirc la butte sur laquelle ou peut monter,
on bien celle qui csl couverte dc buissons; car le mol (inriait peut dérive!
également dc fiari;, perv ius , sur lequel on passe, ou de f im , lieu
couvert dc buissons, ballicr ( i) . ’
Il est possible que dans la suilc quelques liabilans, confondant le
souvenir, déjà vague d incertain, dc la fille de Tcuccr avec une denomination
locale ipii leur étoit devcmio familière, aient transporté à la
princesse le nom le plus usité dc son propre tombeau : ils l’appelèrent
elle-même Baticia; ct cette erreur passa, comme tant d’antres, à la postérité,
trcs-hcureuso s’il no lui en fût jamais parvenu de plus funestes.
Madame Dacicr ne pouvoit guère éviter de sc tromper dans scs notes
sur ce passage ; elle u’avoil aucune notion précise dc la nature des
tombeaux désignés dans les poèmes d’Homère, ainsi que de beaucoup
d’usages auxquels il fait souvent allusion; il paroît même qu’elle n’étoit
pas parvenue à se créer une image toujours satisfaisante du terrain, sur
lequel elle suivoit avec tant d’ardeur d dc complaisance scs béros chéris:
clic a dù éprouver dc pénibles incertitudes, d même des scrupules,
dans le cours dc scs longs travaux sur ITliade : son rare savoir, d sou
amour religieux pour le Prince des poètes, eussent mérité qu’un voyageur
instruit, me devançant dans ces contrées, lui apportât des reiisci-
gncmcns exacts d rassurans sur uu pays devenu sa véritable patrie, d
convient également à une belliqueuse amazone, et à
la princesse qui auroit conduit .avec grâce et légèreté
les danses sacrées. Cet adjectif dérive du verbe o/.aipu,
je saute, je bondis, je m’élance: le poète l'emploie
dans la description du bouclier d’.Achille, pour pein-
di'c de jeunes vendangeurs sautant cn cadence , au
Toi ît pr.aaovza içxpzi
ftoXttfl t’ iâyiUÛ Tc, itoiii cxeUpovzsi stovto.
lliad. I.ib, XVIII. 571.
11 applique ailleurs celle épilliète à des chevaux
vifs el ardcns ; iiaxapOpm çscoo iTuroi.
lliad. Lib, xm. V. 3 i.
(t)I.A; mol noltûy)! signifioit toujours une élévation
qui nc so lerinine pas cn pointe aiguè, uu cène troii-
Tomc I L
qué, applati, et l'on peut en trouver lelvmologie
dans le verbe «Xovto, ;> irom/ue, je mutile c’cst de
celle expression que les Utins ont fait columna
colonne. '
Slrabon, en parlant de la ville de àfyrina en Eolide
dit que l'amazone quil’avoit fondée , avoit son tom?
beau sur Batieia. ïè 4* èvepx êati riu,Çôvo; ^ r.i\u (K-im)
ziS’Mx,' xa&irto Kxi rp Mvpiyp M xñ; iv t* Tp«UÙ r iL
Auuivn; áaó zf, BaTieia: Lib, XIII. p, 6a3.
Ou voit par ce p.assage que le géographe regaivloit
Batieia comme le nom du lieu, etquec’étoit une My.
rine qui y éloit enterrée ; mais il reste loujours incertain
, si c'est l'amazone, ou la .fille de Teucer; et
comme on a donné vulgairement à cette dernière le
nom de Batieia, il cn résulte une forte présomption ,
que c'est ses mânes qu’on attribuoit le plus généralement
le monuraent élevé dans son propre pays.
Go
I f : I r
! •’^ 1
i- ♦-
k '