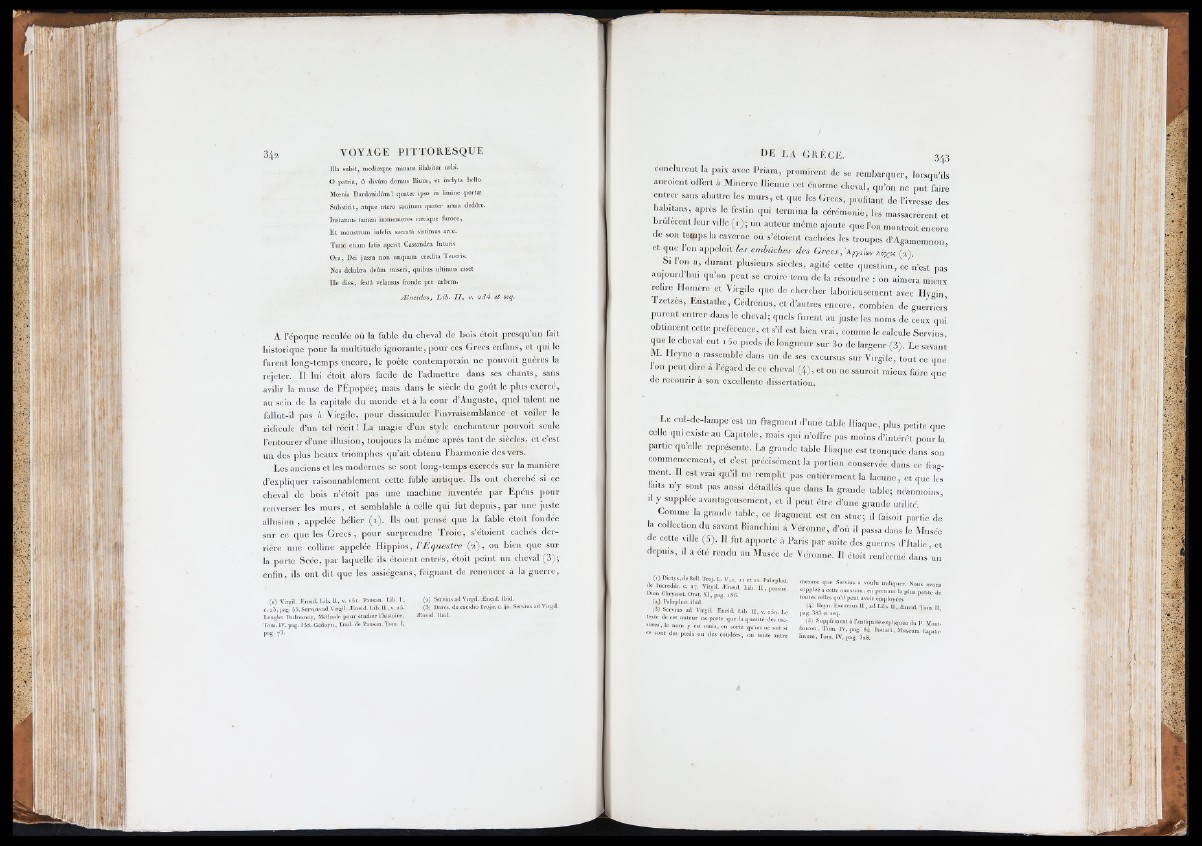
te ill'
M
M’
■#
0.:..
Ilia subit, mediæquc miiiaiis illabitur urbi.
O patria, ô divùm domus Ilium, ct inclyta bello
Moenia Dardaoidûm! quater ipso in limine porta:
Substitit, atque utero sonitura quater arma dedêre.
Instamus tamen immemores ccecique furore,
E t nionstrum infclix sacratà sisiimus arce.
Tunc etiam fatis aperit Cassandra luturis
O ra , Dei jussu non unquam eredita Teticris.
Nos delubra deùm miseri, quibus ultimus esset
llle dies, festi velamus fronde per urbcin.
Æ n e id o s , L ib - I I , v. 2 3 4 et seq.
A l’époque reculée où la fable du cheval dc bois éloit prcsqu’un fait
historique pour la multitude ignorante, pour ces Grecs cnfans, ct qui le
furent long-temps encore, le poète contemporain no pouvoit guères la
rejeter. 11 lui ctoit alors facile de l’admettre dans sos chants, sans
avilir la musc de l’Épopée; mais dans le siècle du goût le plus exercé,
au sciii dc la capitale du monde et à la cour d’Auguste, quel talent no
fallut-il pas .à Virgile, pour dissimuler l’invraisemblance ct voiler le
ridicule d’un tel récit! La magie d’un style cncbantcur pouvoit seule
l’entourer d’nne illusion, toujours la même après tant dc siècles, ct c’est
un des plus beaux triomphes qu’ait obtenu l’harmoiiio des vers.
Les anciens et les modernes sc sont long-temps exercés sur la manière
d’expliquer raisonnablement cette fable antique. Ils ont cherche si co
cheval dc bois n’étoit pas une machine inventée par E[>éus pour
renverser les murs, ct semblable à celle qui fut depuis, par une juste
allusion , appelée bélier ( i) . Us ont pensé que la fable étoit fondée
sur cc qnc les Grecs, pour surprendre Troie, s’étoicnt cachés derrière
une colline appelée Hipplos, l ’E q u e s tr e (2), ou Inen qne sur
la porte Scée, par laquelle ils étoicnt entrés, étoit peint iiii cheval ç3)i
enfin, ils ont dit que les assiégeons, feignant do renoncer <à la guerre.
(,) Virgil Ænei.!. Lib. Il, v. i 5 i. Pausan. Lib l ,
C- »3 , J)ag. 55. Servius ad Virgil. ,Æneid. Lib. II, v. i 5.
Leiiglet Dijfresnuy, Méthode pour étudier l'histoire,
•foui. IV, pag. 338. Gédoyn, Trad. de Pausao. Toiu 1,
pag. 73.
(2) .Servius ad Virgil. Æiieid. Ibid,
(3) Darès, de excidio ïrojic,C- i|0. Servius ad Virgil.
Æiieid. Ibid.
coiidurcit la paix avec Pr,am, jiromirciit dc sc rembarquer, lorsqu’ils
auroiCiit üllcrl a Miiicrvc Uicimo cet énorme cheval, qu’on ne put faire
entrer sans abattre les murs, el que les Grecs, profilant de l’ivresse des
lialiitans, après le festin qm termina la cérémonie, les massacrèrent et
brûleront leur villc ( i ) ; un auteur inêiiic ajoute que l’on montrait encore
dc son temps la caverne où s’étoient cacliécs les troupes d’Agamemnon,
cl que l’on appcloit le s embûches des Gr ec s , 'Afyûai (2).
S i l’on a, durant plusieurs siècles, agité celle question, co n’est pas
aujourd’lini qu’on peut se croire tenu de la résoudre : on aimera mieux
relire ilomcrc et \ irgile que de clierclicr laborieusement avec Hygin,
Tzetzès, Eustathe, Ccdreuus, ct d’autres encore, combien de gnerrici!
purent entrer dans le cheval; quels furent au juste les noms dc ceux qui
obtinrent cette préférence, el s’il est bien vrai, comme le calcule Servius,
que le cheval eut 15 o pieds de loiigiicnr sur 3o dc largeur (3). Le savant
M. Hcyoc a rassemblé dans un dc sos excursus sur Virgile, tout ce que
l’on peut dire à l’égard de cc cheval (4), et on ne saurait mieux faire que
de recourir à son excellente disscrlation.
Lr: cul-de-lampe est n.i fragment d’une table Iliaque, plus petite que
celle qui existe au Cajiitolo, mais qui n’offre pas moins d’iiuérét pour ia
partie qu’elle représente. La grande table Iliaque est tronquée dans son
conmiciiccmcnt, ct c’est précisément la portion conservée dans cc fragment.
Il est vrai qn’il ne remplit pas ciilicremeiil la lacune, et que Es
faits n’y sont pas aussi détaillés que dans la grande table; néanmoins,
d y supplée avaiilagcuseincnt, ct il peut être d’une grande utilité.
Comme la grande table, cc fragment est en stuc; il faisoit iiarllc de
la collection du savant Iliancliiii. à Véroiine, d’où il jiassa dans le Musée
dc cette ville (.0). II Ru apporté à Paris par suite des guerres d’Italie, ct
depuis, il a été rendu au Musée dc Véroiiiie. II étoit renfermé dans un
F
( 0 Dictys, de Bell. Troj. L. V, c, 11 ct 12. Palicphat
de Incrdib. c. virgil. j£„e„l, Lib. II, passi.n!
Dion Cbrysost. Orat. XI,pag. i8G.
(a) Palæpbat. ibid.
(3) .Servius ad Virgil. Æneid. Lib. II, v. i 5o. Le
texte de cet auteur ue porte que l.i quotité des mee
sont des pieds ou des coudées,
qu'o
ïutre
mesure que .Servius a voulu indiquer. Nous avons
suppléé i\ cette omission, eu prenant la plus petite dé
toutes celles qu'il peut avoir employées.
(4) lleyn. Excursus II, ad Lib. Il,Æueid. Tom. H.
pag. 383 ct seq,
(5) Supplément à l'antiquité expliquée du P. Moiit-
faucon , Tom. IV, pag. 84. Dottari, Muséum Capim-
liiium, Tom. IV, pag, 328.