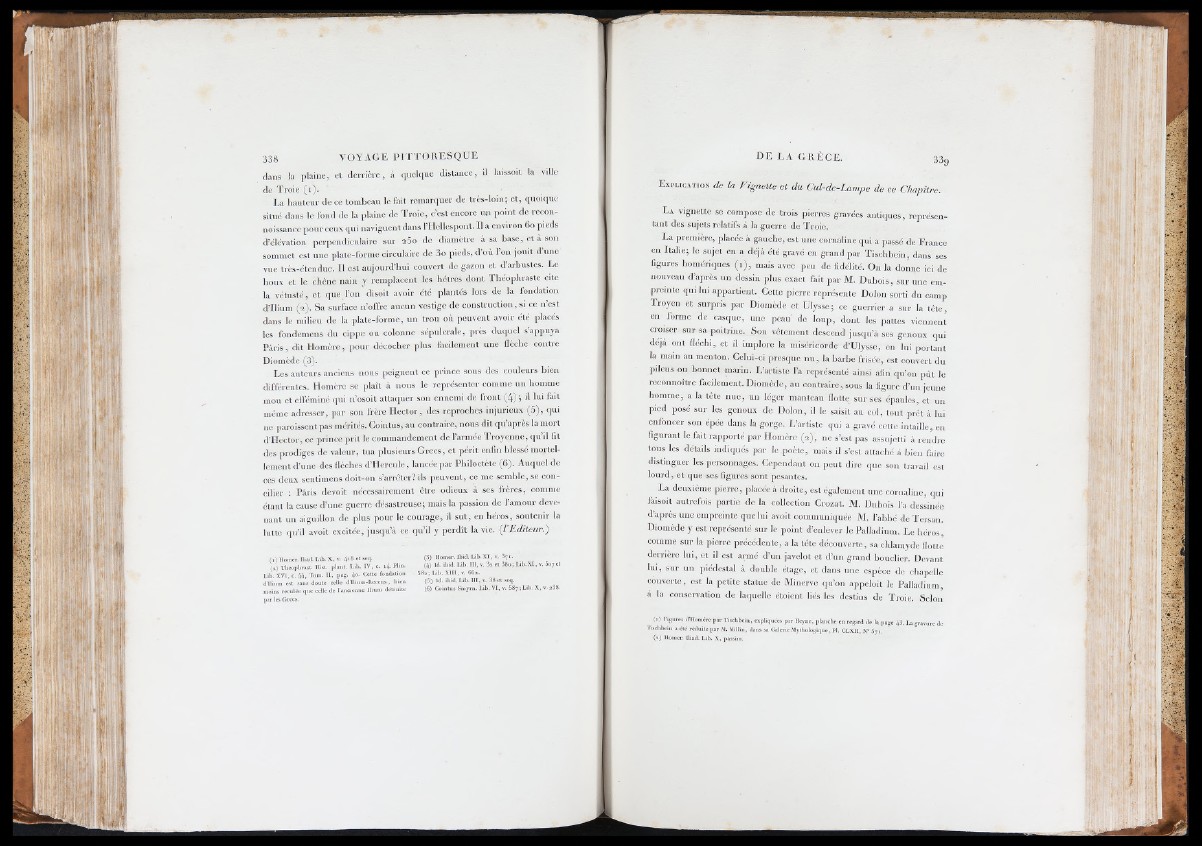
.\'0j
I
dans ia plaine, ct derrière, à iiLicIquc distance, il laissoit la ville
de Troie (i).
T.a liautcur de cc tomlicau le lait rcmaniuer dc très-loin; ct, quoiiiue
situe dans le fond dc la plaine dc Troie, c’est encore rai iioiiil de rccoii-
noissaiicc pour ceux qui iiavignciildaiis l’Hellesponl. l ia cuviroii (io pieds
d’clèvalion pcrpciidieulairc sur 20o dc diamètre à sa base, el a son
sommet est une [ilalc-l'oriiie circulaire dc 3o pieds, d’où 1 on jouit dune
vue très-èlcndnc. 11 est aujourd’hui couvert de gazon cl d’arbustes. Le
houx cl le cliêiie nain y remplacent les hêtres donl Thêoiiliraslc cite
la yêluslé, ct que l’on disoit avoir été plantes lors dc la l'oiidatioii
d’ilium (a). Sa surlkcc n’offre aucun vestige de construclion, si cc u’est
dans le milieu de la jilatc-formc, uu trou où peuvent avoir été placés
les Iondcmcns du cippc ou colonne sépulcrale, près duquel s’ajipiiya
Pâl is , dit Homère, pour dceoeher plus lacileniont une ilèebe contre
Diomèdc (-3).
Les auteurs anciens nous peignent ce princc sous des couleurs bien
différcnlcs. llomère sc jilait à nous le représenter comme un lioumie
mou et efféminé qui n’osoit attaquer son ennemi de front (4) ; il lui fait
même adresser, par sou frère Hector, des rcprocbes injurieux (.5) , qui
ne paroissent pas inèritcs. Cointus, au contraire, nous dit qu’après la mort
d'Hector, cc prince prit le commandement dc l’armée Troyeniie, qu’il lit
des prodiges dc valeur, lua jilusieurs Grecs, ct périt enfin blessé mortellement
d’une dos llcches d'tlereulc , lancée par Philoctète (6). Auquel de
ces deux sciuimeiis doit-on s’arrêter? ils peuvent, ce me semble, sc concilier
; Paris devoit ncccssairement être odieux â scs frères, comme
étant la cause d’une guerre désastreuse; mais la passion dc l’amour devenant
un aiguillon de plus pour le courage, il sut, cn béros, soutenir la
lutte (ju’il avoit excitée, justju’à ce qu’il y perdît la vie. ( l ’Editeur .)
( i) Ilomer. lliiO. Ub. X, v. 4 i 5 et seq.
(a) Tlicoi>lirast. Hist, plant, Lib. IV , c. i.'). Plin.
Lil). XVI, c. 4 4 , Tom- II, pag. 4o- Cette fondation
iITlium est sans Joute celle (l'Iliiim-Recens , bien
moins reculée qne celle de l’ancienne lliuin détruite
(3) Homer. Ibid. Lib.XI, V. 371.
(4} Id. ibid. Lib. 111, V. 3î et 38o; Lib .Xl, v. 607 et
582; Lib. XHI, V. G6a.
(5) ld. ibid. Llb-111, V. 38 ct seq,
(6) Cointus Smyrn. Lib. VI, v. 587 ; Lib. X, v.aSS.
par les Grc
E xp lica t ion de la Vigne tte et du C ul-d e -L am pe de ce Chapitre.
L a v ig n ette so compose do tro is jiicrres gravées a n tiq u e s , r e p ré s c n -
laiil des su je ts relatifs ,à la g u e rr e d c T ro ie .
La première, jilacéc à gauche, est une cornaline qui a passé dc France
eu Italie; lo sujet eu a déjà été gravé en grand par Tisehbein, dans scs
figures liomériqucs ( . ) , mais avec peu dc fidélité. Ou la donne ici dc
nouveau d’après un dessin plus exact fiiil jiar M. Dubois, sur une empreinte
qui lui appartient. Celle pierre rcjiréseiitc Dolon sorti du camp
Troycn ct surpris par Diomède ct Ulysse; cc guerrier a sur la tête,
cn forme de casque, une peau de loup, dont les jiattes viciineiil
croiser sur sa poitrine. Son yêtemciit descend jusqu’à scs genoux qui
deja oui lléclii, et il implore la miséricorde d’Ulysse, cn lui portant
la main au menton. Celui-ci jiresque nu, la barbe frisée, est couvert du
pilous ou bonnet marin. L ’artiste l’a représenté ainsi afin qu’on pùt le
rccoimoîtrc facilement. Diomèdc, au contraire, sous la figure d’im jeune
Iiommc, a la tète nue, un léger manteau flotte sur ses épaules, ct un
pied posé sur les genoux dc Dolon, il lo saisit au col, lom prêt à lui
eiiroiicer son épée dans la gorge. L ’artiste qui a gravé celte iiitaillc, en
figurant ic fait rajqiorté par llomère (2), ne s’cst ji.as assujclli à rendre
tous les détails indiqués par le poète, mais il s’csl attaeiiè à bien làirc
distinguer les personnages. Cependant on peut dire que son travail est
lourd, ct que sos figures sont pesantes.
La deuxième pierre, jiiacèc à droite, csl cgalemciu une cormdinc, qui
faisoit autrefois partie dc la collection Crozal. M. Dubois l’a dcssincc
d’après une empreinte que lui avoil communiquée M. l’abbé dc Tcrsan.
Diomède y est représenté sur le point d’culevcr le Palladium. Le béros,
comme sur la pierre précédente, a la tcte découverte, sa clilamydc Uotlc
derrière lui, et ii est armé d’un javelot et d’un grand bouclier. Devant
lui, sur un |)iédcslal à double étage, ct dans une csjiccc dc eliapcilc
couverte, est la petite statue dc ¡Minerve (ju’oii ajipeloit le Palladium,
à la coiiscrvalioii de I.Kjiicile éloient liés les destins de Troie. Selon
( 0 Ks.ire, .niomiie par TischliBip, c ip li,..r« par Hryae. planche en regar.l de la page /,3. La g e n r e de
Tischbeiii a été mkiitc par AI. Milliii, dans sa Galeno MyUiolugiquc, 1>I. CLXIl, N^Syi.
(a) llomcr. lliad- Lib. .X, passim.
I/
^ ri
J., I
l
)