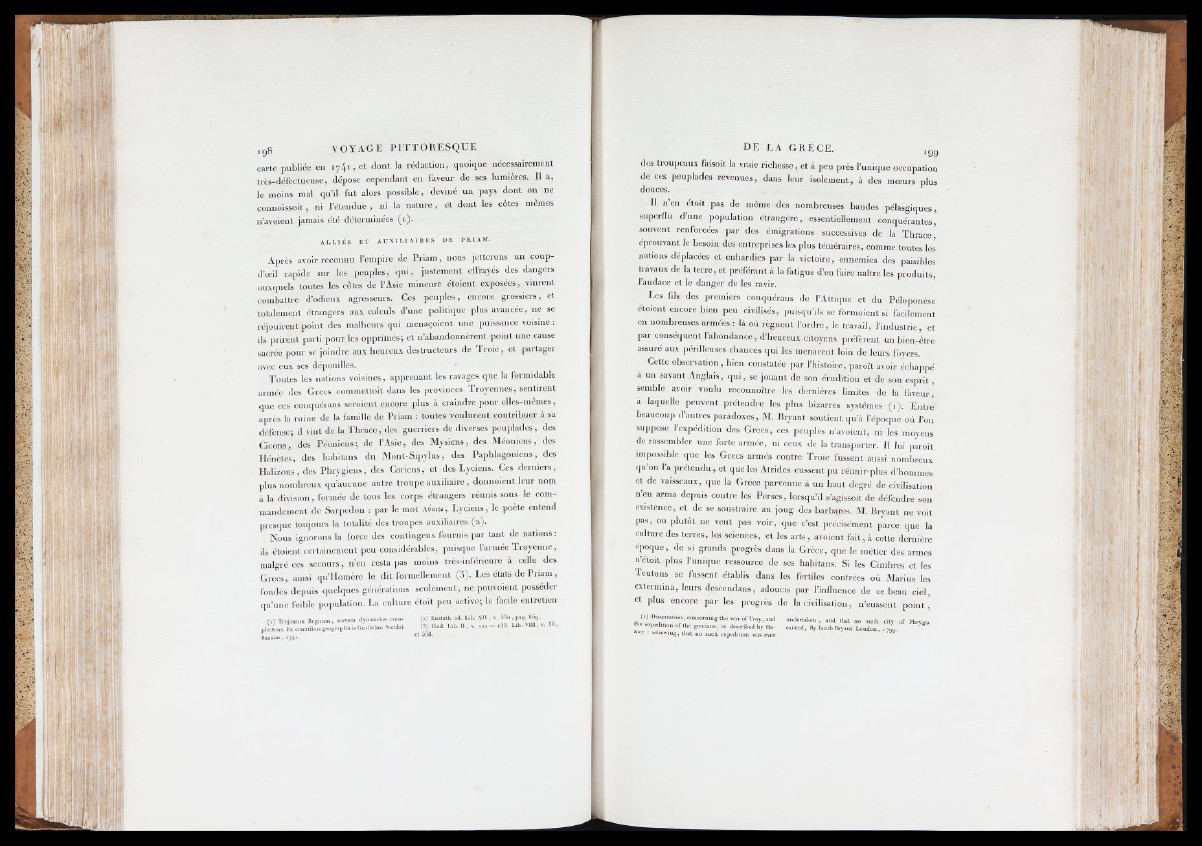
S i;
tep
■ Ab.
■À
L
|;v>
i.•.r
[#
V?*'
M
Æm
carte publiée eu 1741, et dont la rédaction, quoique nécessairement
tiès-défectucusc, dépose cependant en faveur de ses lumières. Il a,
le moins mal qu’il fut alors possible, deviné un pays dont on ne
connoissoit, ni l’étendue , ni la nature , et doul les côtes mômes
n’avoieiit jamais été déterminées (1).
A L L IÉ S E T A U X IL IA IR E S DE P R IA M .
Apres avoir reconnu l’cinpire de Pnam, nous jetterons uu coup-
d’oeil rapide sur les peuples, qui, justement effrayes des dangers
auxquels toutes les côtes de l’Asie mineure étoient exposées, vinrent
combattre d’odieux agresseurs. Ces peuples, encore grossiers, et
tolalcmcut étrangers aux calculs d’une politique plus avancée, ne se
réjouirent point des malheurs qui menaçoient une puissance voisine :
ils prirent parti pour les opprimés; ct n’abandonnèrent point une cause
s a c r é e p o u r s c j o i n d r e a u x h e u r e u x d e s t r u c t e u r s d e T r o i e , e t p a r t a g e r
avec eux ses dépouilles.
Toutes les nations voisines, apprenant les ravages que la formidable
armée des Grecs commcttoit dans les provinces Troyeiines, sentirent
que CCS coiiquéraiis seroicnt encore plus à craindre pour elles-mêmes,
après la ruine dc la famille de Priam : toutes voulurent contribuer à sa
défense; il vint dc la Tlirace, des guerriers de diverses peuplades, des
Cicons, des Péonicns; do l’A sie, des Mysiens, des Méoniens, des
Héiiètcs, des liabilans du Mont-Sipylus, des Paphlagonions, des
Ilalizoïis, des Phrygiens, des Caricns, ct des Lycicns. Ces derniers,
plus nombreux qu’aucune autre troupe auxiliaire, doiiiioieiit leur nom
i la division, formée dc tous les corps étrangers réunis sous le com-
maiidcmciit dc Sarpcclon : par le mot Atlzm, Lyciens, le poète entend
presque toujours la totalité des troupes auxiliaires (2).
Nous ignorons la force des coiiliiigens fournis par tant de nations :
ils étoicnt certainement peu considérables, imisque l’armée Troyeunc,
malgré ces secours, n’en resta pas moins très-iiilérieure à celle des
Grecs, ainsi qu'llomérc le dit formellement (3). Les étals de Pnam,
fondés depuis quelques géiiéralions seulement, ne pouvoicnt posséder
qu’une foiblc poi>ulatioii. La culuire cloil peu active; le facile entretien
OlTroiim.n. nov.ra .lyna.ato. ~m- (■) Eii.nil, .d. Lib. X I I , , ■ I'>8; “ a
j,leclons.Excüiwübu3gcügr.iphicisGi..ilclmiNicülai (3) liiad. Lib. 11, v. 122— i33. Lib. Vlil, v. ,
des troupeaux faisoit la vraie richesse, et à peu près l’nnique occupation
do ces peuplades revenues, daus leur isolement, à des moeurs plus
douces.
Il n’cn cloit pas de môme des nombreuses bandes pélasgiques,
superflu d’uno population étrangère, essentiellement conquérantes,’
souvent renforcées par dos émigrations successives de la Thrace,’
éprouvant le besoin des entreprises les plus téméraires, comme tontes les’
nations déplacées ct enhardies par la victoire, ennemies des paisibles
travaux do la lcrre, et préférant à la fatigue d’en faire naître les produits,
l’audaco et le danger de les ravir.
Les fils des premiers conqnérans dc l’Attique et du Péloponèse
etoicnt encore bien peu civilisés, puisqu’ils se formoient si facilement
en nombreuses armées : là où régnent l’ordre, le travail, l’industrie, et
par conséquent l’abondance, d’iieureux citoyens préfèrent un bien-être
assuré aux périlleuses chances qui les menacent loin de leurs foyers.
Cotte observation, bien constatée par l’histoire, paroît avoir échappé
a un savant Anglais, qui, se jouant do son érudition et de son esprit,
semble avoir voulu rcconnoîtrc les dcrmcres limites de la faveur!
à laquelle peuvent prétendre les plus bizarres systèmes ( i) . Eiitr!
beaucoup d’autres paradoxes, M. Bryant soutient qu’à l’époque où l’on
suppose l’expédition des Grecs, ces peuples u'avoicnt, ni les moyens
de rassembler une forte armée, ni ceux de la transporter. Il lui pi'iroit
impossible quo les Grecs armés contre Troie fussent aussi nombreux
qu’on l’a prétendu, et que les Atrides eussent pu réunir plus d'hommes
et de vaisseaux, que la Grèce parvenue à un haut degré de civilisation
n’en arma depuis contre les Perses, lorsqu’il s’agissoit de dél'ciidre son
existence, el de se soustraire au joug des barbares. M. Bryant ne voit
pas, ou iilulôt ne veut pas voir, que c’est précisément parce que la
culture des terres, les sciences, et les arts, avoient fait, à cette dernière
époque, de si grands progrès dans la Grèce, que le metier des armes
n’étoit plus l’unique ressource de ses habitans. Si les Cimbres ct les
Teutons se fussent établis dans les fertiles contrées où Marins les
extermina, leurs desccndaiis, adoucis par l’influence de ce beau ciel,
et plus encore par les progrès dc la civilisation, n’eussent point!
(1) «««„.ta con«r„l.,8,h.„„„(Tro).,.,.d „„derl.k,,, , ,,„d ,1,„ „o „et eit; of Ph™.
e.ped„.„„ „ritcgreo.n., >. dooribed l>y IIo- eU,ted, B, Jacob Bryr,,.!. London, ,„n
■“or ; sdiewiiig, tlici Iiü sucb «xpediiiua wds ever
F