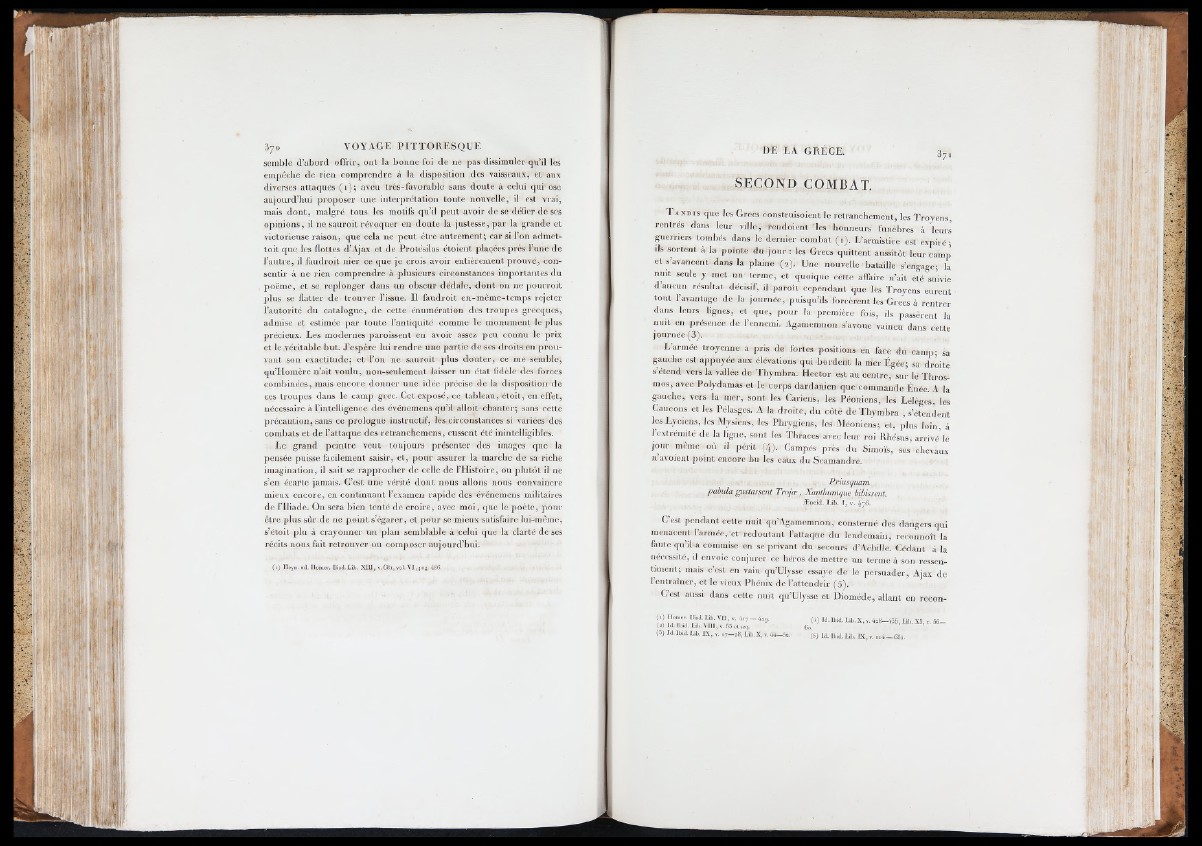
^74; ^ ■
i È
. ï .
■i" .
1 0
•1#
kk.î
i
Y®1 '' 1'
" ' ¡ " ' ' Y
"ri f
semble d’abord offrir, ont la bonne foi de ne pas dissimuler qu’il les
em])cclic de rien comprendre à la disposition des vaisseaux, ct aux
diverses attaques ( i ) ; aveu très-favorable sans doute à celui qui ose
aujourd’hui proposer une interprétation toute nouvelle, il est vrai,
mais donl, malgré tous les motifs qu’il peut avoir de se défier dc scs
opinions, il ne sauroit révoquer en doute la justesse, par la grande ct
victorieuse raison, que cela ne peut être autrement; car si l’on adraet-
toit que les flottes d’Ajax et de Protésilas éloient placées près l’une de
l’autre, il faudroit nier ce que je crois avoir entièrenienl prouvé, consentir
à ne rien comprendre à plusieurs circonstances importantes du
poëme, et se replonger dans un obscur dédale, dont on jie pourroit
plus sc flatter de trouver l’issue. 11 faudroil en-mème-tcmps rejeter
l ’autorité du catalogue, de cette énumération des troupes grecques,
admise et est imée par toute l’antiquité comme le monument le plus
précieux. Les modernes paroissent cn avoir assez peu connu le prix
et le véritable but. J’espère lui rendre uue partie de ses droits en ¡»rou-
vanl son exactitude; ct l’on ne sauroit plus douter, ce me semble,
cju’Homère n’ait voulu, non-seulement laisser un étal iidèle des forces
combinées, mais encore donner une idée précise de la disposition de
CCS troupes dans le camj) grec. Cel exposé, ce tableau, étoit, 011 effet,
nécessaire à rintelligence des événcmens qu’il alloil chanter; sans cette
précaution, sans ce prologue instructif, les circonstances si variées des
comi)als et de l’attaque des retranchcmens, eussent élé inintclligil»lcs.
Le grand peintre veut loujours présenter des images que la
pensée puisse facilement saisir, ct, pour assurer la marche de sa riche
imagination, il sait se rapprocher de celle de l’Histoire, ou plutôt il nc
s’cn écaTlc jamais. C’est une vérité dont nous allons nous convaincre
mieux encore, en continuant l’examen rapide des événemcns militaires
de ITliade. On sera bien tenté de croire, avec moi, que le poète, pour
être plus sûr de ne point s’égarer, et pour se mieux satisfaire lui-môme,
s’éLoit plu à crayonner un plaJi semblable à celui que la clarté de scs
récits nous fait retrouver ou composer aujourd’hui.
(1) Ile jn . Bd, Homer. liiiid.Lil., X ll l, v. 68i , voi. V I,p û g . 48C.
SECOND COMBAT.
T a k d i s qno les Grecs construisoient lo retranchement, les Troyens,
rentrés dans leur ville, rendoient les honneurs funèbres à leurs
guerriers tombés dans le dernier combat ( i) . L ’armistice esl expiré;
ils sortent à la pointe du jour : les Grecs quittent aussitôl leur cami!
et s’avancent dans la plaine (2). Une nouvelle bataille s’engage; la
nuit seule y met un terme, et quoique cette affaire n’ait é té r iiv ie
d’ancun résnital décisif, il jiaroit cependant que les Troyens eurent
tout l’avantage de la jonriiée, puisqu’ils forrèreiil les Grecs à rentrer
daus leurs lignes, cl que, pour la première fois, ils passèrent la
nuit en présence dc l’ennemi, -Vgamcmnon s’avoue vaincu dans celte
journée(3).
L ’armée troycime a pris de fortes positions en face du camp; sa
gauche est appuyée aux élévations qui bordent la mer Égée; sa di Yte
s’étend vers la vallée de Thymhra. Hector est au centre, sur le Throsmos,
avec Polydamas ct le corps dardaiiien que commande Énée. A la
gauche, vers la mer, sont les Carieiis, les Péoniens, les Lélèges, les
Caucons et les Pélasges. A la droite, du côté de Thymbra , s’étendent
les Lyciens, les Mysiens, les Phrygiens, les Méoniens; et, jilns loin, à
l’extrémité dc la ligne, sont les Tbraces avec leur roi Rhésus, arrivé’ le
jour même où il périt (4). Campés prés du Simoïs, ses chevaux
u’avoicnt ¡loinl encore bu les eaux du Scamandre.
P r iu sq u am
pa hu la gm tas sent Tm joe , X an tlam u ju c bihissent.
Æiiokl. Lib. I, V. 4;6.
C’est pcndanl cette nuit qu’Agamemnon, consterné des dangers qui
menaçait l’ariiiée, et redoutant l’attaque du lendemain, reconnoît la
faille qu’il a commise en se privant du secours d’Acbille. Cédant à la
nécessité, d envoie conjurer cc liéros de mettre un terme à son ressentiment;
mais c’esl en vain qu’Ulysso essaye de le persuader, Ajax de
l’cnlraîucr, cl le vieux Phénix de l’attendrir (5).
C’cst aussi dans celte nuit qu’Ulyssc cl Diomède, alLant en recon-
(1) llonior. Ill,ul.Llh,V ir,v. 417 — 429.
(2} 1.1. ll.itl.Xail..VIll,v, 55 el»cq.
(5) Itl.lbiJ.Lib. IX, V. .7— 28, L ib .X ,v .4'i— 52.
(■i) Iti. Ibid. Lib. X , V. 428—435, Lib. X I, V. 66—
5o.
(5) Id .ib id .L ib . lX , v . i i 4 - 65i.