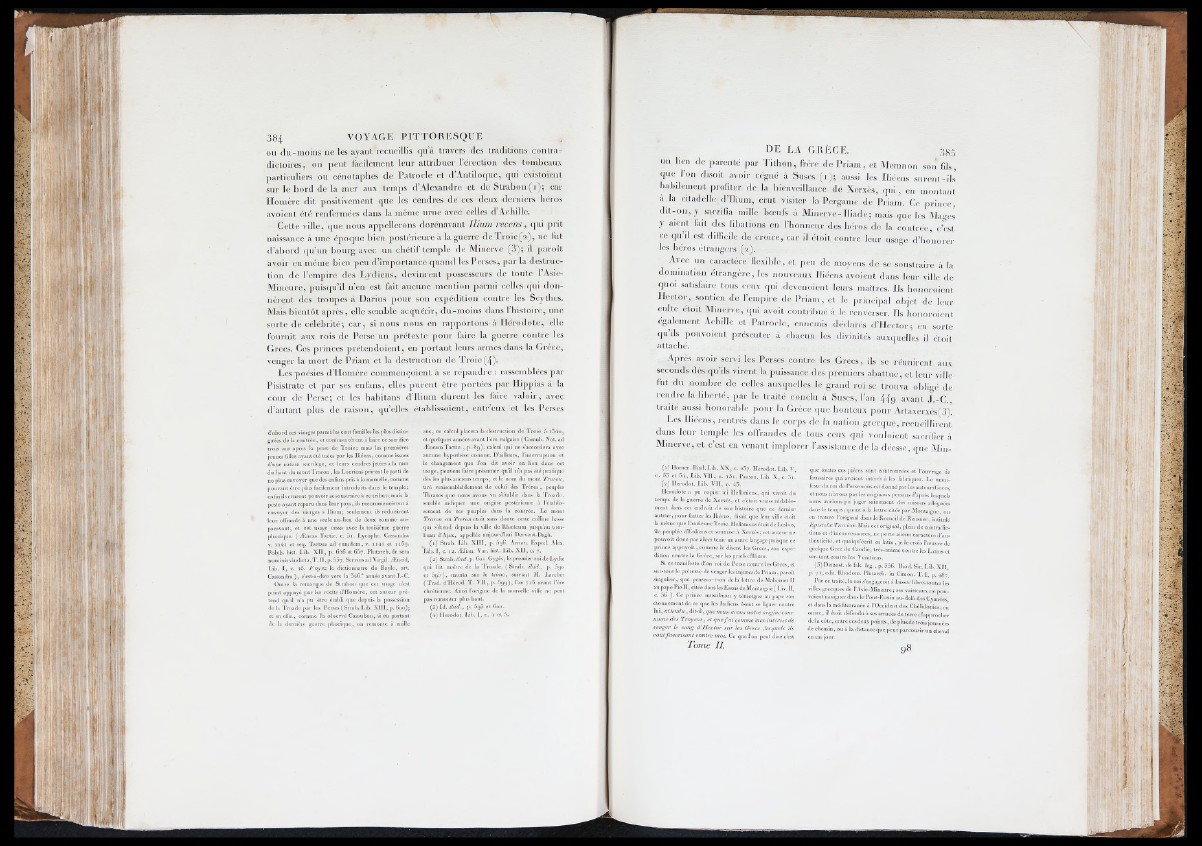
■•V
1'*^^
tm
F -ft ■
:1>
it V
ë: ‘ i
384 V O Y A G E P IT T O R E S Q U E
ou (lu-moius ne les ayant recueillis (ju’à travers des traditions contra-
dicLoires, on peut facilement leur attribuer 1 érection dos tombeaux
parliculiers ou cénotajilics de Patrocle et d’Antiloquc, cjui cxisloient
sur le bord dc la mer aux Icmjts d’Alexandre ct dc Straljon ( i) ; car
llomère dit positivement que les cendres dc ces deux derniers héros
avoient été renfennces dans la mémo urne avec celles d’Acbille.
Celte ville, que nous appellerons dorénavant Hinm recens, (pli prit
naissance à une époque bien postérieure à la gnerro dc T ro ie# ) , ne lut
d’abord (pi’un bourg avec un chétif temple de Minerve (3); il jmroît
avoir cil même bien peu d’importance Cjuaiid les Perses, par la deslrnc-
tion de l’empire des Lydiens, devinrent possesseurs de toute l’Asie-
Mineiirc, puisqu’il n’cn est fait aucune mention jiarmi celles (¡ui donnèrent
des troupes à Darius pour son expédition conLre les S(‘)lhcs.
Mais bientôt après, elle semble acquérir, du-moins dans l'histoire, une
sorte dc célébrité; rar, si nous nous cn rapportons à Tlérodotc, clic
fournit aiLx rois de Perse un prétexte pour faire la guerre eonirc les
(irccs. Ces jii’inces prétcndoicnt, cn portant leurs armes dans la (irccc,
venger la mort de Priam ct la destruction de Tro ie(4).
Les poésies d’Homère commcnçoient à sc réjiaudrc : rasseinj)l(®s par
Pisistratc et par sos enfans, elles purent être portées jiar Hipjiias a la
cour dc Perse; et les habitans d llmm diu'cnt les faire laloir, avec
d’autant jdtis de raison, qu'elles étnbli.ssoienl, eutr’cux et les Perses
d’abord ces vierges p.nvnii les cent familles les plus Jisliii-
girces de la conti ée, et coninieiicèreût à faire cc sacrifice
trois ans après la prise île Troie; mais les premières
jeunes filles ayaiiiclé tuées par les Iliccns, comme issues
d’une iiatiuii sacrilège, ei leurs cendres jetées à la mer
du baul Ju monl T raroii, les Locriens prirent le parti dc
nc plus envoyer que des cnfans pris à la mamelle, comme
poiiv.ml être plus facilement iniroduiis dans le temple ;
cofinilscrurent pouvoir sesoustraireà ce tribut; mais la
peste ayant reparu dans leur pays, ils recommencèrent à
envoyer des vierges à Ilium; seulement ils réduisirent
leur offrande à une seule aii-lieu dc deiij; comme auparavant,
ot cet usage cessa avec la troisième guerre
pliociqiie. (Æiieas Tactic, c. ÔJ. Lycoplir. Cassandra
V. i i 4l ot .seq. Tzetzes ad cumdcm, v. i i i l el 1169.
Polyb. llist. Lib. X I I , p. 656 el 657. Pluiarcli.de sera
iuiiuiiiisvindicla,T. I I, p. 557. Servius ad Virgil- Æneid,
Lib. I , V. 45. Foyez le dictionnaire de Bavle, arl.
Cassandra ) , c’esl-à-dirc vers la 5 i 6." année avanl .T.-C.
Outre la remarque dc Strabon qnc Cet usage n’est
point ap]in\é parles récits d'H omère, c
tend qu'il n’a pu être elabli que dcpuu
delà Troade par les Perses (Slrab. Lib. X III, p. 600);
cl cn effet, comme l’a observé Casaiibon, si en pariaiil
de ia dernière guerre phooiquc, Oii remoiilc à mille
ans, ce calcul placera la destniclion dc Troie à i 54o,
cl quelques années avant i’ère vulgaire ( Casaub. Not, ad
-‘Eneam Tactic., p. 89) , calcul qm no s’accordera avec
aucune liypotlièse connue. D’ailleurs, î’iulcrrujilioii el
le cliaiigemeiil que l’on d u avoir eu lieu dans cet
usage, peuvent faire présumer qu'il n’a pas élé pratiqué
dès les plus anciens temps; e lle nom du monl Truron,
liic vraisemblablenicni de celui dos Trèrcs , peuples
Tliraces que nous avons vu s’établir dans la Tioade,
sondile indiquer une origine postérieuro à l’élaldis-
semeal dc ces peuples dans la contrée. Le mont
Tritron ou T/’e w i étoil sans doute celle colline b.issc
<|ui s’étend dcjiuls la ville de Rli.-eleiim jusqu’au loin-
beau d’Ajax, appellee aujourd’iiui Derveiil-Dagli.
(1) Slrab. Lib. X l l l , p. Arrian. Lxpcd. Alex.
L ib .J ,C . lU.Ælian. Var. liisl. L ib .X Ü , c. 7.
(2) Slrab. ièrrf. p- 601. Gygès, le premier roi de Lydie
qui fut maino de l.i Troade. ( Strali, ibid., p. 590
cl 5 9 5 ), inoiita sur lo Ivône, suivant M. Larclier
(Tnid. d’IIérod. T. VU, p. 6 9 9 ), l'an 716 avant l'èro
clirèlicimc. Ainsi l’origine de la nouvelle ville nc jicnl
pas roinonlor pins liant.
(5) Id. ibid., p. 590 et 60J.
( t ) llerodot. Lib. 1. c. 'i el 5.
mi lien <lc p.ireiil,; par 'Eillion, frère de Priam, el Mcmmm son fils,
qne l'ou dl.soil .avoir rèf;né à .Sirses ( i ) ; anss. les lliècns .siireiil,-il!
Iiab.lemcm profiler dc la hicnvelllauee de Xerxès, qni, en monlanl
a la ciladellc d’ilium, erul vriller la Pergame dc Priain. Ge prinee,
dll-on, y sacrifia mille boeufs à Minerve-Jlfidc; mais que les Mage!
y aienl fini des libalions en l'Iioiincur des béros dc la conln’e , e’esl
cc qii’il esl dillicile de croire, car il etoil conlrc leur usage d’Iionoicr
les béros étrangers (a).
Avec un earaelèrc ilexibic, ct jien dc moyens dc sc soustraire à la
domination étrangère, les nonvean.x Iliécus .avoieul dan.s leur ville de
quoi salrifiiire tous ceux qui dcvcuoicnt leurs maîircs. Jls liouoroieni
Hector, .soutien dc l’empire de Priam, cl le prbieijial olrjel de leur
culte etoit Minerve, qui avoit emitribiié li le reuveivser. Ils lionoroieiit
ég,ilcmerit Aelfillo el J’atroele, eiiiie.iiis déclarés d’Hector; eu sorle
qu’ils jiouvoiciit présenter .à eiiacuu les diviuilits auxquelles il étoit
altaclii'.
Ajircs .avoir servi les l’ crses contre les Grecs, ils sc réuiilrciit aux
seconds dès qu’ils virent la puissance des iiremicrs abatluc, cl leur ville
fut du nomlire de celles auxquelles le grand roi sc trouva obli-é dc
rendre la liberté, jiar le traité eoitelti à Suses, l’an 44g avant .I.-C.,
traité au.ssi honorable jiour la (frèec cpic boiUeux jiour Arlaxcrxè5(.fi).
Les lliéeus, reulriri dans le corps de la ualimi grerijuc, recueillirent
d.ans leur tcmjilc les offrandes de tous ceux qui vouloieiit sacrifier à
Minerve, et c’cst eu venant inijilorcr r.assislaiirc de ia ditesse, qnc ùlin-
( j ) Ilonici'. Iliad.Lib. XX, v. 237. llerodot. Lib. V,
c. 55 et 5(k Lib. V i l, c. j 5 i. l\nis.an. Lib. X ,c . 3i.
(2) llcrodol. Lib. VII, c. -i5.
llerndote a |iii copier ici Ilcllaiiiciis, qui vivoit du
temps dc la guerre de Xerxès, el c’étoil vraiscmlilabJe-
meiil dans cet cndroil dc sou liisloire que cc «leriiier
auteur, pour Qatler les Iliécus, disait quo leur ville éloit
la même que l’aiicicuue Troie, lloilanicaséioilde Lesbos,
tle peuplée d’I'iolieiis ci soiiuiiso à Xcrxès; cel auteur ne
pouvoil donc pas alors tenir un aime lang.-igc puisque cc
princc appuyoil, comme le disent les Grecs, son expédition
contre la Grèce, sur les grief» d’ilium.
Si cc maiiifcsio iFiin roi dc Perse conlrc les Grecs, cl
siir-loiu le prétexte dc venger les injures de Priam, paroit
singulier, que |icuscra-i-ou Je la lettre dc Maliomcl 11
an ¡lapo Pic U, citée dans les Es.sai» dcMoiilaignc ( Liv. Il,
c. 56 ). Cc prince niitsulnian y lémoiguc au pape .son
ctonucmentdc cc que les Italien» osent so liguer contre
lui, níípiií/íi, dit-il, quenouf: aïoiis notre origine com-
munpdv.% Troyrns, et que j'nt comme cu.r interest de
venger le sang d'Hector sur les Grecs ,lesquels ils
von! favorisant contro moi. Cc que l’on peul dire c’eat
Tonie II.
que toutes ces pièces sonl comrotivécs ct l’ouvrage de
J'aussaircs qui avoicnl intérêt à les fabriquer. Le rnaiii-
feslodu roi de Perse nous est donné par les aulcursGrecs,
ct lions n'avons p « les originaux pei-sans d’après iesepiels
lions aurions |hi juger saiueuicul de» raisons allé-uécs
daiislr 1<-Iiip» ;i|uant à la lettre citée par Montaigne, ou
ou iroiivo l'original Jans le Recueil do Reusncr, intitulé
Epistoiæ T„,xicoe.yh.n cel original, ¡.Icin de coiitradic-
lioiis et d'incouvcnaiiccs, nc porte .aucun caractère d'au-
llienticité. el (¡uoiqu’écrit en latin, je le crois rreuvi-e de
quelque Grec dc Candie, très-animé contre les Latins cl
sur-tout contrôles A'énilicus.
(3) Dcmost. <lc fais. leg., p. 556. Diod. Sic. Lib. X II,
p. 74, edit. RlioJom. riinarcii. iu Cimon. T. 1. p. .igy.
Par cc irailé, le roi s’eng.igcoit à laisser lilires toutes les
villes grecques de l’Asic-Miuourc; ses vaisseaux ne pou-
voieiil naviguer dans lo Puiil-Euxin au-delà des Cyauées,
cl dans la mcditorranéc à l’Occident des Cliélidonics;eii
o u tre , il éloil défendu à scs années do terre d’approcher
dola còte, entre ces deux points, dcplusde trois journées
de clicmin, ou à la distance que peut parcourir nn cheval
IU jour,
I •‘■S., i
"-■” 1
-t-
^ -
98
"ri
•F,