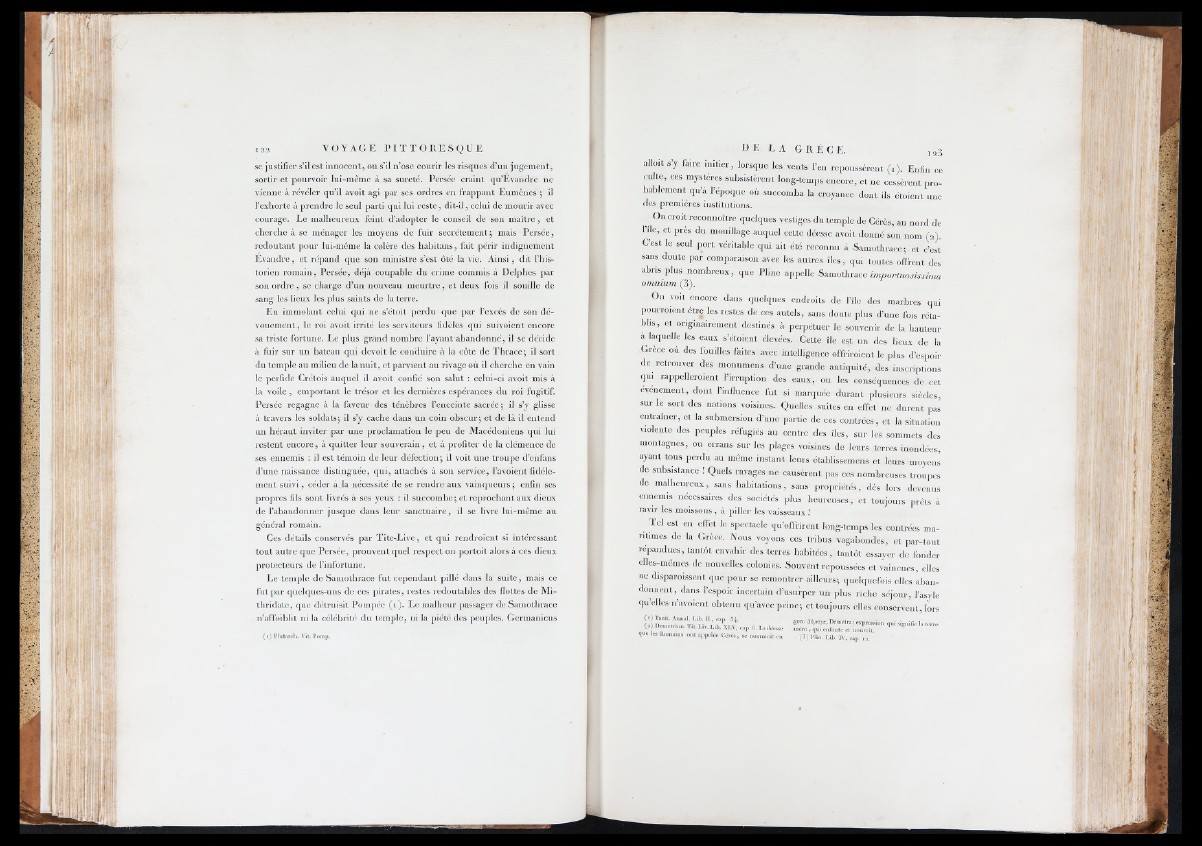
s»
I - *
sc juslificr s’il est ¡miocciii, ou s’il n’ose courir les risques cruii jugement,
sortir ct pourvoir lui-même à sa surcLc. Persce craint qu’Evandrc nc
vienne à reveler qu’il avoit agi par scs ordres en Irappant Eumèncs ; il
rexhortc à [»rendre le seul parti qui lui reste , dit-il, celui de mourir avec
courage. Le malltcurcux i’eint d’adopter lo conseil dc son maître , ct
cherche à sc ménager les moyens de luir secrclement ; mais Persce,
redoutant p(»ur lui-mcme la colère des habitans, l'ait périr indignement
Evandre, ct répand que sou ministre s’est ôte la vie. Ainsi, dil l'iiis-
torien romain, Persce, déjà coupable du crime commis à DoQlics par
son ordre, sc charge d’un nouveau meurtre, et deux fois il souille de
sang les lieux les plus saints de la terre.
En immolant celui qui ne s’étoit perdu que [»ar l’excès de son dévouement,
le roi avoil irrité les serviteurs fidèles qui suivoient encore
■sa triste l'ortune. Le plus grand nombre I’ayant-abandonné, il sc décide
a fuir sur un bateau qui dcvoit le conduire à la côte dc Tlirace; il sort
du temple au milieu de la nuit, et parvient au rivage où il cherche en vain
1e perfide Crétois auquel il avoil confié son salut : celui-ci aAoit mis à
la voile, emportanl le trésor et les dernières es[»éranccs du roi fugitif.
Persée regagne à la faveur des ténèbres l’cnccinle sacrée; il s’y glisse
à travers les soldats; il s’y cache dans un coin obscur; et de là il entend
un héraut inviter par une proclamation le peu dc Macédoniens qui lui
restent encore, à quitter leur souverain, ol à profiter de la clémence dc
scs ennemis : il est Lénioni de leur défection; il voit une troupe d’cnfans
d’une naissance distinguée, qui, attachés à son service, l’avoient fidèlement
suivi, céder à la nécessité de se rendre aux vainqueurs; enfin scs
propres fils sont livrés à ses yeux : il succombe; el reprochant aux dieux
de l'abaiidoiiiier jusque daus leur sanctuaire, il se livre lui-même au
général romain.
Ces détails conservés par Tilc-Live, et qui rcndroient si intéressant
tout autre que Persée, prouvent quel respect on [»ortoit alors à ces dieux
protecteurs de finforlune.
Le temple dc Samothrace fut cepcndaiil pillé dans la suite, mais ce
fut par quelques-uns dc ces pirates, restes redoutables des flottes de Mi-
thridale, que détruisit P(»m[»éc ( i) . Le malheur [»assagcr de Samothrace
ifalfoihlit ni la célébrité du Lcm[»lc, ni la [»¡été des ()eiq»les. Gerniaiùcus
( i ) Plutarch. A'it. Pomp.
alloit s’y faire initier, lorsque les veirts l’eu repousscreiil (1), Eiiliir ec
eullc, ces mystères suLsistèrciit long-temps encore, ct irc cessèrent pro-
Jiablemcnl qu’à l’époque où succomba la croyance donl iis cto,eut une
des premières institutions.
^ On croit rcconnoîtrc quelques ycstigos du temple de Cérès, au nord do
l’ilc, cl près dn mouillage auquel celte déesse avoit donné son nom (2).
C’est le seul port véritable qui ait été reconnu i Samotlrraco ; ct c’est
sans doute par comparaison avec les autres îles, qui toutes ofi'rcnl des
abris plus nombreux, que Plme ap,,ellc Samoünccc importuosissima
omnium (^3).
Ou voit encore dans quelques endroits de l’ile des marbres qui
pourroicnt être les restes de ces autels, sans doute plus d’une fois rétablis,
ct originairement destinés à perpétuer le souvenir dc la bauteur
a laquelle les eaux s’étoicut élevées. Cette île est uu ties lieux dc la
Grèce où des fouilles faites avec inlelligence offriroicnt le plus d’espoir
de retrouver des monumens d’uno grande antiquité, des iuscri|>tions
qui rappcllcroicnl l’irruption des eaux, ou les conséquences dc cet
cvcnemeiit, dont l’iuilucucc fut si marquée durant plusieurs sièelcs,
sur le sort des nations voisines. Quelles suites en elfct ne durent pas
entraîner, ct la submersion d’une partie de ces conlrées, ct la situation
violente des peuples réfugies au centre des îles, sur les sommets des
montagnes, ou errans sur les plages voisines de leurs terres inondées,
ayant tous perdu au même instant leurs ctablissemens ct leurs moyens
de subsistance ! Quels ravages ne causèrent pas ces nomlnciises troupes
dc mallicurcux, sans liabilatioiis, sans jiropriétès, dès lors devenus
ouiiemis nécessaires des sociétés plus lieureuses, et toujours iirèls à
ravir les moissons, à pilier les vaisseaux!
I c i est eu cflcl le spectacle qu’offrirent long-temps les contrées ma-
riUmcs dc la Grèce. Nous voyous ces tribus vagabondes, et par-tout
répandîtes, tantôt ciivaliir dos terres liabitées, taiilot essayer dc fonder
cllcsrtiiêmes dc nouvelles colonies. Souvent repoussées et vaincues, elles
ue disparoisseiil que pour sc remontrer ailleurs; quelqnclbis elles aliaii-
doiinciit, dans fespoir incertain d’usurper un plus riclic séjour, l’asyle
qu’elles n’avoient obtenu qu’avec pcmc; ot loujours elles conservent, lors
ie lit terre-
(1) Tacit. Annul. Lih. II, cap. 5/|.
(2) Dfmctrion- Tit. Liv. Lih. \ 1,V, cap, 6. La ilci
que les Hoinuiiis out appeli5c COri-s, se iiominoil
grec Axu»r/5a,D<?inétra; expresión qui
iiièrc , qui eiifaulc ot uotirril,
(,3) Win, Lib. IV, cap, 12.
m
m
1 'X m I â
Q w