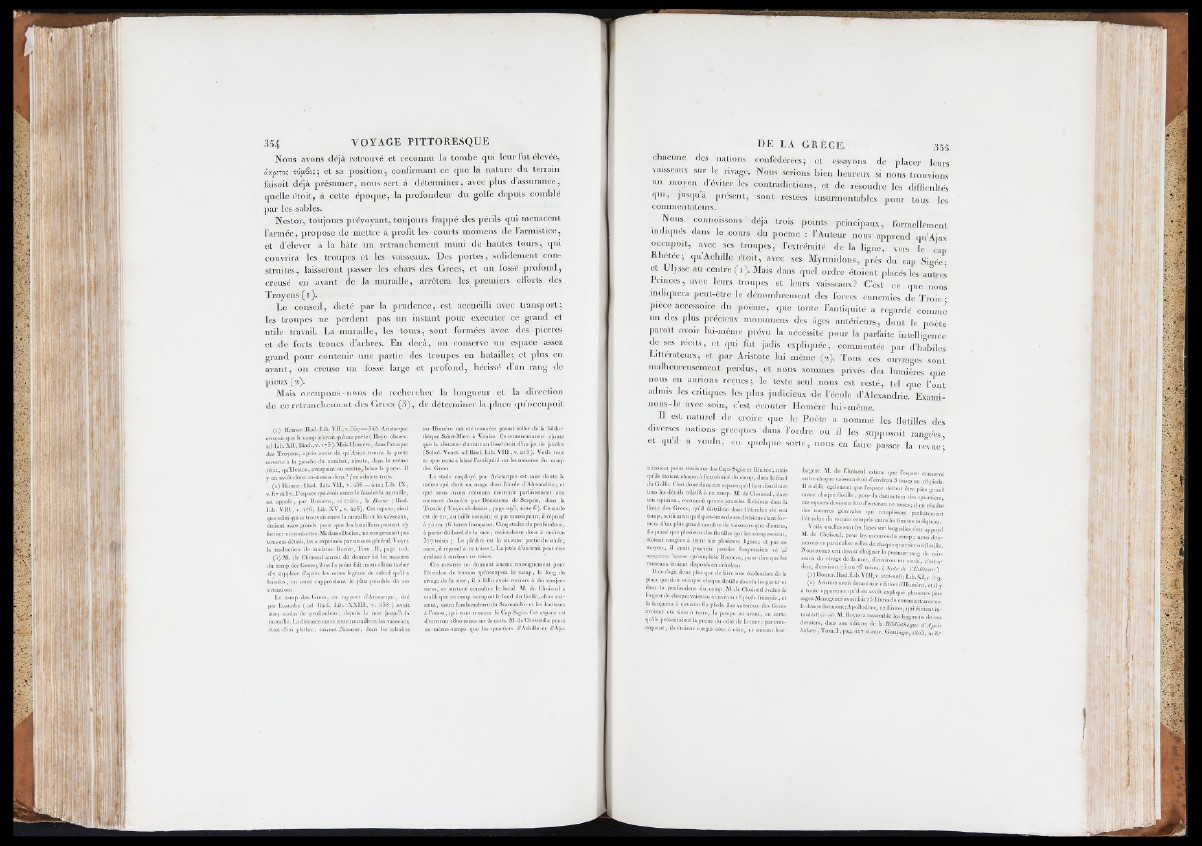
I;;:!
I #
m
r i i
p i
P i
N o n s avons d é jà re t ro u v é et re c o n n u la tom b e q u i leu r fu t élevée,
«xpiToç c l sa p o s i t io n , coufirmaiiL c c (pic la iiaLurc d u Lerrain
biiso it dé jà p r é sum e r , nou s sert à déLc rminer, a v e c p lu s d ’a s suran ce ,
q u e lle é t o i t , à c e tte é p o q u e , la p ro fo n d e u r d u g o lfe dep u is com b lé
p a r les sables.
N e s to r , to u jo u r s p r é v o y a n t, lo u jo u r s fra p iié des p é r ils (pii men a cen t
l'a rm é e , p ro p o s e de mcLtre à p ro f it les co u r ts m om cn s d e r a rm isü c c ,
e t d ’é lev er ù la h â te u n relranc licme iiL mu n i d e hautes to u r s , qui
co u v r ira les tro u p e s c l les vaisseaux. D e s p o r te s , soU dc in ciit c o n s
t ru ite s , laisseront passer les ch ars des G re c s , e t uu fossé p r o fo n d ,
creusé en avan t (le la m u r a ille , a r rê te ra les p rem iers eiloiTs des
T ro y e n s ( i ).
Le conseil, dicté par la prudence, est accueilli avec transport;
les troupes ne perdent pas un instant pour cxccuLer cc grand et
utile travail. La muraille, les tours, sonl formées avec d(°s pierres
e t dc forts troncs d’arbres. En deçà, on conserve nn espace assez
grand pour contenir une parlic des troupes en bataille; et plus cn
avant, on creuse un fossé large et profond, liérissé d’un rang de
pieux (2).
Ma is o e c iip o n s - iio i is d c r c c b c r e h e r la lo n gu eu r c t la d ire c t io n
d c ce l ' c t r a i i c b u m e i i L des ( ir c c s ( 3) , d c d é l c n u l n e r la p la c e «pi’o c c u p ü it
( j) Homer. Uiad. LU.. V II, v. 55? — 545. Arislarque
crovoiique Iccamp n’avoil qu’une porle ( tlcvu. observ.
ad Lib.XÜ, lliad., V. irS). Mais Homère, dans l'altaque
dos Troycus, .après avoir dil qu’Asiua trouva la porlC
ouveric à la gauche du couibal, ajoulc, dans le même
récit, (¡u’IIcclor, altaqiianl au centre, brise la porio. 11
y en avoil donc au-moins deux? j’en adiiicL« trois.
(a) Ilomer. Iliad. Lil). V II, v. 456 — 4 42; Lib. IX ,
V. 67 0187. L'espace qui éloil entre le fossé cl la inuraille,
esl apiiclé, par Homère, t» Stî'/oî , lu Eeriie ( Dind.
Lib. V IH , V.476; Lib. X V , V. 4a6 )- Cci espace, ainsi
que celui qui sc Irouvoil enlre la muraille et les vaisseaux,
éioienl assez grands pour que les bataillons pussciil s’y
former cl coiiibaltrc. MadamcDacier, ne comprciianl pas
tous ces délails, les a exprimés par un sens général-X oyez
la iraducdon dc madame Dacier, Tom- I I , page io5.
( 5) M. dc Clioiseul auroil dû donner ici les mesures
du camp des Urocs; il nc l’a point fail : nous .allons làcber
d’y sup|ilécr d’après les noies légère.« de calcul qu’il a
laissées, en nous rapprocbanl le plus possible de ses
inlcnlioiis.
l.c camp des Grecs, au rapport d'A rislarqiie, cilé
par EusiaïUo ( ad Iliacl. Lib. X XIU, v. 358 ) avoii
ciiic| slades do profondeur, depuis la mer jusqu’à Ja
muraille. La distance entre celle mnraillo el les vaisseaux
éloil d’un pléibre, suivant Xicanur, donl les scliolics
sur Homère oui élé trouvées parmi celles dc la biblio-
llièt|uc Saiul-Marc à Vèiiise. Ce coinmcnlalcur ajoulc
que ia distance du mur au fossé éloil d’un jcl de javclol
(Schol. Venei. ad lliad. Lib. XTII, V-2 13). Voilà tout
cc que nous a laissé I'aijliqultc sur les mesures du camp
des Grecs.
Le sladc cmplo5-c par Arislarquc esl sans doule )o
même qui éioil en usage daus f école d’Alexandrie, ci
que nous avons reconnu convenir parfailemcnl aux
mesures données par üémélrius de Scepsis, dans la
Troade ( X oyez ci-dessus, j.agc ag ô , noie 6 ). Ce stade
csl de 10, au nulle romain ; el par conséquent, il répond
i 75 ou 76 luises françaises. Cinq stades de profondeur,
à partir dn bord dc la mer, rcvicndroiU donc à environ
577 loiscs * Le plélhrc csl la sixième parlic dn sladc;
ainsi, il répond à 13 loiscs j. La jclécd’un iraitpenl élre
évaluée à environ 10 u.i.scs.
Cos mesure» ne donnanl aucun reiiscigncmont pour
l’élcnduc dc lerrain qu’occupoil lo camp, ic long du
rivage dc la mer, il a lidlu avoir rccoui-s à des conjcc-
lurcs, 01 sunonl consullcr le local. M. dc Clioiseul a
établi CJUC cc camp occupoiile fond du Golfe, alors cxi-
siant, cuire l’eral.oucliiircdn Seamandic cl les baulcnrs
à l’ouest, qui vont trouver le C.ip Sigéc. Col espace c.d
d’environ 1800 toises sur la c.irlc. M. dc Choiscui a prnsé
en-même-lenips que les quarliors d’Achille ci d’Ajax
chacune de.s nation.s
vaisseaux sur le rivage.
confi-déixies; et essayons de placer leurs
ç,.. Nous serions bien Jicurenx si nous trouvions
un moyeu d’éviter les couiradictions, et de résoudre
qui, jus([Uii présent, sont restées insurmontables iio
eomuientatcurs.
Nous coimoissons déjii trois points pri,icip.mx, formellement
iiHlupiés daus le cours du poeme : l’Aulcur uous apprend tnfAjax
occupoit, avec scs troupes, l’extrémité dc la ligue, vers le cai)
Rliétéc; iju’Aclulle étoit, ,aycc scs Myrinidous, ¿res du ea,, Sigéc-
Cl Ulysse au centre ( ,) . Mais dans quel ordre étoient placés les autre!
Pfiuccs, .avec leur.s tro,q,es et leurs vaisseau.x? C’cst ce quo uous
indiquera peut-être le dénumbix'iiumL des forces ('1111011005 de Troie*
pièce accc.ssoire du poème, que tottle l’auti.[nitè a regardé comm!
un des plus précieux monumcns des âges antérieurs, dont le poète
paroît a-roir Im-mèmc jn-évu la nécessité pour la parfaite intelligence
de scs récits, et (pu fut jadis expliipiéc, commentée par d’iiabilcs
Littérateurs, ct par Aristotc lui même (,.). Tous ces ouvrages sont
mallicnrenscmcnt [icrdus, ct nous sommes privés des lumières quo
nous en aurions reçues; le texte seul nous est resté, tel qnc l’ont
admis les critiques les plus judicieux de l’école d’.Ylexandric. Examinons
les diificultés
tous les
le avec soin, c’esl écouter Homère lui-mème.
Il esl naturel de croire ,jue le Poète a nommé les Ilotillcs des
diverses nations grec,pics dans l’ordre où il les siqiposoil ranoécs,
ct qu’il a voulu, quelque .sorle, uous cn lâire p.as.scr la r en ie ’-,
n’éloient poitil siméswi- les Caps Sigée et Rhélée, mais
qu’ils cloicni chacun à l’oxuémiié du camp, dans le fond
du Golfe. C’esl donc dans cci c.spaco qu’il fant distrihiici-
lous les déuails i-clalifs à ec camp. M. de Choiscul, dans
son opinion , rccomioîl quatre gramics divisions dan.s la
llolic des Grecs, qu’il disirihue dans l’élcnduc de son
camp; sculcmoulquel<|ues-unesdo ses dlvi-sionsélanlfoi--
mécs d’uu pins grand nombre do vais-scaux que d’aulrcs,
il a pensé qno plusieurs des Ilotillcs qui les coniposoicui,
éloicnl rangées à lene sur plusiom-s lignes; el
moyen, d croit pouvoir jusliiicr l'exprcssion
, >-
wfMfOirtra; 'ifoeat qil’einploic llonic
dire quo les
vaisseaux éloient disposés cn éclicloi
U ne s’agit donc plus que dc faire une cvalualio
dc la
l)lacc(|ue<loii occuper chaque Ilolillc dans la loiig.iom et
dans la piofondcui- du camp, M. dc Choiscul évalue la
lai-gcnrdc chaque vaisseau àcinli ou 18 pieds ii-ançais ,c t
la longueur à ei.vii-l.ii 60 ]iio,is. J,cs vaisseaux des Groes
qu’ils p.-éscnlüionlla ¡irouc du còlè dc la mer; par conséquent,
ils éloicnl rangés cóle à cèle, cl suivanl leur
Jargcm-, M. de Clioiseul csiinic que l'espace conservé
entre cl.aqne vaisseau éloil d'environ 5 loises ou 18 pieds
11 élablii cgalcmciH que 1’c.space devant être plus grand
eiuro chaque lloiillo, pour la dislinclion des quartiers,
CCS espaces ilevoiRiilètro d’environ 10 loises; il eu résulte
des mesures générales qui remplissent ’parfaiiemenl
1 clonduc du lcri-ain compris entre les limites iudiquécs.
Voilà^ quelles sont les bases sur lesquelles s’cst appuyé
M. de Clioiseul, pour les mesures du camp ; nous donnerons
en parliciiiiei- celles dc chaque quartier on flolille.
Nous avons cru devoir éloigner lo premier rang dc v aisseaux
du riv agc dc la mer, il'eiiviron un siade, c'csl-à-
dire, d’environ çôouyG loises. (Noie de VÉdiUur.)
(1) llomcr. Iliad.Lib. VIII, V. 223-226; Lil..XJ,v.ü-<).
(2) Aristotc avoit donné «ne édliion d'H omère, cl il y
a lonie apparence qn 1! cn avoil expliqué plusieurs passagcs.
Méuogones avoit failaolÀv-rcsdc commeniairessur
le dénombrcmcnt;Apoliodorc,J2Livi-cs, qui éloicnl inliluk
»n«i .-.¿-rt.XI. llcyne a rassemblé les fragmens dc ces
dei-nici-s, tiaus son édition do la Bibliothèque d'.lpal.
lodorc, Tom. 1, pag. -n 7 cl sniv, Goiiiiigte, i 8o5 , in-a,«
**•4.
j l