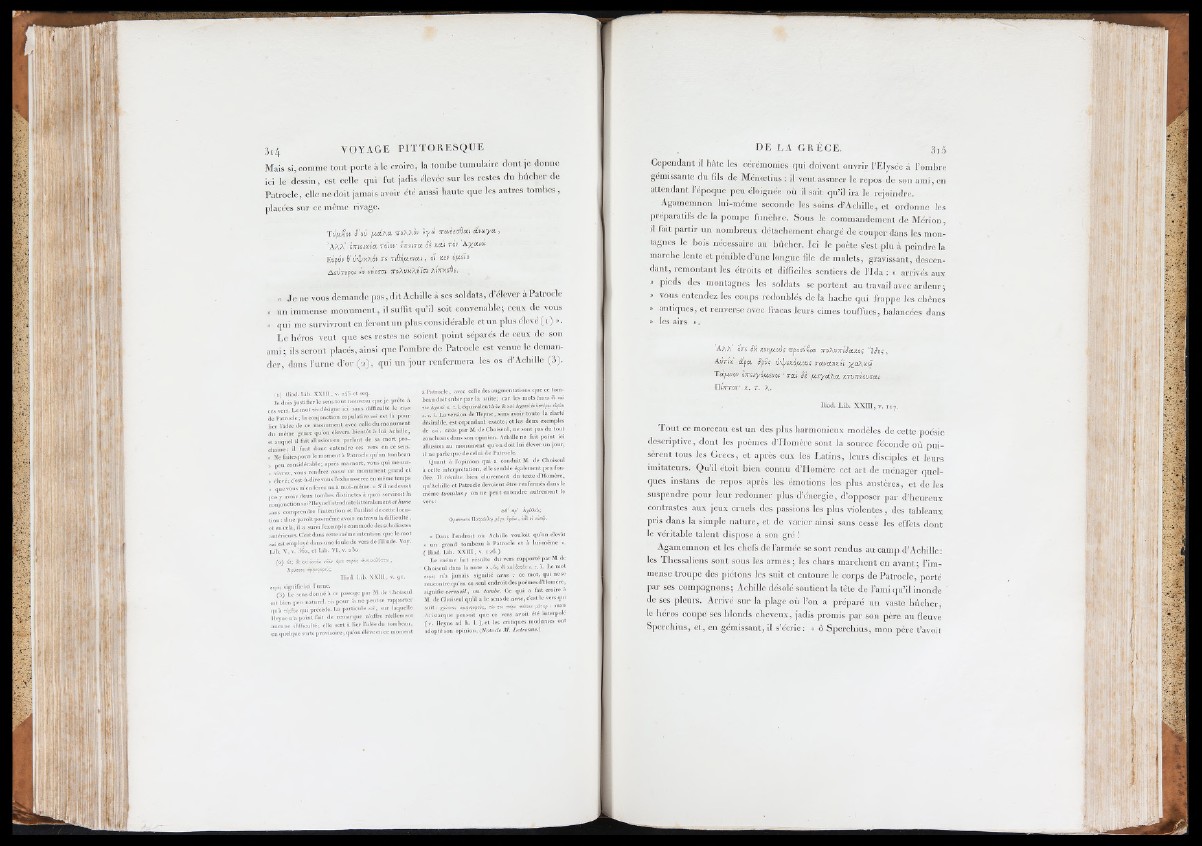
I® ' ,
1 /
i s | i ’
l i “
F
„ I.
Mais si, comme to u l p o rte à le r ro ir c , la to n ilie tum u la irc d o n t je d o n n e
ici le d e s s in , e st relie q u i fu t jailis élevée su r les restes dn Itù c licr de
P a lro e lc , elle n c d o it jam ais avoir élé aussi lian te (pic les a n tre s tom b e s ,
placées su r ce m êm e rivage.
T v iiS o t J"»é p a Aa TToAAi» i y à iroresirSai im y a . ,
’AAA ÎTULKÎO. Tûïor sT rara ¿'î k m tov A;^aioi
Eup® Ô’ u-AhAov T l TiSnfisvM , di kîv ¡fJ.m
A sv T ifo i iv vriÈtro'i TToAvKxdiin AiTrnirôi.
„ J e ne vous d em a n d e p a s , d it A chille à ses so ld a ts , d ’élever à P a tro c le
. n n im m en se m o n um e n t, il suflll q n ’il so it c o n v en ab le ; ceux d c vous
. q u i me su rv iv ro n t cn fe ro n t n n p in s co n s id é rab le ct n n p lu s élevé ( i ) «.
L e liiM-os v e n t q n c ses res te s n c soient p o in t séparés d c ceux d e son
ami ; ils se ro n t p lacés, ainsi q u e l’om b rc de P a tro c le csl v e n u e le d em a n d
e r , d an s l’n rn e d ’o r ( 2 ) , q n i u n jo u r ren fe rm e ra les os d’A d iilIc (3 ).
i; lliad. l.ib. X \ n ! , v , î ./|5 Cl seq.
]e dois justilier le sens tout nouveau que je prêle à
ces vers. Le mol rov désigne ici sans difficulté le af.px
de Patrocle; la conjonction copulative xoi est là pour
ber ridée de ce .nouumei.l avec celle du monument
.1,, ,..™= gmre gu'on élever, ble.lot i 1.1 Aeh.lk,
et auquel il fait allusion en parlant de sa mort prochaine;
il faut dune cmendre ces vers en ce sens.
Ne faites pour 1c momeiità Patrocle qu'un tombeau
„ peu considérable; aprè.s ma mort, vousqm mcsor-
, vis rez, vous rendre/, aiiisi ce monument grand et
n élevé : c’est à-dire vous l'exhausserez en même temps
que vous m'en ferez un à moi-même. » S’il nc devoit
nas V avoir deux tombes distinctes à quoi serviroit la
c..njonctlon«i?He)iiel'alraduitelitléraleineiHeiAjmc
aans comprendre l’mlention et l’uùHté decette locution:
il ne paroit pas même avoir entrevu la difficulté,
et en cela, il a .suivi l'exemple commode desscboliastes
antérieurs. C'est dans rette même intention que le mol
xai est employé dans une foule de vers de l'iliadc. Voy.
Lil). v. V. '-IGa, et I.ib. VI,V. a3ü.
(2) Û ; * «aio7«x /»tu ipr ecpi, ix-.uxlZrz-.i,
XFcrro; «jxiqoprA.
Ibad. Lib. XXlll, V. 91.
ac'.ii signifie ici l'urne.
(3) Le sens dumié à CC passage par M. de Clioiseul
est bien pen naturel, w pour 5v nc peut se rapporter
q u ' à qui précède. La particule/.ai, .-nr laquelle
Hcyuc n’a point fait de remarque n'offre réellement
aucune difiiculté; elle sert à lier l'idée du lombeau.
en quelque sorte provisoire. qu'on élève cn cc moment
àpatrocle, avec celle desaugmcnlations qne ce tombeau
doit subir par la suite; car les mots rân« is/<xi
ri. Àxaioi s. t. équivalent à S/ ¿è xai Àxaiei kvmiptp ièpvv
a. T. 3.. La version de Ileyne , sans avoir toute la clarté
désirable, est cependanl exacte ; et les deux e.xemples
de xeti, cités par M. de Choiseul, nc sont pas du loul
coucliians dan.s son opinion. Achille ne fait point ici
allusion au monument qu'on doit lui élever un jour,
il ne parlcque decelui de Palrocle.
Quant à l’opiiiioii qui a conduit M. dc Choiseul
à cette interprétation, elle semble également peu fondée.
11 résulte bien clairement du texte d'Homère,
qu’Achille ct Patrocle devoieut être renfermés dan.s le
même lumulus; on ne peut entendre autrement le
tví'áp' Áx-itóí
<|ipaV3«o n«pó/.).« («-/« êpio/, oi aàrücc
Dans l’endroit où Achille vouloit qu’on élevât
I. un grand tombeau à Patrocle et à hii-même ».
(Iliad.Lib. XXIII, v. 12C.)
Le même fait résulte du vers rapporté par M. de
Choiseul dans la noie a , ic xxi iazéa x, t. X. Le mot
copó; n’a jamais signifié urne : cc mot, qui ncse
reucoiiire qu’en ce seul endroit des poèmes d’Homère,
signifie cercae/1, ou tombe. Cc qui a fait croire à
M. dc Choiseul qu'il a le seras de urne, c’c.sl le vers riui
suit : -/o-jsts; àpqi'fopcj;, «/ toi ripe t.ôz-mx pnzr.p : mais
Arislarquc peiisoit que cc vers avoil été interpolé
(v. Heyuü ad h. 1. ), et les critiques modernes ont
adopté son opinion. {Note de lïï. Letronne.)
Cependanl il hâte les cérémonies qui doivent ouvrir l’Elysée à l’ombre
gémissante du lils de Ménoetius : il veut assurer le repos dc son ami, en
attendant l’époque peu éloignée où il ,5,ait qu’il ira le rejoindre.
Agamemnon lui-mêmc seconde les soins d’Acliillc, ct ordonne les
préparatifs dc la jiompc fiiuèbrc. Sous le commandement de Mérion,
il but partjr un uombrcnx détachement chargé dc couper dans les monlagncs
le bois nécessaire au bûcher. Ici le poète s’cst plu â peindre la
marche Iculc ct pénible d’une longue file dc mulets, gravissant, descendant,
remontant les étroits ct di/Ilciles sentiers de l’Ida : « arrivés aux
a pieds des montagnes les soldats sc portent au travail avec ardeur ;
» vous entendez les coups redoublés de la hache qui frappe les chênes
• antiques, et renverse .avec fracas leurs cimes toulfucs, balancées dans
» les airs ».
AaA ò r i (bî Trpocr/^cüi TrohVTridcLKoi ’’id 'n ç ,
AvtÎk « p a . ip û ç •¿■flKÛlU.Wq TClVCLTlKit
TcLfcvov iiznyofj.i'iût ■ retí Si fxiycixa. ktvttUvtm
rilTTrOV K, T. A .
lliad. Lib. X X I I I , V. 1 1 7 .
Tout ce morceau csl un des plus harmonieux modèles dc cette poésie
descriptive, donl les poèmes d'Homcrc soul la source féconde où pui-
scrcut lous les Grecs, ct ajirés eux les Latins, leurs disciples et leurs
imitateurs. Qu’il étoit bien couiiu d'Homère cet art de ménager quelques
instans dc rcjios iqirès les émotions les plus austères, ct de les
suspendre pour leur redonner plus d’énergie, d’opposer par d’heureux
contrastes aux jeux cruels des passions les plus viólenles, des tableaux
pris dans la simple nature, ct de varier ainsi sans cesse les effets dont
le véritable talent disjiose à son gré .'
-Agamemnon ct les chefs dc l'armée sc sont rendus au canij) d’Achillc:
les Thcssalicns sont sous les .armes ; les chars marchent cn avant; fim-
mcnsc troupe des piétons les suit ct entoure le corps do Patrocle, porté
par ses compagnons; Achille désolé soutient la téte de l’ami qu’il inonde
dc scs pleurs, ztrrivé sur la plage où l’on a préparé un vaste bûcher,
le héros coupe ses blonds cheveux, jadis promis par son père au fleuve
Sperchius, el, cn gémissant, il s’écrie: . ô Spcrcliius, mon père l’avoit I A