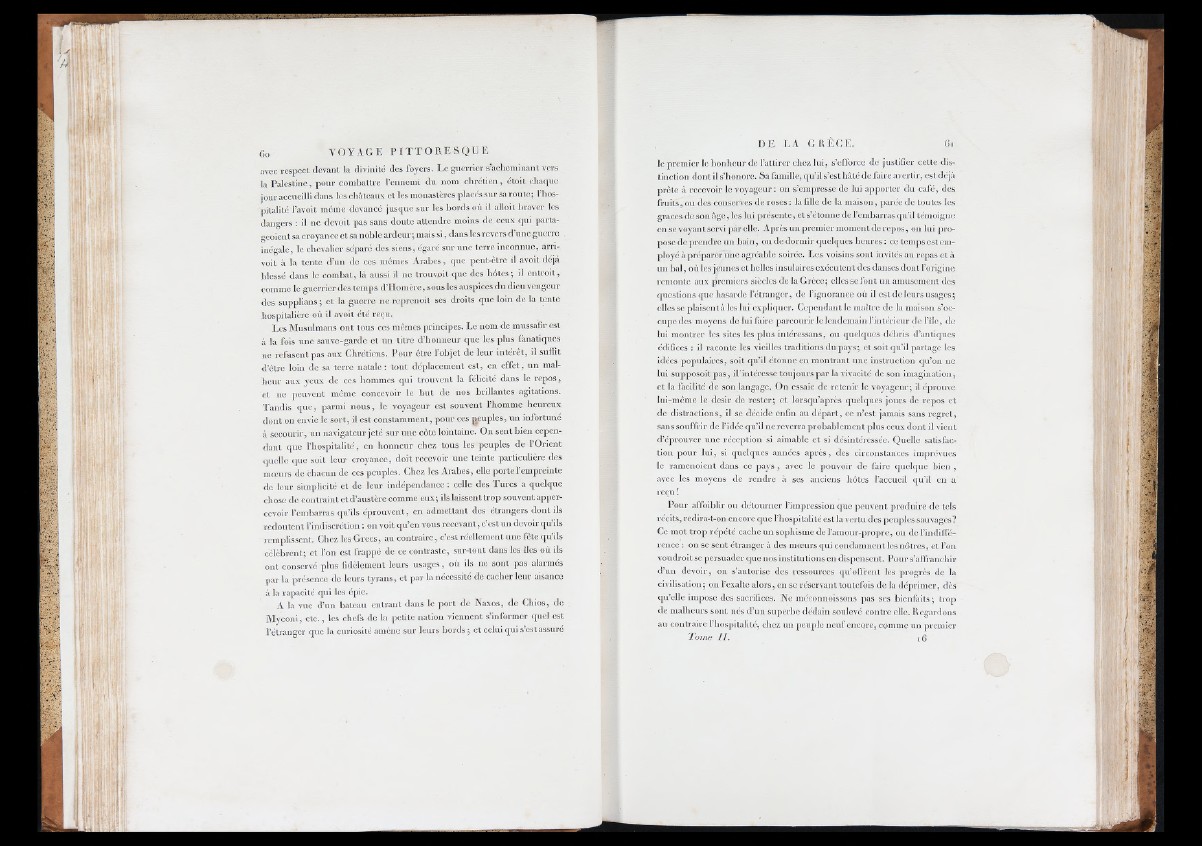
k ?
avec rcspocl clcvanl la divinilc des foyers. Le guerrier s’achcminaiU vers
la Palcsliue, pour comballrc l’cniicmi du nom cbrclicil, éloil ebaquo
jour accueilli daus les cbâtcanx cl les mouaslércs placés sur sa roule; l'hos-
|iUalilé l’avoit nuunc devancé jusque sur les bords où il alloil braver les
dangers : il ne dcvoit pas sans doiilc attendre moins dc ceux qui paiTa-
gcüicnt sa croyance et sa noble ardeur; mais si, dans les revers d une guerre
inégale, le chevalier séparé des siens, égaré sur une lerrc inconnue, arri-
voit à ia lente d’un dc ces mêmes .Arabes, que pcnl-êlrc d avoit déjà
lilcssé dans le coinbal, là aussi il ne Irouvolt que des hôtes; il cntroit,
eonimc le guerrier des temps d’Ilomcvc, sons les auspices du dieu vengeur
dos snpplians; et la guerre ne reprciioit scs droits que loin do la tente
hospitalière où il avoit été reçu.
Les SIusulmaiis ont tous ces mêmes principes. Le nom do mussafir est
à la fois une sauvc-gardc cl un titre d’Iionncur que les plus fanatiques
ne refusent pas aux Chrétiens. Pour être l’objet de leur intérêt, il suffit
d’être loin do sa terre natale: tout déplacement csl, en effet, un malheur
aux yeux dc ces hommes qui trouvent la félicité dans le repos,
cl ne peuvent même concevoir le but dc nos brillantes agitaLions.
Tandis ipie, parmi nous, le voyageur est souvent l’homme heureux
dont on envie le sort, ii est consLammciit, pour ces peuples, uu infortuné
à secourir, un navigateur jeté sur uuc côte lointaine. Ou sent bien cependant
que l’hospitalité, en honneur chez tous les peuples de fOricnt
quelle que soit leur croyance, doit recevoir une teinte particulière des
moeurs dc chacun de ces peuples. Chez les Arabes, elle porte l’cmprcinle
dc leur simplicité cl de leur indépcnd.incc : celle des Turcs a quelque
chose de contraint ct d’austère comme eux; ils laissent trop souvcnl appcr-
ccvoir l’embarras qu’ils éprouvent, en admettant des étrangers donl ils
redoutent l’indiscrétion : on volt qu’en vous recevant, c’csl un devoir qu’ils
remplissent. Chez les Grecs, au contraire, c’csl réclicmcnl une fclc qu’ils
célèbrent; cl l’on est frappé dc ce contraste, sur-tout dans les îles où ils
ont conservé plus fidèlement leurs usages, où ils ue sont pas alarmes
par la présence dc leurs tyrans, ct par la nécessité de cacher leur aisance
à la rapacîLc f[ui les ôpic.
A la vue (.ruii bateau ciilraiiL dans lo port dc Naxos, dc Cliios, do
jMyconi, etc., les chcÎs dc la petite nation viennent s’inibrmer (piel csl
î étranger que la curiosité amène sur leurs bords; ct celui quis’oslassuré
D E E A G R E C E . (i.
le premier le bonlicur de l’attirer clic/. lui, s’eiïbrcc de jirslificr celle dis-
llnclioii dont il s’honore. Saiàmillc, qu’il s’csthatc de iàlre avertir, est ch^à
prête à recevoir le voyageur: on s’empresse dc lui apporter du café, des
fruits, ou des conserves dc roses : la idle dc la maison, parée de Louies les
graces dc son age, les lui présente, cl s’étonne dc l'cmharras qu’il témoigne
en sc voyant servi par elle. Apres uu premier moment dc repos, on lui propose
de prendre un bain, ou dc dormir (|uclqucs heures : cc temps csLcm-
ployé à préparer une agréable soirée. Les voisins sont invités au repas et à
un bal, où les jeunes cl belles insulaires cxécuLeiiL des danses dont rorigino
remonte aux premiers siècles dc la Grèce; elles sc font un amuscmcuL des
<|ncslions que hasarde rélrangcr, dc riguorancc où il est de leurs usages;
elles se plaisent à les lui expliquer. Ce])endaiil le maître dc la maison s’occupe
des moyens dc lui faire parcourir le lendemain rinuù’icnr de l’île, de
lui montrer les sites les plus intcrcssans, ou (¡uclqucs délnis d’anliques
(xlifices : il raconte les vieilles traditions du pays; et soit (¡u’il partage les
idées populaires, soit (¡u’il étonne en montrant une instruction (¡u’on ne
lui sn¡)posoiL pas, il intéresse toujours par la vivacité de sou imagination,
ct la facilité dc son langage. On essaie de retenir le voyageur; il éprouve
lui-mcmc le dcsir dc rester; ct lorsqu’après (¡uclqucs jours dc repos ct
dc distractions, il sc décide cnilii au départ, ce n’est jamais sans regret,
sans souffrir dc l’idée qu’il ne reverra probablement ¡ilns ceux dont il a icnt
d’éprouver une réception si aimable et si désintéressée. Quelle satisÎac-
lioii pour lui, si (¡uchpies années après, des circonstances imprévues
le ramcnoient dans cc pays , avec le pouvoir dc faire (¡ucl(¡uc bien ,
avec les moyens de rendre à scs anciens liùLes faccucil qu’il en a
reçu !
Pour affüiblir ou détourner l'impression que peuvent produire de tels
récits, rcdira-l-on encore que rhos¡)¡talilé est la vertu des peiqiles sauvages?
Ce mot trop répété cacliciin sophisme dc l’amour-propre, ou defiiidiffé-
reiicc : on se sent étranger à des moeurs qui condamnent les nôtres, et l’on
voiidroit se persuader que nos institutions en dispensent. Pour s'aflVaneliir
d’un devoir, on s’autorise des ressources qu’offrent les ¡»rogrès dc la
civilisation; on l’exalte alors, en sc réservant toutefois de la déprimer, dès
(¡u’ellc impose des sacrifices. Ne méconnoissoiis ¡>as ses bienfaits; trop
de malheurs sont nés d'un superbe dédain soulevé contre elle. Regardons
au coniraive l'hos¡}iluliLé, chez un peuple neuf cuc(jrc, comme un premier
Tome I I . iG