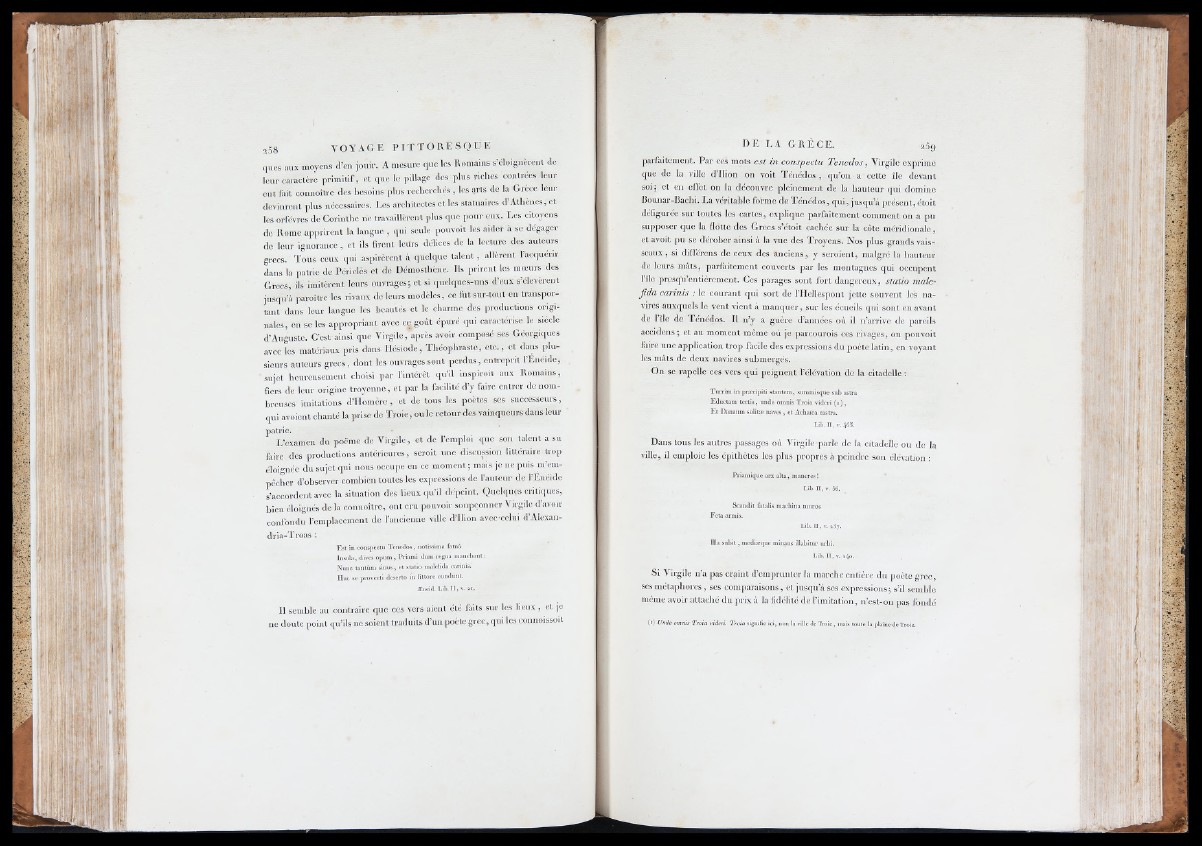
i®
ài'
rT/'r
te
.'•A'
-'ï-T' .
■‘..:y
i :ï
. ; íí
qucs mix moyens d’en jouir. A mesure que les Rommus s’éloigiièrciU de
leur cmaclcrc primitif, ct que le i>illagc des plus riches eouirecs leur
eut fait coimoilre des besoins plus rcelicrelii’s , les arls dc la (.rece leur
deviurciil plus nécessaires. Les areliitoctcs cl les slatuaires d’Alhèiics, cl
les orfèvres dc Coriiilho nc travaillèrent plus .|iic ¡loiir eux. l.es ciloyciis
dc Rome apprirciil la langue , qui seule pouvoit les aider a sc dégager
de leur ignorance , ct ils firent le,1rs délices de la lecture des auteurs
grecs. Tous ceux qui aspirèrent à quelque talent, allèrcut faciiuérir
dans la patrie dc Périclès ct dc Démosllièiic. Ils lirireiit les moeurs des
Grecs, iis imitèrent leurs ouvrages; cl si quelques-uns d’eux s’clcvcreiit
jusqu’à paroître les rivaux dc leurs modèles, cc fut sur-toul eu trauspoi-
tmit daus leur langue les beautés ct le charme des productions originales,
en sc les api!roprianl avec ce goiît épuré qui caractérise lo siècle
d’Auguste. C’cst ainsi que Virgile, après avoir composé ses Géorgiqiics
avec les matériaux pris daus Hésiode, Théophraslc, etc., ct dans plusieurs
auteurs grecs, dont les ouvrages sont perdus, entreprit l’Encidc,
sujet heureusement choisi par l’iiilcrèl qu’d iiispiroit aux Romains,
fiers dc leur origine troyeunc, ct ¡lar la facilité d’y faire entrer dc nombreuses
imitations d’il'omère , et dc lous les ,>oèlcs ses successeurs,
qui avoicnl cliaiitc la prise do Troie, ou le retour des vainqueurs dans leur
pairie.
U’cxamcn dn poème dc Virgile, ot dc fcmploi qnc son talent a su
faire des productions antérieures, scroit mic discussion littéraire trop
cloigiicc du sujet qui nous occupe en cc moment ; mai.s je ne puis m’empêcher
d’observer combien toutes les expressions dc fauteur clc l’Eneidc
s’accordent avec la situation des lieux qu’d dépeint. Quelques critiques,
bien éloignes dc la coimoilre, ont cm pouvoir süiipçoiiucr A irgilc d’avoir
confondu l’cmplaccment dc l’ancienne ville d’Ilion avcc-ceini d’Alcxaii-
dria-Ti’oas :
Est in ronspcctii Tcncclos, notissima làmà
Insiila, dives opiim , Prianii duin régna luanebaiil ;
A'imc laiHÙm sinus, el slaliü inaldida eariiiis.
Iluc se provecii descrto in liuore euiiduiU.
Æncid. Lib, II, v. ai.
11 semble au coiiLrairc ijuc ces vers aienl été i'ails .sur les lieux , cL je
ne doute point qu’ils nc soient traduits d’un ¡loètc grec, qm les connoissoit
pariuitcmciil. Par ces moLs est in conspecLu Tencdosff Virgile exprime
que de la ville d’Ilion on voit ïciicdos , qu’ou a cette île devant
soi; ct cn ciret on la découvre plcincmcnl do la hauteur qui domine
Bounar-Bacbi. La véritable forme de Ténédos, qui, jusqu’à présent, étoit
défigurée sur toutes les cartes, cxpliijuc parfaitement comment on a pu
supposer que la flotte des Grecs s’iiloit cachée sur la cote méridionale,
cl avoit pu sc dérober ainsi à la vue des Troycns. Nos plus grands vaisseaux
, si différcns dc ceux des anciens, y seroicnt, malgré la hauteur
dc leurs mâts, parfaitement couverts par les montagnes qui occupent
l’île prcsqu’enticrcmcnt. Ces parages sont fort dangereux, sialio maie-
Jida ca n n is : le courant qui sort dc rilcllesponl jette souvent Jcs navires
auxquels le veul vient à maïupicr, sur les écucils qui sont cn avanl
de l’île dc Ténédos. Il u’y a guère d’aiiuées où il n’arrive dc pareils
accidens; cl au moment racine où je parcourois ces rivages, on pouvoit
fiiirc une apjilication trop facile des expressions du poète latin, en voyant
les mâts de deux navires submergés.
On sc rapellc ces vers qui peignent l’élévation de la citadelle ;
T m r iin in præc ip iti sta n tcm , surnmisque siib astra
E d u c tam tc c iis , n n d e o umis T ro ia v id e ri ( i ) ,
E t Daiiaimi solilæ n a v e s , e t Achaïca castra.
Lib- II. V. .105.
Dans tous Jcs autres passages où Virgile parle de la citadcÎlc ou dc la
ville, il cmj)loic les épithctcs les plus propres à peindre son élévation ;
P r ia n iiq u e ara a lla , n ian eres !
Lib. II, V, 56.
Sc a iidit fatalis ma ch in a uiu ro s
F c la an n is.
Ilia subit, incdia'qii
Lib. II, y. 23;.
miiiaus illabiliir urbi.
Llb. II, V, 240.
Si Virgile n’a pas craint d’cmprimlcr la marche entière du poète grec,
scs métaphores, scs comparaisons, cl jusqu’à scs cxprcssion.s; .s’il semble
même avoir allaclié du jirix à Ja fidélité de l’imilaLion, n’csl-oii pas fondé
(i) Unrie omnis Troia videri. Troia sigiiiQc i( s toute la plaine ilc Troie,
s
i !l